X/ENS Physique PSI 2025
| Thème de l'épreuve | Phénomènes de transport, thermoélectricité et applications |
| Principaux outils utilisés | électricité, thermodynamique, électromagnétisme |
| Mots clefs | métaux, courant électrique, courant de chaleur, thermoélectricité, effet Seebeck |
Corrigé
:👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
👈 l'accès aux indications de tous les corrigés ne coûte que 1 € ⬅ clique ici
👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
- - - - - - - - - - - - - - - -
👈 gratuite pour ce corrigé si tu crées un compte
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Énoncé complet
(télécharger le PDF)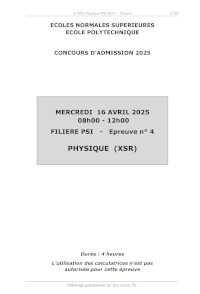












Rapport du jury
(télécharger le PDF)


Énoncé obtenu par reconnaissance optique des caractères
ECOLES NORMALES SUPERIEURES ECOLE POLYTECHNIQUE CONCOURS D'ADMISSION 2025 MERCREDI 16 AVRIL 2025 08h00 - 12h00 FILIERE PSI - Epreuve n° 4 PHYSIQUE (XSR) Durée : 4 heures L'utilisation des calculatrices n'est pas autorisée pour cette épreuve Debut du sujet Phenomenes de transport, thermoelectricite et applications. Dans ce probleme, nous nous interessons a quelques phenomenes couplant les transports de charge et de chaleur. Dans un premier temps, on etudie les notions elementaires sur le transport de la chaleur et de la charge dans un metal. Dans un second temps, nous nous interesserons au couplage entre ces phenomenes, et nous analyserons en particulier les effets thermoelectriques. Les effets thermoelectriques peuvent etre utiles dans differents contextes. Notamment, ces dernieres annees, des dispositifs utilisant ces effets ont ete envisages afin d'elaborer des solutions de recuperation d'energie thermique dissipee dans des centres de donnees pour produire de l'energie electrique. Les materiaux ayant des proprietes thermoelectriques sont notamment utilises pour realiser des mesures de temperature. On etudiera ainsi, dans une derniere partie, les performances des thermometres bases sur des jonctions thermoelectriques, que nous comparerons dans ce contexte aux caracteristiques des thermometres utilisant les proprietes des metaux. Les applications numeriques seront effectuees avec la precision qu'un calcul a la main permet aisement, et (sauf mention contraire) sans exceder deux chiffres significatifs. Les ordres de grandeur seront donnes avec un seul chiffre significatif. Les donnees numeriques ont ete choisies pour rendre aises les calculs. Les references des questions abordees devront etre indiquees de facon claire. Le sujet comporte 12 pages : les deux parties constituant ce sujet sont independantes et peuvent etre traitees separement. Certaines sous-parties peuvent etre abordees independamment des questions precedentes. Il est conseille d'aborder le sujet dans l'ordre des questions. Notations, formulaire et donnees numeriques. Charge elementaire : e 1,6 × 10-19 C Constante de Boltzmann : kB 1,4 × 10-23 J · K-1 Masse d'un electron : me 9,1 × 10-31 kg Masse d'un proton (ou d'un neutron) : mp 1,7 × 10-27 kg Conductivite electrique du cuivre : 0 6,0 × 107 S · m-1 Conductivite thermique du cuivre : Cu 3,0 × 102 W · m-1 · K-1 Conductivite thermique du platine : Pt 8,0 × 101 W · m-1 · K-1 Permittivite dielectrique du vide : 0 10-11 F · m-1 Masse volumique du platine : Pt 2,1 × 104 kg · m-3 Capacite thermique massique du platine : cPt 1,3 × 102 J · K-1 · kg-1 = (Ar ,A ,Ax ) : Operateur laplacien vectoriel en coordonnees cylindriques (r,,x), pour un vecteur A 2 Ar 1 2 Ar 2 Ar 1 Ar 2 A Ar - 2 - 2 ur + 2 + + 2 r 2 x2 r r r r r 2A 2A 2A 1 1 A 2 A A r = + A + 2 + + + 2 - 2 u . 2 2 2 r r x r r r r 2 1 2 Ax 2 Ax 1 Ax Ax + + 2 + + ux x2 r 2 r2 r r On notera i l'unite imaginaire telle que i2 = -1. Page 1/12 I Transport de charge et de chaleur dans un materiau metallique Deux solides, notes S1 et S2 , de meme capacite thermique C, sont mis en contact a l'aide d'un barreau cylindrique conducteur de conductivite thermique , de capacite thermique massique c, de masse volumique , de longueur et de rayon a. La conductivite electrique du barreau conducteur en regime permanent est notee 0 (conductivite statique). Le barreau conducteur contient des charges libres de se deplacer. On note n la densite volumique d'electrons (en m-3 ), m la masse d'un electron et -e sa charge. Les temperatures des deux solides S1 et S2 sont respectivement T1 et T2 , et leurs potentiels electriques respectifs sont notes V1 et V2 . Les electrons du barreau conducteur sont donc soumis a une difference de potentiel electrique. Ces derniers subissent egalement une dissipation d'energie, en raison de collisions, modelisee par une force m de frottement visqueux fv = - v , ou est un temps caracteristique de collision et v la vitesse d'un electron. L'origine des positions, materialisee par le point O, est prise a la jonction entre le barreau et le solide S1 . La situation est representee sur la figure 1. Figure 1 Le dispositif complet est constitue de deux solides notes S1 et S2 , portes a des temperatures Tk , avec k = 1,2, et des potentiels electriques Vk differents, relies par un conducteur de longueur . Le barreau reliant les deux reservoirs a une longueur = 2 cm et un rayon a = 1 mm. L'origine des positions est prise a la jonction entre le barreau et le solide S1 . Les sections suivantes abordent les caracteristiques du transport de charge dans un conducteur metallique en regime continu (I.A) et en regime variable (I.B), et celles du transport de chaleur dans le meme type de materiau (I.C). Enfin, une etude des effets thermoelectriques est conduite dans la partie I.D. I.A Transport de charge en regime continu 1. Par un raisonnement en ordres de grandeur, justifier que, dans un metal, les proprietes de conduction electrique sont essentiellement dues aux electrons. 2. Etablir l'equation regissant l'evolution temporelle de la vitesse d'un electron dans le barreau cylindrique conducteur. En regime permanent, montrer que la vitesse v d'un electron et le champ dans le barreau cylindrique, sont proportionnels. On appellera mobilite ce coefficient de electrique E proportionnalite positif. On le notera µ, et on l'exprimera en fonction de m, e, et . On negligera les effets du champ de pesanteur. 3. En deduire une expression de la conductivite du metal en regime permanent 0 , en fonction de n, e, et m. 4. Exprimer alors la resistance electrique Rel du barreau metallique reliant les deux solides, S1 et S2 , en fonction de 0 et des parametres geometriques. Page 2/12 I.B Transport de charge en regime lentement variable Les proprietes de transport electrique d'un barreau metallique evoluent en fonction de la tension appliquee a ses bornes, en particulier vis-a-vis de la frequence de cette derniere. Dans le cas d'un regime harmonique, on peut decrire la dependance de la resistance vis-a-vis de la frequence. En regime harmonique a la pulsation , la conductivite dynamique () peut s'ecrire, en notation complexe : 0 () = . (1) 1 + i Pour les grandeurs physiques en representation complexe, on considerera que la dependance temporelle est de la forme eit . 5. Retrouver l'expression de () dans le cas d'une sollicitation du barreau metallique par un champ electrique sinusoidal. 6. En exploitant les equations locales de l'electromagnetisme en notation complexe, montrer que la densite volumique de charge (M,t) en un point M du conducteur verifie l'equation suivante : 2 1 (M,t) + (M,t) + p2 (M,t) = 0 , (2) t2 t avec p une pulsation caracteristique dont on determinera l'expression en fonction de n, e, m et 0 . 7. Donner un ordre de grandeur du parametre de maille dans un metal. En supposant que chaque atome du reseau cristallin donne un electron de conduction, en deduire une estimation numerique de la densite electronique n dans un metal. Pour un conducteur de bonne qualite, comme le cuivre, evaluer numeriquement un ordre de grandeur de et de p . 8. Determiner alors l'expression du facteur de qualite Q de l'oscillateur amorti decrit par l'equation (2) et une valeur numerique de ce dernier. Representer graphiquement l'allure de la densite volumique d de charge en fonction du temps, en supposant les conditions initiales suivantes : (0) = 0 et (0) = 0. dt En deduire que lorsque 1, la densite de charge au point M peut etre consideree comme nulle. Dans la suite, on se placera dans le regime 1. 9. Dans cette approximation, justifier que le vecteur densite volumique de courant j = jx (r,,x,t)ex ne depend pas de la coordonnee x, definie par l'axe de revolution (Ox) du barreau cylindrique conducteur. Expliquer egalement pourquoi jx est independant de . 10. Montrer que la densite volumique de courant jx (r,t) verifie l'equation suivante : jx = µ0 0 jx . t (3) E devant le On justifiera notamment pourquoi on peut negliger le courant de deplacement jd = 0 t courant de conduction j = jx (r,t)ex . Donner le type de cette equation aux derivees partielles. Le graphique de la figure 2 represente l'allure de la densite volumique de courant jx (r) le long de l'axe (Ox) en fonction de la distance r r au centre du conducteur, pour differentes valeurs de la 2 pulsation, a un instant t. On note = une distance caracteristique. µ0 0 11. En adaptant la modelisation mise en oeuvre a la question 4 et en utilisant le graphique de la figure 2, decrire le comportement de la resistance du barreau conducteur en fonction de la pulsation du courant qui le traverse. En particulier, on etablira une expression de la resistance en fonction de la pulsation. On s'appuiera pour cela sur une modelisation simple du profil spatial de jx (r). Pour tenir compte d'eventuels phenomenes de propagation au sein du cable, on souhaite decrire le comportement du potentiel electrique le long du barreau metallique sur la base du modele suivant : Page 3/12 =a = a/2 = a/5 = a/10 2 |jx| aI r a Figure 2 Densite volumique de courant axiale dans le cable jx (r) en fonction de r, pour differentes valeurs de . Le courant total parcourant le cable est note I. A la position x et a un instant t, le potentiel electrique est note V (x,t). A la position x et a un instant t, le courant electrique est note I(x,t). Un element infinitesimal de conducteur de longueur dx situe a l'abscisse x est modelise par une resistance dR = Rdx, reliee a la masse par une capacite dC = dx, comme represente sur le schema de la figure 3. R est une resistance lineique et est une capacite lineique. Figure 3 Element infinitesimal de cable de longueur dx, modelise par une resistance elementaire Rdx et une capacite elementaire dx. 12. Etablir une relation entre les potentiels V (x,t) et V (x + dx,t), et avec le courant I(x,t). 13. En deduire alors que le potentiel verifie une equation de diffusion, faisant intervenir un coefficient de diffusion, note D, dont on determinera l'expression et la dimension. 14. Une modelisation analogue a celle presentee dans le schema de la figure 3 permet de decrire un cable coaxial sans pertes : on remplace pour cela la resistance elementaire dR = Rdx par une inductance elementaire dL = dx, ou est une inductance lineique. Montrer que le potentiel electrique (ou le courant electrique) obeit a une equation de d'Alembert dans le cadre de cette modelisation. 15. En cherchant une solution des equation obtenues aux questions 13 et 14 sous la forme V (x,t) = V0 ei(t-kx) , determiner les relations de dispersion associees a ces equations. 16. Commenter l'expression mathematique de la relation de dispersion obtenue a partir de l'equation de la question 13 et comparer a la relation de dispersion obtenue pour une equation de D'Alembert (question 14). Expliquer les phenomenes qui apparaitront en fonction de l'expression de la relation de dispersion. Page 4/12 I.C Etude thermique Afin de conduire l'etude thermique du barreau metallique, on se refere au schema de la figure 1. On suppose que l'ensemble est calorifuge, notamment les parois laterales du barreau metallique. On negligera donc les echanges d'energie entre le systeme, constitue par les deux solides et le barreau, et l'exterieur. On suppose dans un premier temps que les solides S1 et S2 se comportent comme des thermostats (aussi appeles reservoirs de temperature dans la suite) et que leurs temperatures respectives T1 et T2 sont constantes. On suppose egalement que la temperature est continue a l'interface entre les solides et le barreau, hypothese traduite par les conditions suivantes : T (x = 0) = T1 et T (x = ) = T2 . Le barreau est modelise comme une phase condensee ideale de capacite thermique massique, notee c. 17. Rappeler la definition d'un thermostat. Donner la condition portant sur leur capacite thermique qui permettrait de considerer les solides S1 et S2 comme des thermostats. 18. Dans l'hypothese de reponse lineaire (concept a preciser), rappeler la loi a laquelle obeit le vecteur densite de courant thermique jQ . On notera la conductivite thermique . Pour un conducteur metallique a temperature ambiante, la conductivite thermique et la conductivite electrique 0 sont reliees par la loi de Wiedemann-Franz : 2 2 kB = . 0 T 3e2 (4) 19. Justifier l'affirmation : un bon conducteur electrique est un bon conducteur thermique . En utilisant la loi de Wiedemann-Franz et sur la base d'arguments physiques numeriques, justifier que l'evolution de la conductivite thermique d'un metal est conforme aux comportements attendus et en deduire un ordre de grandeur de la conductivite thermique du cuivre Cu . 20. On constate que la conductivite thermique du diamant est particulierement elevee, et de l'ordre de 2,2×103 W · K-1 · m-1 . Pourquoi la loi de Wiedemann-Franz ne s'applique-t-elle pas au diamant ? 21. Etablir l'equation gouvernant l'evolution spatio-temporelle du champ de temperature T (x,t) dans le barreau metallique. 22. Determiner l'expression du profil de temperature T (x) dans le barreau, en regime permanent. 23. Apres avoir rappele la definition de la resistance thermique d'un materiau, en deduire l'expression mathematique de la resistance thermique Rth du barreau metallique. On etudie maintenant la situation ou la temperature des thermostats T1 et T2 dependent du temps. Initialement, T1 (t = 0) = T01 et T2 (t = 0) = T02 . L'etude est conduite dans l'approximation des regimes quasi-stationnaires, c'est-a-dire qu'on suppose que les relations etablies precedemment restent valables. On rappelle que pour un thermostat dU = Cth dT , avec Cth la capacite thermique du thermostat, les capacites thermiques des deux thermostats etant identiques. 24. On note therm , le temps caracteristique de thermalisation des thermostats, et ech , le temps caracteristique des echanges de chaleur dans le barreau. Definir le cadre d'etude dans lequel on pourrait supposer que les temperatures T1 (t) et T2 (t) sont homogenes dans les reservoirs de temperature. 25. Determiner un systeme de deux equations differentielles verifiees par T1 (t) et T2 (t). On fera apparaitre une duree , caracteristique de l'evolution de T1 (t) et T2 (t), et dependant de Rth et Cth . 26. Determiner les expressions de T1 (t) et T2 (t). On pourra introduire les fonctions auxiliaires T1 (t) + T2 (t) T (t) = T1 (t) - T2 (t) et T (t) = , et montrer que ces fonctions obeissent a des equations 2 differentielles decouplees (independantes). Page 5/12 27. Representer graphiquement l'evolution de T1 (t) et T2 (t) en fonction du temps et analyser le resultat obtenu. 28. Donner l'expression du temps caracteristique th (assimile a ech ) de la diffusion thermique le long du barreau metallique en fonction des parametres geometriques et grandeurs caracteristiques physiques du barreau. Montrer que l'approximation des regimes stationnaires sera verifiee a condition que l'on puisse negliger la capacite thermique massique c du barreau devant une capacite thermique massique caracteristique, dependant de Cth , Rth , , et . Dans la suite, on supposera la capacite thermique du barreau metallique negligeable et obeissant a la condition etablie a la question precedente. 29. Determiner l'expression de la variation d'entropie d'un thermostat de capacite thermique Cth passant d'une temperature Ti a une temperature Tf . En deduire la variation d'entropie S du systeme complet, compose des deux solides S1 et S2 et du barreau metallique. T01 , et comT02 menter cette evolution. On identifiera les lieux et les sources donnant naissance a une irreversibilite. 30. Tracer la variation d'entropie S en fonction de la variable sans dimension = On considere dans la suite un element infinitesimal de longueur dx du barreau metallique, situe a l'abscisse x. 31. Determiner l'expression de la quantite elementaire d'entropie d'echange, notee Se , pour cet element infinitesimal entre les instants t et t + dt. On prendra en compte pour le resultat final le caractere negligeable de la capacite thermique massique du barreau, c'est-a-dire que son coefficient de diffusion thermique est suffisamment grand. On montrera en particulier que le resultat se met sous la forme T 2 Se = f (T ) dxdt , (5) x avec f (T ) une fonction de la temperature a determiner. 32. En deduire que le bilan local d'entropie volumique creee, notee sv , peut s'ecrire de la maniere suivante : sv f (T ) T 2 =- . (6) t a2 x Commenter l'evolution temporelle de sv et comparer aux precedentes analyses de la creation d'entropie. On se place maintenant en regime harmonique, a la pulsation . Les temperatures des contacts entre les solides S1 et S2 et le barreau metallique sont de la forme suivante : T1 (t) = T01 cos (t) + T02 T2 (t) = T02 . (7) On observe alors le comportement du champ de temperature T (x,t) en differents points du barreau metallique et en fonction du temps. Les representations graphiques de l'evolution du champ de temperature et du flux thermique dans le barreau metallique en fonction du temps sont presentees sur la figure 4. 33. Analyser les differentes courbes de la figure 4 et expliquer le phenomene. Proposer, sur la base d'arguments dimensionnels, une expression de la longueur caracteristique du phenomene d'attenuation Page 6/12 (a) 70 T(x, t) ( C) 60 50 40 x = 10 30 0.0 x=4 2.5 5.0 x=2 x = 34 7.5 10.0 t(s) 12.5 15.0 17.5 20.0 (b) (x, t)W x = 10 x=4 x=2 x = 34 t(s) Figure 4 (a) : Temperature dans un conducteur de platine en fonction du temps, pour differentes valeurs de x. (b) : Flux thermique dans le meme conducteur en fonction du temps, pour les memes valeurs de x. La frequence vaut f = 0,1 Hz, les temperatures T01 et T02 valent T01 = 20 C et T02 = 50 C. observe. Evaluer numeriquement une longueur caracteristique d'attenuation a partir des courbes de la figure 4, et montrer qu'elle est compatible avec l'expression proposee precedemment. 34. Etablir enfin une condition sur la pulsation pour que la norme du vecteur densite de courant de chaleur puisse etre consideree comme uniforme sur une section du barreau metallique. I.D Effets thermoelectriques Les effets thermoelectriques regroupent differents phenomenes mis en avant a la fin du XVIIIieme et au debut du XIXieme siecle, qui mettent en evidence le couplage des phenomenes de transport de charge et de chaleur. On distingue les differents types de couplages mentionnes ci-dessous : L'effet Peltier consiste en un deplacement de chaleur provoque par un courant electrique ; L'effet Thomson, a l'inverse, designe l'apparition d'un courant electrique provoque par un courant de chaleur ; L'effet Seebeck designe l'apparition d'une difference de potentiel provoquee en circuit ouvert par une difference de temperature. En presence d'effets thermoelectriques, les vecteurs densite de courant de chaleur jQ et de charge j Page 7/12 s'ecrivent - -- jQ = - - grad T - T grad V - -- j = - - grad V - grad T . (8) (9) ou est la conductivite thermique intervenant dans la loi de Fourier, la conductivite electrique statique intervenant dans la loi d'Ohm locale, le pouvoir thermoelectrique, et V le potentiel electrique. 35. En presence d'effets thermoelectriques, on definit la conductivite thermique (T ) par l'ex-- pression du vecteur densite de courant de chaleur jQ = -(T ) grad T , en l'absence de mouvement macroscopique de charges. En deduire l'expression de (T ). 36. Montrer qu'en circuit ouvert, la difference de potentiel aux bornes du conducteur se met sous la forme V (0) - V () = - (T (0) - T ()) , (10) avec un coefficient a exprimer en fonction d'un ou plusieurs des coefficients precedemment definis. 1 37. Montrer, dans le cas general, que la densite volumique de courant d'entropie js = jQ se met T sous la forme - js = j - - grad T . (11) T En deduire alors une interpretation du coefficient faisant intervenir l'entropie. 38. L'expression generale du taux de creation d'entropie sc = js · t -- ! grad T - + j · T sc est la suivante : t -- ! grad V . - T (12) Montrer que cette grandeur peut etre mise sous la forme -- !2 2 grad T j sc = + . t T T (13) Commenter cette expression et conclure quant a la reversibilite des effets thermoelectriques, decrivant le couplage entre le transport de charge et le transport de chaleur. V Figure 5 Jonction thermoelectrique entre deux materiaux 1 et 2. Pour determiner le coefficient , on utilise un montage dont le principe est decrit sur la figure 5. Une jonction thermoelectrique est constituee de deux materiaux 1 et 2, chacun etant caracterise par sa conductivite electrique i , sa conductivite thermique i , et son coefficient i , i = 1,2. Avec les notations de la figure 5, on definit le coefficient Seebeck de la jonction par l'expression suivante : S12 = VC - VD . TA - TB (14) Page 8/12 En pratique, on branche un voltmetre aux bornes de la jonction entre les deux materiaux (denotees C et D sur la figure 5). On prendra TD = TC . 39. Justifier que le courant electrique parcourant le circuit peut etre considere comme nul dans la configuration de la figure 5. 40. Exprimer le coefficient S12 en fonction des coefficients i du pouvoir thermoelectrique de chacun des deux materiaux. 41. En deduire une methode pratique permettant de determiner le coefficient 0 d'un materiau inconnu. II Mesures de temperatures Dans cette partie, on s'interesse a la realisation de mesures de temperatures en exploitant les phenomenes decrits precedemment et en etudiant des dispositifs, dont une grandeur physique, dite grandeur thermometrique, depend de la temperature. II.A Mesure de temperature avec un conducteur ohmique Une thermoresistance est un capteur thermique exploitant la dependance de la resistance d'un composant vis-a-vis de la temperature. Ici, on se propose d'etudier le fonctionnement d'une sonde de temperature de ce type utilisant un fil metallique, qui sera le plus souvent du platine, du cuivre ou du nickel. Ces thermometres tendent a remplacer les thermocouples pour les mesures a basses temperatures, notamment dans le domaine medical. La thermoresistance etudiee est assimilee a un conducteur metallique en platine, de geometrie cylindrique de longueur et de section S. La resistivite d'un metal, notee , depend de la temperature en C, notee dans la suite de l'etude. Pour toute la suite du sujet, la notation fera reference a la resistivite. La dependance precise en temperature de la grandeur thermometrique, ici (), depend du materiau considere. Dans le cas du platine, on a l'expression mathematique suivante, valable entre 0 C et 850 C : () = 0 1 + A + B2 , (15) avec la temperature en C, A = 3,9 × 10-3 C-1 et B = -5,8 × 10-7 C-2 . 42. Proposer une interpretation simple du parametre 0 au regard du modele mathematique eq. (15). Discuter, sur la base d'arguments numeriques, l'approximation consistant a considerer la resistivite comme une fonction affine de sur la plage de temperature consideree. On se placera dans le cadre de cette approximation pour le reste de l'etude de la thermoresistance. 43. Determiner la condition sur A permettant de garantir que la thermoresistance a une sensibilite maximale. Proposer un argument qualitatif permettant d'expliquer l'augmentation de avec . Pour mesurer precisement la valeur de la resistance de la thermoresistance, et en deduire la resistivite connaissant les parametres geometriques de celle-ci, on utilise le montage electronique represente sur la figure 6. Ce montage, appele pont de Wheatstone, permet de deduire la valeur d'une resistance a priori inconnue a partir de la valeur des autres composants et d'une mesure de la tension U . La mesure de la tension U s'effectue avec un voltmetre, dont l'impedance d'entree est tres elevee. La resistance de la thermoresistance est notee R = R0 + R , avec R0 = R( = 0). La tension d'alimentation E est choisie egale a 10 V. Page 9/12 Figure 6 Montage permettant de determiner la valeur de R en mesurant la tension U . La valeur de la tension E est fixee par l'utilisateur. On prendra E = 10 V. Les valeurs des resistances usuelles sont prises a R0 . 44. Exprimer la resistance R0 en fonction de 0 et la variation de thermoresistance R en fonction de et R0 . 45. Etablir l'expression de la tension U en fonction de R , R0 et E, puis en deduire l'expression de U en fonction de notamment. dU 46. La sensibilite du systeme de mesure est definie par = . Deduire des expressions de U et d deux inconvenients de ce montage pour realiser une mesure de temperature. Afin d'ameliorer le dispositif precedent de mesure de temperature, on adapte le montage electronique represente sur la figure 6, et on etudie celui propose sur la figure 7. Ce dispositif de mesure adapte le pont de Wheatstone de la figure 6, en introduisant deux ALI (Amplificateur Lineaire Integre), supposes ideaux et en fonctionnement lineaire. La grandeur physique mesuree est maintenant le potentiel Vs . Figure 7 Montage de mesure de temperature. Les ALI sont supposes ideaux, et fonctionnent en regime lineaire. 47. En reliant Vs et I par une expression mathematique, determiner la fonction realisee par l'ALI 2. 48. Etablir la relation entre Vs et R et en deduire une expression de Vs en fonction de la temperature . dVs 49. Determiner la sensibilite de ce nouveau montage, definie par e = , ou la grandeur therd mometrique est maintenant Vs . Commenter l'expression de la sensibilite obtenue, et proposer des preconisations concernant le choix des valeurs R et E. On prendra R = R0 . Evaluer alors numeriquement e . Page 10/12 II.B Utilisation de jonctions thermoelectriques pour la thermometrie Un thermocouple est un dispositif de mesure de temperature, exploitant le principe de l'effet Seebeck. Il est constitue d'une jonction entre deux materiaux possedant des coefficients Seebeck differents. Le dispositif experimental de mesure de temperature est represente sur la figure 8. V Figure 8 Schema du montage permettant la mesure de la temperature Tmes . Les traits noirs epais correspondent a un conducteur de cuivre, les traits gris aux materiaux 1 et 2 constituant la jonction thermoelectrique. La difference de potentiel est notee V . Le systeme dont on souhaite mesurer la temperature Tmes est mis au contact de la jonction thermoelectrique. Les jonctions aux points A et B sont maintenues a une temperature Tref . Le voltmetre est en contact electrique avec les jonctions A et B a travers un conducteur de cuivre (represente en traits noirs epais sur la figure 8). Les pouvoirs thermoelectriques i des deux materiaux peuvent a priori dependre de la temperature. 50. Montrer que la difference de potentiel mesuree par le voltmetre s'ecrit Z Tmes (1 (T ) - 2 (T )) dT . V = (16) Tref Determiner la condition permettant que la tension mesuree soit proportionnelle a la difference de temperature. 51. Proposer une methode permettant de fixer en pratique la temperature de reference Tref et justifier sa pertinence. On represente sur la figure 9 le graphe de l'evolution de la tension generee par differents thermocouples en fonction de la temperature, pour une temperature de reference valant Tref = 0 C. (;m=om1|bom7; T (;ml( " T;m Figure 9 Evolution de la difference de potentiel mesuree pour differents thermocouples, en fonction de l'ecart T a la temperature de reference, pour une temperature de reference Tref = 0 C. Les thermocouples de type B et S contiennent du platine, et ceux de type J, E et K contiennent du nickel. Page 11/12 52. Comparer la sensibilite des differents thermocouples presentes sur la figure 9, et la comparer a celle de la thermoresistance etudiee plus haut. 53. Expliquer les avantages et inconvenients des thermocouples contenant du platine (type B et S) sur la base du comportement de la grandeur thermometrique mesuree en fonction de la temperature, et de leurs proprietes chimiques. 54. Dans une perspective plus generale, a quelle application pourraient etre destines les effets thermoelectriques ? Fin du sujet Page 12/12
