e3a Physique et Chimie PSI 2025
| Thème de l'épreuve | Médecine et physique |
| Principaux outils utilisés | optique, électromagnétisme, ondes électromagnétiques, ondes sonores, mécanique des fluides, cristallographie, thermodynamique, diagrammes E-pH |
| Mots clefs | oeil, chirurgie réfractive, LASIK, cornée, système vasculaire, coeur, écoulement sanguin, capillaire, titane, prothèse, biocompatible, hexagonale compacte |
Corrigé
:👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
👈 l'accès aux indications de tous les corrigés ne coûte que 1 € ⬅ clique ici
👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
👈 gratuite pour ce corrigé si tu crées un compte
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Énoncé complet
(télécharger le PDF)











Rapport du jury
(télécharger le PDF)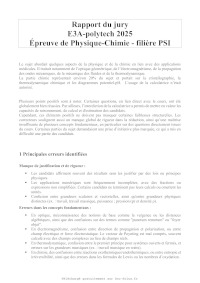
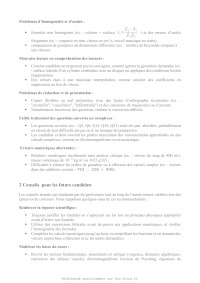
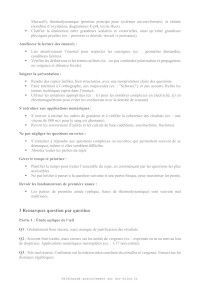



Énoncé obtenu par reconnaissance optique des caractères
SESSION 2025
PSI9PC
ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE PSI
____________________
PHYSIQUE-CHIMIE
Durée : 4 heures
____________________
N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la
précision et à la concision de la rédaction.
Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur
d'énoncé, il le signalera sur sa copie
et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives
qu'il a été amené à prendre.
RAPPEL DES CONSIGNES
·
·
·
Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction
de votre composition ; d'autres
couleurs, excepté le vert, bleu clair ou turquoise, peuvent être utilisées,
mais exclusivement pour les schémas
et la mise en évidence des résultats.
Ne pas utiliser de correcteur.
Écrire le mot FIN à la fin de votre composition.
______________________________________________________________________________
Les calculatrices sont interdites.
Le sujet est composé de 3 parties, toutes indépendantes.
· Les candidats sont encouragés à lire l'ensemble du sujet et à traiter les
questions dans l'ordre.
· Les données et formules utiles à la résolution du sujet figurent en fin
d'énoncé.
· Tout résultat fourni dans l'énoncé peut être admis et utilisé par la suite,
même s'il n'a pas été
démontré par le candidat.
· Les questions libellées par un astérisque () demandent de l'initiative de la
part du candidat.
La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la
clarté et la précision des
raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des
copies. En particulier, les
résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont
invités à encadrer les résultats
de leurs calculs.
Sujet : page 2 à page 9
Annexes : page 10 à page 12
1/12
Médecine et physique
Ce sujet aborde différents aspects physiques en lien avec la médecine. On
s'intéressera à la chirurgie
réfractive, à la description du système vasculaire, ainsi qu'à l'étude de
quelques propriétés chimiques
du titane, métal utilisé pour réaliser des prothèses. Aucune connaissance
particulière concernant les
dispositifs mentionnés précédemment n'est demandée.
Partie I - Quelques aspects liés à la chirurgie réfractive
I.1 - Étude préliminaire : étude optique de l'oeil
L'oeil est l'organe de la vision. Il capte la lumière et transforme celle-ci en
signaux électriques transmis
au cerveau via le nerf optique. La cornée est la membrane transparente par
laquelle la lumière entre
dans l'oeil. Ce dernier est de forme approximativement sphérique avec un
diamètre typique d'environ
25 mm. Il est maintenu dans la cavité orbitaire par un ensemble de muscles qui
assure aussi son
mouvement. La figure 1 donne une représentation simplifiée de l'oeil.
La forme de la cornée permet la focalisation de la lumière sur la rétine,
partie interne photosensible
de l'oeil. La mise au point s'effectue à l'aide du cristallin qui a la forme
d'une lentille biconvexe. Sous
l'action des muscles ciliaires, la courbure du cristallin est modifiée, si
besoin, de façon à pouvoir
former une image nette sur la rétine. Ce processus est appelé accommodation.
Figure 1 Représentation simplifiée de l'oeil [1]
Q1. La constitution de l'oeil présente des analogies avec celle d'un appareil
photographique. Regrouper dans un tableau trois éléments de l'oeil et de
l'appareil photographique pouvant être
mis en correspondance.
Q2. En assimilant l'oeil emmétrope (c'est-à-dire l'oeil sans défaut) au repos à
un ensemble {lentille
mince - écran} distants de 17 mm, donner la valeur correspondante de la
vergence de l'oeil.
Q3. Comment la forme du cristallin est-elle modifiée lors de l'accommodation ?
Comment appellet-on le point le plus proche que l'oeil peut voir en accommodant
? Ce point est typiquement
situé à 25 cm devant l'oeil emmétrope. Trouver la valeur de la vergence de
l'oeil dans ce cas de
figure.
2/12
La myopie est un défaut de la vision caractérisé par une perception floue
d'objets éloignés. L'image
de ces derniers se forme en avant de la rétine lorsque l'oeil est au repos.
Q4. Un oeil myope possède un punctum remotum situé à 2,0 m. Quelle est la
vergence de la lentille
correctrice à utiliser ? Faire un schéma montrant la marche de rayons lumineux
incidents sur
l'ensemble {lentille correctrice - oeil}. On représentera l'oeil par un
ensemble {lentille mince écran}.
Les cônes sont les cellules photoréceptrices permettant la perception de la
couleur. Ils sont concentrés
dans la zone centrale de la rétine avec une densité typique de = 2,0 ·105
cellules/mm2 . On modélise
toujours l'oeil par un ensemble {lentille mince - écran} distants de 17 mm. Le
pouvoir séparateur de
l'oeil est caractérisé par l'angle qui doit séparer deux points à l'infini pour
qu'ils soient distingués.
Q5. Donner une estimation, en radians, du pouvoir séparateur de l'oeil en
supposant que celui-ci
est lié à la distance entre deux cônes voisins.
Q6. () La lumière est diffractée lorsqu'elle passe à travers la pupille.
L'image d'un point objet à
l'infini correspond alors à une tache sur la rétine. Si l'on tient compte du
diamètre de la pupille
(dont vous estimerez la valeur), peut-on conclure que le pouvoir séparateur est
déterminé par
la diffraction ?
I.2 - Chirurgie LASIK
Le LASIK (acronyme de Laser Assisted In-Situ Keratomileusis) est une technique
de chirurgie réfractive couramment utilisée depuis le début des années 2000. En
1993, Detao Du, chercheur à l'université du Michigan, reçoit par accident un
faisceau laser femtoseconde dans l'oeil. Les médecins qui
l'examinent sont surpris par la netteté de l'impact du laser. Ils constatent
que les impulsions laser
ultra-courtes permettent de limiter la brûlure des tissus à une zone très
restreinte, contrairement aux
impulsions lasers utilisées à l'époque en ophtalmologie. Cet événement fortuit
a contribué à initier le
développement de la chirurgie oculaire au laser.
Du point de vue pratique, une intervention chirurgicale LASIK se déroule en
trois étapes (figure 2) :
· Une lamelle d'épaisseur d'environ 100 µm est découpée avec un laser à
impulsions femtosecondes. Une partie de la lamelle reste attachée à la cornée.
La découpe de ce volet cornéen dure
environ dix secondes par oeil. Ce dernier peut être soulevé de façon à accéder
à la partie non
superficielle de la cornée, le stroma.
· La forme de la cornée est ensuite remodelée avec un autre type de laser, le
laser Excimer. La
durée de cette phase est inférieure à la minute.
· Pour finir, le volet cornéen est remis en place.
L'intervention, pour les deux yeux, dure typiquement une trentaine de minutes
au bloc opératoire. La
cicatrisation s'effectue en quelques heures. La durée des impulsions est de
quelques femtosecondes.
Le diamètre de la zone de focalisation du faisceau au niveau de l'impact est
d'environ 1 µm.
On étudie tout d'abord l'onde électromagnétique produite par le laser. On
propose de modéliser l'onde
électromagnétique en un point M de l'espace à un instant t par une onde plane
progressive sinusoïdale.
Un point M de l'espace est repéré par ses coordonnées cartésiennes (x,y,z). On
note u x , uy et uz les
vecteurs unitaires portés par les axes du repère cartésien. L'onde est supposée
se propager selon la
direction u x et être polarisée suivant la direction uy . On note E0
l'amplitude du champ électrique,
sa pulsation et k son nombre d'onde. La durée d'une impulsion laser ainsi que
les valeurs des
constantes c, vitesse de la lumière dans le vide, et 0 , permittivité
diélectrique du vide, sont données
en annexe.
3/12
Figure 2 Illustration des étapes opératoires de la chirurgie LASIK [2]
Q7. Écrire les expressions des champs E(M,
t) et B(M,
t), ainsi que du vecteur de Poynting (M,
t).
On donnera les expressions en fonction, notamment, de E0 , , k, c et 0 .
On s'intéresse maintenant aux interactions entre le faisceau laser et les
tissus constitutifs de l'oeil.
L'utilisation d'impulsions très courtes et la forte focalisation du faisceau
laser permettent de produire
des champs électriques intenses. Dans ces conditions, le laser provoque la
vaporisation de la matière.
Une cavité est alors formée dans le stroma cornéen. Le champ électrique de
l'impulsion laser est
suffisamment intense pour ioniser la matière et la transformer en plasma. Ce
mécanisme est appelé
claquage optique. La bulle de gaz produite génère des contraintes dans la
cornée qui provoquent une
rupture localisée du tissu. La production de centaines de milliers de bulles
permet de réaliser une
incision nette pour former le volet cornéen.
Q8. Donner la relation entre l'amplitude E0 du champ électrique et l'énergie
Eimp d'une impulsion
en fonction de 0 , c et .
Q9. Quelle est l'expression du champ créé par le noyau d'un atome d'hydrogène
sur son électron ?
On notera rH le rayon de l'orbite de l'électron.
Q10. Comparer les valeurs des champs électriques perçus par un électron. Le
champ électrique
associé à une impulsion laser femtoseconde permet-il d'effectuer l'ionisation
des atomes ? Les
valeurs numériques de l'énergie et de la durée caractérisant l'impulsion laser
sont données en
annexe.
On étudie la propagation du laser dans la bulle de plasma formée dans la
cornée. On note n la densité
d'électrons libres du plasma et me la masse d'un électron. On utilisera le
modèle du plasma dilué.
On fait les hypothèses suivantes :
· on néglige les interactions entre les particules ;
· les ions sont supposés immobiles ;
· le plasma est localement neutre ;
· la composante magnétique de la force de Lorentz est négligeable devant la
composante électrique.
4/12
On considérera une onde électromagnétique plane progressive sinusoïdale de la
forme
exp(i(t - kx)).
E(M,
t) = E
0
.
Q11. Montrer que le vecteur densité de courant vérifie en notation complexe la
relation : j = E
On donnera l'expression de en fonction de me , , n et de la charge élémentaire
e.
Q12. Écrire les équations de Maxwell, sous leurs formes locales, dans le plasma.
Q13. À partir des équations de Maxwell, établir la relation de dispersion. On
donnera l'expression
de la pulsation plasma P .
Q14. Montrer que l'onde ne peut pas se propager dans le plasma si la pulsation
est inférieure à P .
Quelle est l'expression du champ électrique dans ce cas ? On introduira la
distance définie
c
par =
.
2P - 2
Q15. () Donner une estimation de la surface du volet cornéen à découper. Quelle
est le nombre
d'impulsions nécessaires pour effectuer cette découpe ? En prenant une durée de
découpe de
10 secondes pour un oeil, donner une estimation de la fréquence des impulsions
du laser utilisé.
On se propose de déterminer la taille de la zone susceptible d'être vaporisée
par une impulsion du
laser femtoseconde. On fait l'hypothèse que le claquage optique dans un volume
sphérique de rayon
R du stroma cornéen conduit à la formation de gaz. On supposera que la cornée
est constituée d'eau
et que le gaz formé est un mélange de H2 et O2 .
Q16. () Déterminer la valeur de R, rayon de la zone supposée sphérique de la
cornée vaporisée par
une impulsion laser.
I.3 - Mesure de l'épaisseur de la cornée
Il existe certaines contre-indications au LASIK. L'épaisseur de la cornée du
patient doit par exemple
être supérieure à 500 µm. La mesure de l'épaisseur de la cornée, ou
pachymétrie, peut s'effectuer à
l'aide d'ondes ultrasonores.
On considère la propagation d'une onde plane progressive sinusoïdale
ultrasonore dans la cornée.
Celle-ci sera considérée comme un fluide sans viscosité de masse volumique 0 ,
de pression P0 et de
vitesse nulle. L'onde se propage le long de l'axe Ox (de vecteur unitaire u x )
dans le sens des x positifs
avec une célérité c. Lors du passage de l'onde, on notera la pression P(x, t) =
P0 + p(x, t), la masse
volumique (x, t) = 0 + µ(x, t) et la vitesse du fluide v = v(x, t)u x .
On supposera que les perturbations associées à l'onde sonore sont de faible
amplitude : P0 |p| et
0 |µ| (hypothèse
del'approximation acoustique).
1
le coefficient de compressibilité adiabatique du fluide.
On notera S =
P S
On définit l'impédance acoustique Z comme le rapport de la surpression sur la
vitesse. On notera
Z1 l'impédance acoustique de la cornée et Z2 celle de l'humeur aqueuse, liquide
intra-oculaire de la
partie antérieure de l'oeil.
Q17. Donner l'expression du coefficient de compressibilité adiabatique dans le
cadre de l'approximation acoustique.
Q18. Utiliser l'équation associée à la dynamique du fluide appliquée à une
particule de celui-ci et
simplifier son expression dans le cadre de l'approximation acoustique.
Q19. Écrire l'équation locale de conservation de la masse et simplifier son
expression dans le cadre
de l'approximation acoustique.
5/12
Q20. En déduire l'équation de propagation vérifiée par p(x, t) en fonction de 0
et de S . Donner
l'expression de la célérité des ondes sonores. Donner sa valeur numérique dans
le cas de la
cornée.
Q21. Donner l'expression de l'impédance acoustique dans le cas d'une onde se
propageant dans le
sens des x positifs, puis dans le cas d'une onde se propageant dans le sens des
x négatifs.
Q22. Expliciter les conditions aux limites à l'interface entre la cornée et
l'humeur aqueuse. En
déduire les expressions des coefficients de transmission et de réflexion en
vitesse en fonction
des impédances Z1 et Z2 . Quelle fraction de la puissance acoustique incidente
est réfléchie sur
l'interface cornée - humeur aqueuse ? On demande une expression littérale.
Q23. Expliquer comment obtenir la valeur de l'épaisseur de la cornée à l'aide
de ce dispositif.
Partie II - Quelques aspects relatifs au système vasculaire
Le coeur est l'organe permettant la circulation du sang dans l'organisme. On
s'intéresse en particulier
aux contractions du ventricule gauche, qui expulsent le sang oxygéné vers
l'aorte pour irriguer ensuite
le reste du corps. Le sang circule dans les artères qui se subdivisent jusqu'à
devenir des capillaires au
niveau des organes. Les organes sont alimentés en nutriments et en oxygène. Le
sang se charge alors
en dioxyde de carbone, puis remonte ensuite vers le coeur par le système
veineux.
II.1 - Modélisation du coeur
On utilise une description simplifiée dans laquelle le coeur est modélisé par
une pompe (figure 3).
On cherche à évaluer la puissance mécanique associée. On considère une
pulsation cardiaque de
70 pulsations par minute. Le volume de sang expulsé à chaque pulsation est de
75 cm3 . On suppose
que la section S de l'aorte (artère qui chemine le sang depuis le coeur vers le
système artériel) est
égale à 3,0 cm2 .
Figure 3 Coeur et système vasculaire
On donne les caractéristiques suivantes :
· différences entre pressions d'entrée et de sortie : Ps - Pe = 100 mbar ;
vs
· lien entre vitesses d'entrée et de sortie : ve = ;
2
· l'énergie interne massique du sang, notée u, est supposée constante.
Q24. Déterminer la valeur numérique du débit volumique sanguin moyen D. En
déduire la valeur
numérique de la vitesse v s du sang dans l'aorte.
Q25. Calculer le travail utile massique fourni par le coeur en supposant que
celui-ci fonctionne
comme une pompe adiabatique. En déduire la valeur numérique de la puissance
fournie.
6/12
II.2 - Écoulement sanguin
On veut décrire l'écoulement du sang dans un vaisseau sanguin. Le vaisseau
considéré est de forme
cylindrique de longueur L et de rayon R. La longueur L est supposée très grande
devant R. On assimile le sang à un fluide visqueux, incompressible et homogène.
On note la viscosité dynamique du
sang et sa masse volumique. On se place en régime permanent et on suppose que
l'écoulement est
laminaire. L'influence de la pesanteur est supposée négligeable. En notant Ox
l'axe du cylindre, et en
adoptant les coordonnées cylindriques, le champ de vitesses s'écrit v(M) = v(r,
, x)u x .
Q26. À quelle condition sur le nombre de Reynolds l'hypothèse d'un écoulement
laminaire est-elle
vérifiée ?
On considère une portion cylindrique de fluide, de rayon r et de longueur L. On
note P1 la pression à
l'entrée de cette portion de fluide et P2 la pression en sortie.
Q27. Montrer que la vitesse ne dépend que de la variable r. Que vaut la vitesse
du fluide en contact
avec la paroi ?
Q28. La force par unité de surface s'exerçant sur l'élément de fluide considéré
a pour expresdv
sion : u x . Donner l'expression des forces de viscosité exercées sur cet
élément de fluide.
dr
Q29. Donner l'expression des forces de pression s'exerçant en amont et en aval
du système.
P1 - P2
dv
=-
r.
Q30. Montrer que le champ de vitesse vérifie l'équation :
dr
2L
En déduire l'expression littérale du champ de vitesse v(M) dans le fluide.
R4
(P1 - P2 ).
8L
En déduire l'expression littérale de la vitesse moyenne vm de l'écoulement en
fonction de P1 ,
P2 , , L et R .
Q32. On considère que les vaisseaux capillaires sont assimilables à des
cylindres de longueur
L = 1,0 cm et de rayon R = 5,0 µm. On supposera par ailleurs que la perte de
charge le long
d'un capillaire est typiquement de 10 kPa. Vérifier que l'hypothèse d'un
écoulement laminaire
est validée.
Q33. En supposant que l'ensemble des capillaires sont en dérivation et que la
vitesse du sang dans un
capillaire est de l'ordre de 1 mm·s-1 , donner une estimation du nombre de
capillaires présents
dans le système vasculaire.
Q31. Montrer que le débit volumique du fluide Dv vérifie : Dv =
7/12
Partie III - Étude d'un matériau biocompatible
Les éléments biocompatibles sont des matériaux dont la présence est bien
tolérée par l'organisme. Ils
n'engendrent pas de réaction du système de défense immunitaire. Le titane, le
niobium et le zirconium
sont des exemples de biomatériaux couramment utilisés.
Figure 4 Prothèse de hanche en titane [3]
Figure 5 Radiographie après pose de la
prothèse [4]
III.1 - Propriétés du titane
Q34. Indiquer la position du titane (numéro atomique Z = 22) dans le tableau
périodique des éléments. Préciser les numéros de la période (ligne) et de la
colonne. Dans quel bloc se situe-t-il ?
Le titane () est l'une des variétés allotropiques du titane. La maille du
titane (), représentée figure 6
dans l'annexe (3), est caractérisée par deux paramètres a et c.
Q35. Donner
la population de la maille. On indique que la hauteur c de la maille a pour
expression
2
c=2
a. En déduire la valeur de la masse volumique du titane.
3
III.2 - Production du titane
On trouve le titane dans de nombreux minerais sous forme de dioxyde de titane.
Le procédé pour
obtenir le titane a été développé dans les années 1930 et est encore utilisé
aujourd'hui. Le dioxyde de
titane est introduit sous forme de poudre dans un réacteur à une température de
1 100 K. Il se forme
alors du tétrachlorure de titane par l'action du chlore gazeux sur le dioxyde
de titane selon la réaction :
TiO2(s) + 2 C(s) + 2 Cl2(g) = TiCl4(g) + 2 CO(g)
(1)
Le tétrachlorure de titane est ensuite réduit à température élevée par du
magnésium liquide.
Q36. Donner les schémas de Lewis de TiCl4 et de TiO2 . On indique que, dans ces
structures, la
valence du titane est identique à celle du carbone.
Q37. À l'aide des données thermodynamiques fournies en annexe, calculer les
valeurs de r H0 et
de r S0 associées à la réaction (1). Pour quelle raison les valeurs des
enthalpies standard de
formation du carbone et du dichlore ne sont-elles pas indiquées dans le tableau
? Commenter
les signes de r H0 et de r S0 .
8/12
Q38. Quels sont les effets de la température et de la pression totale sur
l'équilibre associé à la
réaction (1) ? On précisera de quelle façon une augmentation ou une diminution
de la valeur
de ces paramètres déplace l'équilibre.
Q39. Écrire la réaction de réduction du tétrachlorure de titane par le
magnésium liquide sachant
qu'il se forme du chlorure de magnésium liquide.
Q40. Doit-on imposer une condition sur la température pour que la réaction soit
thermodynamiquement possible ? On se place à une température de 1 100 K et on
maintient la pression partielle
en TiCl4 à 0,10 bar. Dans quel sens le système évolue-t-il ?
III.3 - Stabilité du titane
Le diagramme E-pH du titane est présenté sur la figure 8 donnée en annexe.
Seules les espèces
suivantes ont été prises en compte : TiO2(s) , Ti2 O3(s) , Ti2+
(aq) , TiO(s) et Ti(s) .
Q41. Donner le degré d'oxydation du titane dans chacune de ces espèces.
Q42. Identifier les espèces A à E associées aux domaines de la figure 8. Le
candidat présentera sa
réponse sous forme de tableau.
Q43. Le titane métallique est-il stable dans l'eau ? Le pH a-t-il une influence
?
Q44. Quelle espèce se dismute en milieu acide ? Écrire l'équation de réaction
associée en attribuant
un coefficient stoechiométrique égal à 1 pour l'espèce qui se dismute.
Q45. Écrire l'équation de réaction associée à la frontière entre B et D. On
écrira la réaction dans le
sens de la formation de B. Sachant que la constante d'équilibre de cette
réaction est K = 1011 ,
déterminer la valeur de l'abscisse pH1 de la figure 8.
9/12
Annexe 1 - Données relatives à la partie I
- Charge élémentaire : e = 1,6 · 10-19 C
- Perméabilité du vide : µ0 = 4 · 10-7 H · m-1
- Permittivité du vide : 0 = 9 · 10-12 F · m-1
- Rayon de l'atome d'hydrogène : rH = 0,5 · 10-10 m
- Masse volumique de l'eau : = 1,0 · 103 kg · m-3
- Masse molaire de l'eau : M = 18 g · mol-1
- Compressibilité adiabatique de la cornée : s = 3,6 · 10-10 Pa-1
- Énergie massique de vaporisation de l'eau : Lvap = 2,0 · 103 kJ · kg-1
- Enthalpie de standard de formation de l'eau : f H0 = -241 kJ · mol-1
- Énergie d'une impulsion laser : Eimp = 4,0 µJ
- Durée d'une impulsion du laser : = 2 fs
- Longueur d'onde du laser femtoseconde : = 1,0 µm
- Dimension de la zone de focalisation : d = 1,0 µm
- On donne pour une lentille mince de centre O, de distance focale image f et
conjuguant un
objet A et une image A' , la relation de conjugaison avec origine au centre :
1
OA
-
1
OA
=
1
f
Annexe 2 - Données relatives à la partie II
- Masse volumique du sang : s = 1,1 · 103 kg · m-3
- Viscosité du sang : = 4,0 mPa · s
Annexe 3 - Données relatives à la partie III
- Nombre d'Avogadro : NA = 6,0 · 1023 mol-1
- Numéro atomique du titane : Z = 22
- Rayon de l'atome de Titane : R = 150 pm
- Le titane () possède une maille dont la géométrie correspond à un prisme
droit à base losange.
Les quatre atomes situés à la base du prisme sont tangents les uns les autres.
L'atome au milieu
de la maille est au contact avec les trois atomes situés au-dessus et les trois
atomes situés audessous.
-1
Masse molaire en g·mol
H
O
1,0 16,0
Ti
47,9
10/12
Figure 6 Maille du titane ()
Figure 7 Maille du titane () - vue de dessus
- Enthalpies standard de formation et entropies standard de formation à 25 °C :
TiO2(s)
C(s)
Cl2(g)
TiCl4(g)
CO(g)
Ti(s)
f H0 (kJ·mol-1 )
- 945
- 763
- 110
S0m ( J·K-1 ·mol-1 )
50
6
223
355
198
31
- Enthalpies libres standard de réaction
Réaction
Mg(l) + Cl2(g) = MgCl2(l)
r G0 (T) (kJ·mol-1 )
- 608 - 0, 132 · T
- Potentiels standard
Couple Ox/Red
Ti2+
(aq) / Ti(s)
TiO2(s) / Ti2+
(aq)
TiO2(s) / Ti(s)
TiO2(s) / Ti2 O3(s)
H2 O(l) / H2(g)
O2(g) / H2 O(l)
11/12
E0 (V)
- 1, 63
- 0, 50
- 0, 86
- 0, 56
0
1,23
- Diagramme E-pH du titane.
Figure 8 Diagramme E-pH simplifié du titane. Ce diagramme est tracé pour une
concentration de
travail égale à 10-3 mol ·L-1 .
Références
FIN
12/12
I M P R I M E R I E N A T I O N A L E 25 1062 D'après documents fournis
[1] Article Wikiversité Signaux physiques / Optique géométrique.
[2] An Overview on Performance Characteristics of Laser In-Situ Keratomileusis
Using Lasers and
Identification of Challenges, Khan et al., novembre 2012, Micro and Nanosystems.
[3] The Dislocated Hip Hemiarthroplasty : Current Concepts of Etiological
factors and Management, Jones et al. , The Open Orthopaedics Journal 11
(Suppl-7, M4).
[4] Article Wikipédia "Hip replacement".
