Centrale Physique et Chimie 1 PSI 2025
| Thème de l'épreuve | DK6 : un exemple de revalorisation |
| Principaux outils utilisés | thermochimie, thermodynamique, mécanique des fluides, conversion de puissance |
| Mots clefs | combustion, alternateur, compensateur synchrone, machine synchrone, turbine à gaz |
Corrigé
:👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
👈 l'accès aux indications de tous les corrigés ne coûte que 1 € ⬅ clique ici
👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
👈 gratuite pour ce corrigé si tu crées un compte
- - - -
Énoncé complet
(télécharger le PDF)









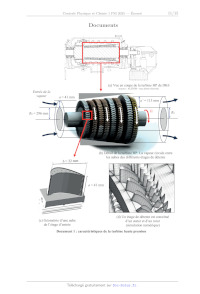


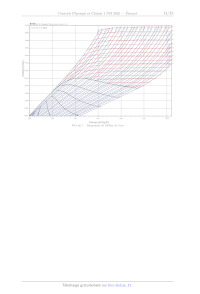

Rapport du jury
(télécharger le PDF)







Énoncé obtenu par reconnaissance optique des caractères
PSI
4 heures
Calculatrice autorisée
2025
Physique-chimie 1
DK6 : Un exemple de revalorisation
Le problème comporte 3 parties indépendantes. Certaines questions, moins
guidées, sont repérées par leur numéro
souligné. Elles ne sont pas a priori plus difficiles que les autres, mais
demandent de prendre plus d'initiatives.
La centrale électrique DK6, sur le site du port industriel de Dunkerque
(Hauts-de-France), produit de l'énergie électrique à partir de gaz naturel. De
par sa conception et sa situation géographique, la centrale DK6 a la
particularité de
pouvoir revaloriser les fumées issues de la production d'acier, émises par
l'usine sidérurgique voisine Arcelor-Mittal.
Le processus de revalorisation s'effectue en plusieurs étapes selon un cycle
combiné de récupération de la chaleur fatale
décrit en figure 1.
gaz brûlés
230 MW
turbines à vapeur
électrique
Arcelor Mittal
échangeur
thermique
générateur électrique
Circuit vapeur
refroidissement
par eau de mer
chaudière
fumées
sidérurgiques
chambre de
combustion
165 MW
électrique
air
gaz naturel
DK6
Centrale électrique
à cycle combiné
Schéma simplifié
turbine à gaz
générateur électrique
Figure 1 Description d'une tranche de production
On réalise la combustion de gaz naturel avec de l'air sous pression dans une
turbine à gaz reliée mécaniquement à un
premier générateur électrique de 165 MW. Les gaz en sortie de la turbine à gaz
servent à leur tour de comburant pour
brûler les fumées sidérurgiques dans une chaudière. Les gaz brûlés passent
enfin dans un échangeur thermique pour
produire la vapeur d'eau qui alimente des turbines à vapeur reliées à un second
générateur électrique de 230 MW. La
centrale DK6 dispose de deux tranches de production identiques pour une
puissance électrique totale de 790 MW.
Ce sujet propose une étude de la chambre de combustion de la turbine à gaz
(partie A), le principe de fonctionnement
d'une turbine à vapeur (partie B) et la conversion d'énergie mécanique en
énergie électrique par un alternateur
synchrone (partie C). Les trois parties sont indépendantes entre elles.
Les données sont regroupées à la fin du sujet. Un document réponse est à rendre
avec la copie.
1 / 14
Partie A La chambre de combustion de la turbine à gaz
La chambre de combustion de la turbine à gaz est alimentée par un gazoduc qui
fournit du gaz naturel avec un débit
massique constant Dm,gn = 9,66 kg · s-1 , sous une pression de 12 bar et une
température T0 = 298 K. On assimile
dans la suite le gaz naturel à du méthane pur (CH4 ). Le dioxygène nécessaire à
la combustion est apporté par de l'air
atmosphérique, comprimé sous une pression de 12 bar à la température de 298 K
par un compresseur solidaire de l'axe
de la turbine, avec un débit massique réglable noté Dm,air .
Le réacteur, parfaitement calorifugé, permet ainsi la combustion en continu et
en régime stationnaire du méthane
par le dioxygène de l'air à la pression constante de 12 bar. Les gaz issus de
cette combustion sortent du réacteur à
température élevée pour pouvoir faire tourner une turbine, dont le principe de
fonctionnement sera étudié dans la
partie suivante. Les aubes de la turbine sont recouvertes d'une fine couche de
traitement en céramique qui les protège
jusqu'à des températures de l'ordre de 1600 C.
Q1. Écrire l'équation bilan de la combustion du méthane par le dioxygène,
sachant que la réaction ne produit que
de l'eau et du dioxyde de carbone sous forme gazeuse. On prendra un coefficient
stoechiométrique unitaire pour
le méthane.
Montrer que cette réaction est quantitative à 298 K puis calculer le pouvoir
calorifique inférieur (PCI) du
méthane, noté qgn , défini comme l'énergie thermique par unité de masse de
méthane libérée par la combustion
du méthane sous pression constante à 298 K.
Q2. Déterminer le débit massique d'air Dm0 permettant de réaliser la combustion
dans les proportions stoechiométriques, puis la puissance thermique Pth0
libérée par la réaction dans ces conditions.
Q3. Effectuer un bilan détaillé d'enthalpie et exprimer, en fonction de qgn et
des données, la température des gaz en
sortie de la chambre de combustion pour un débit massique d'air Dm0 . Commenter
la valeur obtenue.
Lorsque la température de la chambre de combustion dépasse 1300 C, les
constituants de l'air commencent à réagir
entre eux pour produire des oxydes d'azote. Ces oxydes d'azote, essentiellement
NO et NO2 , couramment appelés
N Ox , sont à l'origine de graves problèmes pour l'environnement et la santé.
Q4. On souhaite éviter la production et le rejet de N Ox dans l'atmosphère.
Justifier qualitativement que l'on peut
diminuer la température de sortie en modifiant le débit d'air en entrée.
Expliquer pourquoi, en pratique, le débit
massique Dm,air est choisi supérieur à Dm0 .
Q5. Exprimer le débit molaire de chaque espèce en sortie en fonction de Dm,air
, Dm0 et des masses molaires dans
le cas Dm,air > Dm0 . On présentera les résultats dans un tableau. Les débits
molaires des différentes espèces
seront notés FCH4 , FO2 ...
Q6. Exprimer, puis calculer, le débit massique d'air Dm1 permettant à la
turbine à gaz de fonctionner à sa température maximale tout en évitant la
production de N Ox .
Étant donné l'échauffement important des gaz dans la chambre de combustion, il
faut tenir compte dans le calcul
précédent de la dépendance avec la température de la capacité thermique molaire
à pression constante des différents
gaz (figure 2). La capacité thermique molaire à pression constante d'un gaz
réel peut ainsi s'exprimer de manière
empirique en fonction de la température par la relation de Shomate :
Cpm (T ) = A + BT + CT 2 + DT 3 +
E
,
T2
où les coefficients A, B, C, D et E sont obtenus expérimentalement pour chaque
gaz. La variation d'enthalpie de n
moles de gaz entre les températures T1 et T2 s'exprime alors sous forme
intégrale par la relation :
H(T2 ) - H(T1 ) =
Z T2
nCpm (T )dT .
T1
Les capacités thermiques molaires à pression constante des différentes espèces
seront notées Cpm,CH4 (T ), Cpm,O2 (T )...
Q7. Reprendre la question Q6 pour établir, dans le cas où Dm,air > Dm0 , la
nouvelle relation donnant le débit
massique d'air Dm,air en fonction de la température de sortie des gaz Ts en
tenant compte de l'influence de
la température sur les capacités thermiques molaires à pression constante, sous
forme intégrale que l'on ne
cherchera pas à calculer.
2 / 14
Figure 2 Capacités thermiques molaires de différents gaz en fonction de la
température
Pour le débit Dm,gn = 9,66 kg · s-1 et la température T0 = 298 K, le calcul
numérique de la température de sortie Ts
des gaz brûlés en fonction du débit d'air Dm,air est effectué par un programme
en Python, dont un extrait est présenté
ci-après.
1
2
3
4
' ' ' Extrait 1 ' ' '
# Coefficients A , B , C , D , E de la relation de Shomate des diff é rents gaz
N2 = [28.98641 , 1.853978 e -3 , -9.647459 e -6 , 16.63537 e -9 , 0.000117 e6 ]
H2O = [ -203.6060 , 1523.290 e -3 , -3196.413 e -6 , 2474.455 e -9 , 3.855326
e6 ]
5
6
7
8
9
' ' ' Extrait 2 ' ' '
def Cpm (T , gaz ) :
A , B , C , D , E = gaz
return A + B * T + C * T **2 + D * T **3 + E / T **2
10
11
12
13
' ' ' Extrait 3 ' ' '
def int_Cpm ( gaz , T1 , T2 ) :
[ A COMPLETER ]
14
15
16
17
' ' ' Extrait 4 ' ' '
plt . plot ( Dm , T , 'k - ' , lw =2) # Trac é du graphe de Ts en fonction de
Dm , air
plt . show ()
Q8. Préciser l'unité des coefficients A, B, C, D et E. Proposer un code Python
permettant d'implémenter la fonction int_Cpm(gaz, T1, T2) qui prend pour
arguments la liste gaz des coefficients de la relation de Shomate
du gaz étudié et les températures T1 et T2, puis qui renvoie une valeur
numérique approchée de l'intégrale
Z T2
Cpm (T )dT obtenue par la méthode des rectangles utilisant N = 1000 points de
calcul.
T1
Le programme permet de tracer le graphe de la température de sortie des gaz en
fonction du débit d'air d'entrée
en tenant compte de la dépendance avec la température des capacités thermiques
molaires à pression constante des
différents gaz (figure 3).
3 / 14
Figure 3 Température de sortie Ts en fonction du débit massique d'air Dm,air
à l'entrée
Q9. Décrire précisément le graphe obtenu en mettant en évidence des valeurs
particulières pertinentes dont on
commentera le sens physique. Déterminer la valeur réelle du débit massique
d'air permettant de faire fonctionner
la turbine à gaz à sa température maximale sans production de N Ox et comparer
cette valeur au débit massique
Dm1 trouvé en question Q6. Ce résultat était-il prévisible ? Déterminer alors
le débit massique de gaz en sortie
de la turbine.
Q10. Estimer le rendement thermodynamique de la centrale électrique DK6.
Partie B La turbine à vapeur
pA = 144 bar
TA = 565 °C
A = 33 kg.m-3
A
pC = 30 bar
TC = 565 °C
pD = 4,0 bar
TD = 320 °C
C
D
THP
TMP
réseau
électrique
(G)
~
pB = 30 bar
TB = 330 °C
B = 11 kg.m-3
TBP
B
(SC)
pE = 30 mbar E
TE = 26 °C
(C)
eau de mer
eau liquide
à 26 °C
e = 15 °C
s
Figure 4 Circuit de vapeur dans les turbines
La turbine à vapeur est un élément essentiel du fonctionnement d'une centrale
électrique thermique ou nucléaire,
convertissant l'énergie de la vapeur sous pression en énergie mécanique. De la
vapeur d'eau arrive dans la turbine sous
haute pression et haute température et se détend à travers différents étages
comportant une succession d'aubes fixes et
d'aubes mobiles, provoquant la rotation de l'axe de la turbine à la vitesse
angulaire = 3000 tr · min-1 , et entraînant
par ailleurs le générateur électrique (G).
4 / 14
On cherche dans cette partie à évaluer précisément la puissance mécanique
transmise par le fluide à l'arbre de la
turbine et à comprendre le rôle des différents étages de détente.
La centrale électrique DK6 utilise un circuit de vapeur sèche traversant
successivement une turbine haute pression
(THP), un surchauffeur (SC), une turbine moyenne pression (TMP) et une turbine
basse pression (TBP). Les turbines
sont supposées parfaitement calorifugées et alignées sur le même axe de
rotation. Pour éviter tout phénomène de
corrosion, il ne doit jamais exister de liquide dans les turbines. En sortie de
la turbine basse pression, le fluide, alors
sous forme de vapeur juste saturante, traverse de façon isobare un condenseur
(C) à circulation d'eau de mer. Le
schéma de la figure 4 présente quelques caractéristiques de la vapeur aux
différents points notés A, B, C, D et E du
circuit. Le débit massique de vapeur dans le circuit doit être contrôlé et vaut
Dm = 534 × 103 kg · h-1 .
Le sujet est accompagné d'un document réponse contenant le graphe de
l'enthalpie massique de l'eau en fonction
de son entropie massique, appelé diagramme de Mollier, sur lequel figurent
également les courbes isobares, isothermes,
isotitres et la courbe de saturation du mélange liquide-vapeur.
La centrale est étudiée en régime stationnaire.
I Étude globale de la turbine
Q11. Placer les points A, B, C, D et E - dont la pression et la température
sont données sur la figure 4 - sur le
diagramme de Mollier du document réponse et représenter l'évolution de la
vapeur dans le circuit depuis l'entrée
de la turbine haute pression jusqu'à la sortie de la turbine basse pression.
La vapeur entre dans un premier temps dans la turbine haute pression, dont les
caractéristiques géométriques sont
précisées sur le document 1, en fin de sujet.
Q12. Montrer en utilisant le diagramme de Mollier que la détente à travers la
turbine haute pression peut être
considérée comme isentropique. Déterminer la température que l'on obtiendrait
en sortie de la turbine haute
pression si la vapeur était un gaz parfait. Discuter la validité de l'hypothèse
du gaz parfait dans ces conditions.
Q13. Déterminer l'expression puis la valeur de la vitesse débitante vA de la
vapeur à l'entrée de la turbine haute
pression. En déduire la valeur de la vitesse vB en sortie si la turbine gardait
un diamètre constant. Justifier la
nécessité de conserver une vitesse débitante à peu près constante dans la
turbine. Indiquer comment réaliser
cette condition en pratique.
Q14. Évaluer la puissance mécanique transmise à l'axe de rotation par la vapeur
d'eau dans la turbine haute pression.
Q15. Calculer la puissance mécanique maximale transmise à l'axe de rotation si
l'on utilisait une unique turbine
réalisant une détente isentropique ?
Afin d'augmenter la puissance transmise à l'axe, on utilise à la fois un
surchauffeur, qui permet de réchauffer la vapeur,
et plusieurs turbines.
Q16. Déterminer la puissance thermique fournie par le surchauffeur, puis
calculer la puissance mécanique totale
transmise à l'axe de rotation en considérant l'ensemble du circuit de vapeur,
constitué des trois turbines ainsi
que du surchauffeur. Commenter la valeur numérique obtenue.
Dans la turbine moyenne pression (et à plus forte raison dans la turbine basse
pression), la pression plus faible de la
vapeur impose d'avoir des aubes plus grandes, ce qui augmente la surface de
contact avec le fluide.
Q17. Estimer la puissance mécanique transmise à l'arbre de la turbine moyenne
pression si l'évolution de la vapeur
était adiabatique et réversible avec la même pression de sortie pD = 4 bar ? En
déduire la puissance des pertes
introduites par les frottements sur les aubes, que l'on appelle pertes
adiabatiques.
Le condenseur en sortie de la turbine basse pression utilise une circulation
d'eau de mer avec un débit volumique
constant Q = 33.103 m3 · h-1 . L'eau de mer est prélevée à une température
moyenne e = 15 C, puis rejetée en milieu
naturel.
La réglementation impose de rejeter l'eau de mer avec une température maximale
de 30 C pour ne pas perturber
les écosystèmes marins. On suppose que toute la vapeur sortant de la turbine se
liquéfie de manière isobare dans
l'échangeur thermique parfaitement calorifugé.
Q18. Établir la relation donnant la température s de l'eau de mer rejetée par
le condenseur en fonction des données
utiles. Calculer s puis commenter la valeur numérique obtenue.
5 / 14
II Étude d'un étage de détente de la turbine haute pression
Afin de réduire les contraintes mécaniques exercées sur les aubes en rotation,
la vapeur est détendue progressivement
à travers une dizaine d'étages successifs dans chaque turbine. Chaque étage
comporte un stator avec N = 80 aubes
fixes, qui agissent comme des tuyères en augmentant la vitesse de la vapeur, et
un rotor constitué de 80 aubes en
rotation qui convertissent toute ou partie de l'énergie cinétique de la vapeur
en travail mécanique.
Les aubes de la turbine haute pression, réparties autour de l'axe de rotation
de rayon R0 , sont très courtes comparées
aux aubes des turbines moyenne et basse pression. On suppose donc que, dans
toute la turbine haute pression,
l'écoulement du fluide, supposé stationnaire, se fait dans une couche de faible
épaisseur a autour de l'arbre de rotation
et que la vapeur se comporte comme un gaz parfait en évolution isentropique.
On s'intéresse ici à l'étage d'entrée de la turbine haute pression que l'on se
propose de modéliser sur le principe d'une
turbine à réaction (figure 5).
2ème étage
1er étage
Entrée de la turbine
b
b
e
Stator
(aubes fixes)
Rotor
(aubes mobiles)
Stator
(aubes fixes)
Figure 5 Principe d'une turbine à réaction
", accélère dans le stator jusqu'à la vitesse
Au premier étage de la turbine haute pression, le fluide entre à la vitesse v# A
#"
#"
v1 , transmet un couple moteur au rotor et ressort de l'étage à la vitesse v2 ,
les vitesses étant définies ici par rapport
au stator.
Q19. Établir un critère qualitatif portant sur des durées caractéristiques
permettant de justifier que l'évolution du
fluide dans le stator est bien adiabatique. On admettra dans la suite que ce
critère est largement vérifié.
Au cours du passage de la vapeur à travers les aubes fixes du stator du premier
étage de détente, la pression du fluide
varie de p1 = p1 - pA = -7,3 bar.
Q20. Exprimer, au premier ordre en p1 , la variation de température T1 = T1 -
TA du fluide entre l'entrée et la
sortie du stator. En appliquant le premier principe des systèmes ouverts dans
le stator, déduire les expressions
puis les valeurs numériques de la variation de température T1 et de la vitesse
v1 de la vapeur à la sortie du
stator du premier étage de détente de la turbine haute pression.
La vapeur, ainsi aspirée à travers le stator, gagne de la vitesse et arrive
dans le rotor face aux aubes en rotation autour
#"
de l'axe principal à la vitesse angulaire = e#"z . La vitesse d'entrée du
fluide par rapport à une aube en mouvement
#"
#"
# " = v#" - U
est donnée par la loi de composition des vitesses w
où U = R0 e#" désigne la vitesse locale de déplacement
1
1
de l'aube située à la surface de l'arbre de rayon R0 . Dans une turbine à
réaction, la géométrie et l'orientation des
6 / 14
# " = w e#" . La relation géométrique entre
aubes permettent d'obtenir une vitesse relative d'entrée axiale, de la forme w
1
1 z
#"
#"
#
"
v1 , w1 et U est connue par les ingénieurs turbiniers comme étant le triangle
des vitesses (figure 6). On note l'angle
# ".
entre v#"1 et w
1
(a)
(b)
Figure 6 Triangle des vitesses (a) en entrée du rotor et (b) en sortie du
rotor
Dans une première approche, on peut considérer que le fluide agit sur chaque
aube comme sur une aile d'avion. On a
reporté sur le document 2 les caractéristiques aérodynamiques d'une aile de
profil similaire à celui d'une aube du rotor
obtenues par simulation numérique. On appelle CL (respectivement CD ) le
coefficient de portance (respectivement de
1
traînée) de l'aile intervenant dans la force de portance d'intensité CL Sv 2
(respectivement dans la force de traînée
2
1
CD Sv 2 ), où désigne la masse volumique du fluide, S la surface portante de
l'aile et v la vitesse relative du fluide
2
par rapport à l'aile.
Dans la configuration étudiée, le nombre de Reynolds vaut 6.106 et l'angle
d'inclinaison vaut 15 .
Q21. Justifier la valeur de l'angle d'inclinaison choisi. À l'aide d'une
démarche que l'on présentera avec soin, estimer
la puissance mécanique transmise par le fluide au premier étage de la turbine
haute pression, ainsi que le nombre
n d'étages de détente, et évaluer la force axiale exercée sur le rotor. On
utilisera les données du document 1.
En fait les ingénieurs tiennent comptent dans leurs calculs du changement de
direction de l'écoulement du fluide entre
# " la vitesse relative du fluide en sortie d'aubage et v#" cette même
l'entrée et la sortie du rotor. On appelle ainsi w
2
2
vitesse mesurée par rapport au stator.
La forme des aubes utilisées impose une vitesse de sortie v#"2 axiale de la
forme v#"2 = v2 e#"z avec = , en notant
# ".
l'angle entre v#" et w
2
2
fluide à l'instant t
fluide à l'instant t + dt
volume commun
Figure 7 Système constitué du fluide entre deux aubes du rotor entre t et t +
dt
Q22. On considère le système constitué du fluide circulant en régime
stationnaire entre deux aubes du rotor entre les
instants t et t + dt (figure 7). Effectuer pour ce système un bilan précis de
moment cinétique par rapport à l'axe
de rotation et déterminer le couple mécanique exercé par tout le fluide sur le
rotor du premier étage en fonction
de Dm , R0 et U . En déduire que la puissance mécanique transmise au rotor
s'écrit Dm U 2 et faire l'application
numérique.
Le modèle de la turbine à réaction ne rend pas tout à fait compte de la forme
réelle des aubes d'une turbine à haute
pression. En pratique, on définit le degré de réaction d'un étage de turbine
par le rapport de la variation d'enthalpie
massique du fluide à travers le rotor sur la variation d'enthalpie massique à
travers l'étage { stator + rotor }. Le degré
de réaction varie d'ailleurs généralement d'un étage à l'autre selon la taille
et l'orientation des aubes. Dans une turbine
à action parfaite, le degré de réaction est nul ( = 0) et le travail mécanique
massique utile reçu par le fluide à travers
un étage vaut -2U 2 .
7 / 14
On modélise désormais la turbine haute pression par une turbine à action
parfaite constituée de n étages de détente
identiques et on suppose que la chute d'enthalpie massique du fluide à travers
la turbine se répartit équitablement
entre les différents étages.
Q23. Déterminer le nombre d'étages n de détente contenus dans la turbine haute
pression.
Q24. Calculer la puissance mécanique totale réellement transmise à l'arbre à
travers tous les étages de la turbine
haute pression. Commenter.
Partie C Le générateur électrique
Le générateur entraîné par l'ensemble des trois turbines THP, TMP et TBP est
une machine synchrone triphasée
fonctionnant en alternateur.
Cette partie étudie le modèle d'un alternateur diphasé équivalent dont les
caractéristiques au point nominal sont identiques à celles du modèle triphasé
(Génératrice ALSTOM type 50WY23Z-109). Ces caractéristiques sont rassemblées
dans un tableau figurant en fin de sujet.
On rappelle que toutes les grandeurs fournies relativement à des signaux
sinusoïdaux sont données en valeurs efficaces.
On supposera que l'alternateur est une machine à pôles lisses taillée dans un
matériau ferromagnétique idéal. L'entrefer
étant de très faible épaisseur par rapport au rayon r du rotor, on supposera
que tous les points de l'entrefer sont à
la distance r de l'axe de rotation de la machine et repérés en coordonnées
cylindriques (O, e#"r , e#" , e#"z ) où O se situe au
centre de la machine et appartient à l'axe de rotation (Oz) du rotor.
I Paramètres de l'alternateur
Q25. Attribuer le caractère continu ou sinusoïdal aux courants circulant dans
le stator et dans le rotor. Décrire
l'organisation spatiale des circuits statorique et rotorique.
Q26. Rappeler l'expression de la puissance moyenne délivrée par les circuits
statoriques. En déduire la valeur de la
tension nominale aux bornes de chaque phase.
Q27. Rappeler les propriétés d'un matériau ferromagnétique idéal. Déterminer la
direction du champ magnétique en
un point M de l'entrefer.
Donner, en justifiant, la relation entre la pulsation des courants et la
vitesse de rotation du rotor.
Déduire la valeur numérique en rad · s-1 puis en tr · min-1 de n , vitesse de
rotation du rotor en fonctionnement
nominal.
Q28. Le schéma électrique d'une phase en fonctionnement alternateur
est représenté en figure 8. On note R et X respectivement la
résistance et la réactance synchrone du bobinage d'une phase
définie par X = L où L désigne son inductance propre. En
fonctionnement alternateur, écrire l'équation électrique relative
à une phase faisant apparaître R et X ; on notera respectivement
E, U et I les représentations complexes de la force électromotrice,
de la tension aux bornes de la phase et de l'intensité du courant
circulant dans la phase.
Figure 8 Schéma électrique d'une phase
Afin de déterminer les paramètres de l'alternateur, on dispose de deux essais
expérimentaux au cours desquels le rotor
est entraîné par un moteur extérieur à la vitesse nominale n :
· un essai à vide dans lequel on relève la tension U aux bornes d'une phase en
fonction du courant d'excitation Ie ;
· un essai en court-circuit dans lequel on court-circuite chaque phase et on
relève Icc , l'intensité circulant dans une
phase en fonction du courant d'excitation Ie .
Les deux courbes obtenues sont représentées en figure 9.
Q29. En utilisant les résultats des deux essais, montrer que E = kIe avec k =
25,6 . Calculer la valeur de X et
commenter.
8 / 14
On s'intéresse à présent au fonctionnement nominal de l'alternateur dont les
caractéristiques sont données dans le
tableau. On considère que la charge nominale impose un retard du courant par
rapport à la tension.
Q30. Représenter l'allure du diagramme de Fresnel associé à l'équation
électrique d'une phase obtenue en question
Q28 en adoptant la tension U pour origine des phases. En déduire l'expression
ainsi que la valeur de E puis la
valeur de Ie . On parle, dans cette situation, de chute de tension en charge.
Interpréter.
Figure 9 Courbes issues des essais à vide (à gauche) et en court-circuit (à
droite)
9 / 14
II Raccordement au réseau - compensateur synchrone
L'alternateur fournit de la puissance électrique au site industriel où il se
trouve mais peut aussi être raccordé au réseau
électrique qui impose la tension aux bornes des phases de l'alternateur et une
fréquence constante. Une fois couplé à
un grand réseau, un alternateur fait partie d'un système comprenant des
centaines d'autres alternateurs. Il est alors
impossible de préciser la nature de la charge électrique branchée aux bornes de
cet alternateur en particulier.
On étudie ici les échanges de puissance entre l'alternateur et le réseau. Dans
toute la suite, on néglige R devant X
ainsi que toutes les pertes énergétiques. On considère de plus que les turbines
imposent un couple constant au rotor
de l'alternateur. L'alternateur est raccordé au réseau qui impose une tension
Un constante.
L'alternateur, alimenté par le courant d'excitation Ie , échange de la
puissance avec le réseau et reçoit de la puissance
mécanique de la part des turbines. On note I la représentation complexe de
l'intensité du courant de phase. Le fonctionnement n'est pas nécessairement
nominal. Le facteur de puissance vaut cos() où =Arg(U )-Arg(I) représente
le retard algébrique de phase du courant par rapport à la tension.
La figure 10 présente le diagramme de Fresnel d'une phase de l'alternateur
raccordé au réseau dans le cas où > 0.
Figure 10 Diagramme de Fresnel de l'alternateur connecté au réseau dans le
cas > 0
Q31. Justifier que la puissance P délivrée par l'alternateur est imposée et
reste constante. Montrer que la longueur du
segment O A sur la figure 10 est proportionnelle à P et préciser l'expression
de la constante de proportionnalité.
En déduire le lieu des points M relatifs au fonctionnement de l'alternateur.
Comment peut-on en pratique agir
sur les paramètres de l'alternateur pour déplacer le point M dans ces
conditions ?
Q32. Montrer qu'il existe un point de fonctionnement M de l'alternateur
délivrant la même puissance avec le même
courant de phase I que le point M . Préciser la relation liant les phases et
correspondantes. Déterminer
alors l'expression puis la valeur E de E permettant d'obtenir le point M ,
ainsi que le courant d'excitation Ie .
Sur le document réponse est reporté un réseau de courbes nommées courbes de
Mordey donnant l'évolution du
courant statorique I en fonction en fonction du courant d'excitation Ie pour un
fonctionnement de l'alternateur à
puissance moyenne constante.
Q33. Reporter, directement sur la figure 2 du document réponse, les positions
des deux points M et M associés au
fonctionnement de l'alternateur à sa puissance nominale Pn sur le réseau de
courbes de Mordey.
Retrouver graphiquement les valeurs de E et E correspondant aux points de
fonctionnement M et M de
l'alternateur à sa puissance nominale Pn . Quelle est alors la relation entre
les phases et correspondantes ?
Un réseau électrique doit fournir une tension stable malgré la présence d'un
grand nombre d'utilisateurs et la variété
des utilisations. Afin de maintenir certaines constantes du réseau malgré les
irrégularités d'utilisation, on utilise les
machines synchrones en mode compensateur synchrone dans un but de régulation.
Elles sont alors connectées au réseau en tournant à vide, sans être entraînées
par un actionneur extérieur.
Q34. Adapter le diagramme de Fresnel de la figure 10 afin de déterminer les
deux valeurs de possibles lorsque
l'alternateur tourne à vide sans entraîner de charge mécanique et sans recevoir
de puissance mécanique.
In
, en prenant X = 2,3 .
Déterminer les valeurs de E correspondantes dans le cas particulier où U = Un
et I =
10
Préciser pour laquelle de ces deux valeurs, la machine se comporte comme un
condensateur.
10 / 14
Documents
(a) Vue en coupe de la turbine HP de DK6
(source : ALSTOM tous droits réservés)
Entrée de la
vapeur
a = 41 mm
a' = 113 mm
R0 = 296 mm
R0
(b) Détail de la turbine HP. La vapeur circule entre
les aubes des différents étages de détente
a = 41 mm
(d) Un étage de détente est constitué
d'un stator et d'un rotor
(simulation numérique)
(c) Géométrie d'une aube
de l'étage d'entrée
Document 1 : caractéristiques de la turbine haute pression
11 / 14
Profil NACA 6412 et maillage utilisé pour la simulation numérique
CL : coefficient de portance (lift coefficient) ; CD : coefficient de traînée
(drag coefficient)
i : angle d'inclinaison de l'aile
Document 2 : caractéristiques aérodynamiques du profil NACA 6412
(source : http://airfoiltools.com )
12 / 14
Données
Nombre d'Avogadro : NA = 6,02.1023 mol-1
Constante des gaz parfaits : R = kB NA = 8,31 J · K-1 · mol-1
Masses molaires : M (H) = 1,0 g · mol-1 , M (C) = 12,0 g · mol-1 , M (O) = 16,0
g · mol-1 , M (N) = 14,0 g · mol-1
4
1
L'air atmosphérique est constitué à de diazote et à de dioxygène en proportions
molaires.
5
5
Enthalpie standard de formation et entropie molaire standard à 298 K :
Espèce
CH4(g)
CO2(g)
)
-74,9
-393,5
Sm
( J · K-1 · mol-1 )
186,2
213,8
f H ( kJ · mol
-1
O2(g)
H2 O(g)
-241,8
205,0
188,7
Capacités thermiques molaires à pression constante à 298 K :
Espèce
CH4(g)
CO2(g)
CO(g)
O2(g)
N2(g)
H2 O(g)
H2(g)
Cpm (J · K-1 · mol-1 )
35,7
37,1
29,1
29,4
29,1
33,6
28,8
Masse molaire de l'eau : M = 18,0.10-3 kg · mol-1
Rapport des capacités thermiques de la vapeur d'eau : = 1,30
Capacité thermique massique de l'eau liquide : ceau = 4,18 kJ · K-1 · kg-1
Masse volumique de l'eau liquide : eau = 1,00.103 kg · m-3
Capacité thermique massique à pression constante de la vapeur d'eau assimilée à
un gaz parfait : cp = 2,00 kJ · K-1 · kg-1
Enthalpie massique de vaporisation de l'eau à 26 C : lvap = 2,30.103 kJ · kg-1
Nombre de pôles
Nombre de phases
Puissance moyenne nominale
Courant de phase statorique nominal
Facteur de puissance nominal
Fréquence nominale des courants
Courant d'excitation rotorique nominal à vide
Tension d'excitation rotorique nominale à vide
Résistance par phase
Fin
13 / 14
2
2
Pn = 240 MW
In = 11,1 kA
0,85
f = 50 Hz
Ien = 498 A
Uen = 92 V
0,9
P079 - 2025-04-29 - 11:27:19 c b e a
Caractéristiques de l'alternateur diphasé au point nominal :
0,3
0
0,4
0
2,0
p=
p=
p=
3,0
p=
1,0
p=
0,8
0
p=
0,6
0
15
p=
p=
1,5
20
p=
4,0
p=
30
p=
p=
10
p=
8,0
p=
6,0
40
p=
150
p=
p=
3800
p=
0
0,1
80
0,0
=
p 0
6
0,0
=
p
40
0,0
=
p 0
3
0,0
p=
20
0,0
=
p
3400
Enthalpy [kJ/kg]
5
0,1
p=
3600
3200
300
3000
250
200
2800
150
100
2600
1,00
50
2400
0,90
2200
0,80
4,00
0,50
1800
0,60
0,4
0
2000
5,00
0,70
6,00
7,00
8,00
Entropy [kJ/(kg K)]
Figure 1 Diagramme de Mollier de l'eau
9,00
800
750
0,2
0
4000
p=
p=
200
T in [°C]. p in [Bar]
100
p=
80
p=
60
R718 Ref :W.C.Reynolds: Thermodynamic properties in SI
p=
4200
10,00
700
650
600
550
500
450
400
350
Figure 2 Évolution du courant statorique en fonction du courant d'excitation
à puissance constante
