Centrale Maths 2 PSI 2020
| Thème de l'épreuve | Les fonctions de Lambert |
| Principaux outils utilisés | Fonctions de la variable réelle, probabilités, séries entières, suite de fonctions |
| Mots clefs | fonction réciproque, inéquation, inégalié de Markov, produit de Cauchy, convergence uniforme, fonction de Lambert |
Corrigé
:👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
👈 l'accès aux indications de tous les corrigés ne coûte que 1 € ⬅ clique ici
👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
- - - - - - - - - - -
👈 gratuite pour ce corrigé si tu crées un compte
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Énoncé complet
(télécharger le PDF)



Rapport du jury
(télécharger le PDF)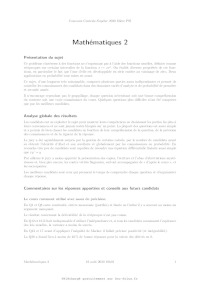

Énoncé obtenu par reconnaissance optique des caractères
Mathématiques 2
T
PSI ©
CONCOURS CENTRALE-SUPÉLEC 4 heures Caleulatrice autorisés (CN
Les fonctions de Lambert
Objectifs
L'objet de ce problème est l'étude de différentes propriétés des fonctions de
Lambert ainsi que leur application
en probabilités.
Dépendance des parties
Les fonctions Vet W définies dans la partie I sont utilisées dans les parties
IT, IIT et IV. Les parties IT, III et IV
sont indépendantes les unes des autres.
Notations
n
Pour des entiers k et n avec 0 < k < n, le coefficient binomial « k parmi n » est noté | 1) : Lorsque k < n, [k,n] représente l'ensemble des nombres entiers compris, au sens large, entre k et n. I Fonctions de Lambert Dans cette partie, on définit les fonctions de Lambert et on étudie certaines de leurs propriétés. On considère, dans toute cette partie, l'application f: R -- R * [x he" Q 1. Justifier que l'application f réalise une bijection de l'intervalle [--1, +o{ sur l'intervalle [--e-t, +00. Dans la suite du sujet, la réciproque de cette bijection est notée W. On rappelle que ceci signifie que, pour tout réel x > --e !, W(x) est l'unique solution de l'équation f(t) = x (équation
d'inconnue t EUR [---1, +/).
Q 2. Justifier que W est continue sur [--e-!, +oo[ et est de classe C® sur
]-e"!, +oof.
Q 3. Expliciter W(0) et W"(0).
Q 4. Déterminer un équivalent de W(x) lorsque x -- 0 ainsi qu'un équivalent de
W(x) lorsque x -- +oo.
Q 5. Tracer, sur le même dessin, les courbes EUR; et Cy, représentatives des
fonctions f et W. Préciser les
tangentes aux deux courbes au point d'abscisse 0 ainsi que la tangente à © au
point d'abscise --e"{.
Q 6. Pour quelles valeurs du paramètre réel a la fonction x H x*W(x) est-elle
intégrable sur ]0, 1] ?
Q 7. Pour quelles valeurs du paramètre réel a la fonction x + x*W(x) est-elle
intégrable sur [1, +oo![ ?
Q 8. Démontrer que l'application f réalise une bijection de l'intervalle
]Ï---c, --1] sur l'intervalle [-e"!, 0[.
Dans la suite du sujet, la réciproque de cette bijection est notée V.
Q 9. Pour un paramètre réel m, on considère l'équation d'inconnue x EUR R
ze? = m (L.1)
Déterminer, en fonction de m, le nombre de solutions de (1.1). Expliciter les
solutions éventuelles à l'aide des
fonctions V'et W.
Q 10. Pour un paramètre réel m, on considère l'inéquation d'inconnue zx EUR R
ze? 0. On note X le nombre de billets gagnants tirés au cours d'une journée et
on admet que X est également
une variable aléatoire.
Pour que l'opération soit rentable, le commerçant souhaite que la probabilité
de gagner au moins deux lots
durant la même journée soit faible. On considère donc un réel & EUR |0, 1] et
on souhaite réaliser la condition
P(X >2)<1-- a. (IL.1) Cependant, pour que l'opération intéresse les clients, le commerçant souhaite également que » soit le plus grand possible, tout en réalisant la condition (IL.1). Q 12. Démontrer que ZX suit une loi de Poisson de paramètre Ap. Donner l'espérance et la variance de X. -- à , alors la condition (IL.1) est satisfaite. 1 Q 13. En utilisant l'inégalité de Markov, démontrer que si p < 2 Q 14. On pose x = --(Àp + 1). Démontrer que la condition (IL.1) est équivalente à la condition re? <--ae |. Q 15. En utilisant l'une des fonctions V et W (définies dans la partie I) et la question 10, discuter selon la position de À par rapport à --1 -- V(--ae !) l'existence d'un plus grand réel p EUR ]0,1| satisfaisant la condi- tion (IL.1). II. B --- Deuxième situation Un message constitué d'une suite de bits est transmis sur un canal. Cependant, ce canal n'est pas fiable : chaque bit risque d'être inversé, indépendamment des autres, avec la probabilité 1 -- p EUR |0,1[. Pour fiabiliser la transmission, on découpe le message et on transmet des blocs de r bits. Chaque bloc comprend à la fois des bits du message d'origine et des bits supplémentaires qui permettent de détecter et corriger une erreur. On note X le nombre d'inversions survenues lors de la transmission d'un bloc de r bits et on admet que X est une variable aléatoire. Pour que la transmission soit suffisamment fiable, on souhaite que la probabilité qu'il y ait au moins deux erreurs dans un même paquet soit faible. Plus précisément, on considère a EUR [0,1[ et on veut réaliser la condition PIX >2)<1--a (IL.2) Pour que le codage soit efficace, on souhaite de plus que 7 soit le plus grand possible, tout en réalisant la condition (11.2). Q 16. Déterminer la loi de X, son espérance et sa variance. 1 -- Q 17. En utilisant l'inégalité de Markov, démontrer que si r < 2 --, alors la condition (II.2) est satisfaite. p In(p) p -- 1 Q 18. On pose a -- et x = rIn(p)--a. Démontrer que la condition (IL.2) est équivalente à la condition xe L--aac "*. Q 19. En utilisant l'une des fonctions Vet W (définies dans la partie TL) et la question 10, étudier l'existence d'un plus grand entier naturel r satisfaisant la condition (IL.2). Q 20. Lorsqu'il existe, exprimer cet entier en fonction de p, a et a à l'aide d'une des fonctions V ou W. 2020-01-28 18:32:15 Page 2/4 CO) 8Y-Nc-sA IIT Développement en série entière Le but de cette partie est d'établir que la fonction W définie dans la partie I est développable en série entière et de préciser son développement ainsi que son rayon de convergence. Pour cela, on commence par établir un résultat de nature algébrique. IIT.ÀA -- Le théorème binomial d'Abel On considère dans cette partie un entier naturel n ainsi qu'un nombre complexe a. On définit une famille de polynômes (4,,A,,...,AÀ,,) en posant 1 AA(X -- ka). A =1 et, pour tout kEUR [l,n], A, -- L On note C,,[X] le C-espace vectoriel des polynômes à coefficients complexes et de degré inférieur ou égal à n. Q 21. Démontrer que la famille (A,,..., A, ) est une base de C,,[X|. Q 22. Démontrer que pour tout k EUR [1,n], A/(X) = A4 ;(X -- a). Q 23. En déduire, pour j et k éléments de [0,n], la valeur de A) (ja). On distinguera suivant que j < k, j=kouj>k.
Soit P un élément de C,,|X] et soient ap,....,a,, des nombres complexes tels que
Tv
k=0
Q 24. Démontrer que, pour tout j EUR [0,n], a; -- PÜ)(ja).
Q 25. En déduire l'identité binomiale d'Abel :
V(a,æ,y) EUR C", (x + y)" = y" + > f.) x(x -- ka) y + ka)".
k=1
Q 26. Établir la relation.
fn
V(a,y) EUR C*, ny 1 = ka) (y + ka)" À.
(a, y) y 2 | 1). J°l(y + ka)
ITI.B --- Développement en série entière de la fonction W
On définit une suite (a,,),-, en posant,
mini
Vn EUR N", An = n)
n!
+00
On définit, lorsque c'est possible, S(x) -- > ant".
n=1l
Q 27. Déterminer le rayon de convergence À de la série entière Ù ax".
n>1l
Q 28. Justifier que la fonction S est de classe C® sur |--R, R| et, pour tout
entier n EUR N, exprimer S (a) (0)
en fonction de n.
Q 29. Démontrer que la fonction S est définie et continue sur [---R, R|.
Q 30. Démontrer que,
Vx e]-R,R|, x(1 + S(x))S'(x) = S(x).
On pourra utiliser le résultat de la question 26.
: R
On considère la fonction À : LR RL S(x)
x RH S(x)e?
Q 31. Démontrer que h est solution sur | --R, R| de l'équation différentielle
xy° -- y = 0.
Q 32. Résoudre l'équation différentielle xy° -- y = 0 sur chacun des
intervalles |0, R|, | --R, 0! puis sur l'inter-
valle |--R, R[.
Q 33. En déduire que,
Vzæe]-R,R|, S(x) = Wix).
Q 34. Ce résultat reste-t-il vrai sur [--R, R] ?
2020-01-28 18:32:15 Page 3/4 CO) 8Y-Nc-sA
IV Approximation de W
On définit dans cette partie une suite de fonctions (w,,),-, et on étudie sa
convergence vers la fonction W définie
dans la partie I.
Pour tout réel positif x, on considère la fonction ©, définie par
b.: KR -- R
lé H xexp(---xexp(--t))
et on définit, sur R, une suite de fonctions (w,,),-0 par,
x + Wo (x) -- 1
Vx EUR KR", ques = p,(w,(x))
Q 35. Démontrer que, pour tout réel positif x, W(x) est un point fixe de @,,
c'est-à-dire une solution de
l'équation ®,(t) = t.
Q 36. Démontrer que, pour tout réel positif x, la fonction ©, est de classe C°
sur R et que
VEER, 0<@'(t)< oel8 Q 37. En déduire que T TL Vrel0,e, ne, a, (æ) -- W(x)l < (©) 1 W(x)|. Q 38. Pour tout réel a EUR |0,e|, justifier que la suite de fonctions (w,,) converge uniformément sur |0, a] vers la fonction W. Q 39. La suite de fonctions (w,,) converge-t-elle uniformément vers W sur [0, el ? nm ee eFINee.e 2020-01-28 18:32:15 Page 4/4 CO) 8Y-Nc-sA
