CCINP Maths PSI 2025
| Thème de l'épreuve | Probabilités, séries de Fourier, inégalité et matrices de Hadamard |
| Principaux outils utilisés | probabilités, analyse, algèbre |
| Mots clefs | inégalités de concentration, série de Fourier, convergence simple, inégalité arithmético-géométrique, inégalité de Hadamard, matrice de Hadamard, matrices symétriques définies positives |
Corrigé
:👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
👈 l'accès aux indications de tous les corrigés ne coûte que 1 € ⬅ clique ici
👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
- - - - - - - - - -
👈 gratuite pour ce corrigé si tu crées un compte
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Énoncé complet
(télécharger le PDF)







Rapport du jury
(télécharger le PDF)
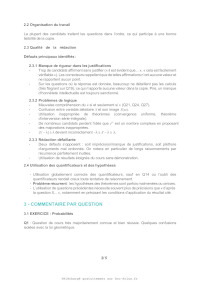

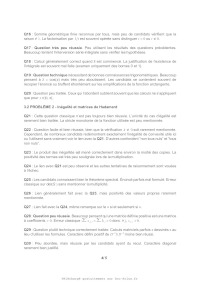
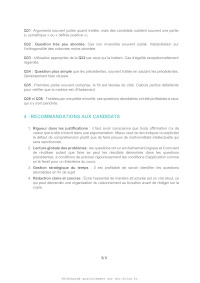
Énoncé obtenu par reconnaissance optique des caractères
SESSION 2025
PSI1M
ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE PSI
____________________
MATHÉMATIQUES
Durée : 4 heures
____________________
N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la
précision et à la concision de la rédaction.
Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur
d'énoncé, il le signalera sur sa copie
et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives
qu'il a été amené à prendre.
RAPPEL DES CONSIGNES
·
·
·
Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction
de votre composition ; d'autres
couleurs, excepté le vert, bleu clair ou turquoise, peuvent être utilisées,
mais exclusivement pour les schémas
et la mise en évidence des résultats.
Ne pas utiliser de correcteur.
Écrire le mot FIN à la fin de votre composition.
______________________________________________________________________________
Les calculatrices sont interdites.
Le sujet est composé d'un exercice et de deux problèmes indépendants.
1/8
EXERCICE
Probabilités
On considère un espace probabilisé (, T , P). Soit R+ et X : R une variable
aléatoire
qui suit la loi de Poisson de paramètre .
+
On note G X : t
P(X = n)tn la fonction génératrice de X.
n=0
L'objectif de cet exercice est d'affiner une majoration donnée par l'inégalité
de BienayméTchebychev appliquée à une loi de Poisson.
Q1. Sans démonstration, donner l'espérance et la variance de la variable
aléatoire X.
Q2. En utilisant l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, donner une majoration de
P (|X - | ).
Q3. Justifier que l'événement {X 2} est inclus dans l'événement {|X - | }.
Q4. En déduire la majoration suivante :
P(X 2)
1
.
(1)
Q5. Donner l'ensemble de définition de G X .
Q6. Montrer que pour tout t R, G X (t) = e(t-1) .
Q7. On suppose que t 1. Montrer que pour tout R, on a :
P(X )
G X (t)
.
t
Q8. En déduire que :
P(X 2)
( e )
4
.
(2)
Q9. On admet que e · (ln(4) - 1) 1,05. Quelle majoration (1) ou (2) de P(X 2)
est la plus
précise ?
2/8
PROBLÈME 1
Séries de Fourier
Dans ce problème, on introduit les notions de coefficients de Fourier réels et
de série de
Fourier d'une fonction réelle continue par morceaux et 2-périodique. On étudie
l'exemple
d'une fonction pour laquelle on calcule les coefficients de Fourier réels
(partie I) et on montre
que la fonction coïncide en tout point avec la somme de sa série de Fourier
(partie II).
Partie I - Calcul des coefficients de Fourier d'une fonction
Soit f : R R une fonction continue par morceaux sur [-; ] et 2-périodique.
Pour tout
n N, on pose :
1
1
an ( f ) =
f (t) cos(nt)dt , bn ( f ) =
f (t) sin(nt)dt.
-
-
Les réels an ( f ) et bn ( f ) sont appelés coefficients de Fourier réels de la
fonction f .
Q10. Montrer que si f est paire, alors
f (t)dt = 0.
f (t)dt = 2
-
0
f (t)dt et que si f est impaire, alors
-
Q11. Soit une fonction g : R R telle que pour tout x ]0; ] :
g(x) =
-x
.
2
Montrer qu'il existe une manière unique de définir g sur R telle que g soit
continue par
morceaux, impaire et 2-périodique sur R.
Déterminer en particulier g(0) et tracer l'allure de la courbe représentative
de g sur
[-4; 4] dans un repère orthogonal.
1
Q12. Montrer que a0 (g) = b0 (g) = 0 et que pour tout n N , an (g) = 0 et bn
(g) = .
n
3/8
Partie II - Convergence d'une série de Fourier
On appelle série de Fourier d'une fonction f : R R continue par morceaux,
2-périodique,
Un ( f ) définie à l'aide des coefficients de Fourier réels de f par :
la série de fonctions
n0
1
- U0 ( f ) est la fonction constante x a0 ( f )
2
- pour tout n N , Un ( f ) : x an ( f ) cos(nx) + bn ( f ) sin(nx) .
On admet que la série de Fourier de la fonction g définie à la question Q11
converge simplement sur R et on note S g sa somme.
D'après la question Q12 :
S g (x) =
x R,
+
sin(nx)
n
n=1
.
L'objectif de cette partie est de montrer que pour tout x R, S g (x) = g(x).
Q13. Déterminer l'ensemble des (x, t) R × [0; 1] tels que |1 - teix | = 0.
Q14. Soient (a, b) R2 tel que 0 < a < b < et x [a; b]. Montrer qu'il existe m R+ tel que pour tout t [0; 1] : |1 - teix | m . Q15. En déduire que pour tout x ]0; [, on a : 1 tn dt = 0 . lim n+ 0 |1 - teix | Q16. Soit N N . Montrer que pour tout x ]0; [ et t [0; 1], on a : N tn-1 einx = eix n=1 Q17. En déduire que pour tout x ]0; [, la série 1 0 1 - t N eiN x . 1 - teix einx n1 n converge et que l'on a : + inx eix e . dt = ix 1 - te n n=1 4/8 Pour tout ] - 1; 1[, on pose I() = 1 0 dt . t2 - 2t + 1 Q18. Justifier l'existence de I() et montrer que : ( ( ) ( )) 1- 1 arctan + arctan . I() = 1 - 2 1 - 2 1 - 2 Q19. En déduire que, pour tout x ]0; [, on a : 1 1 -x dt = . 2 sin(x) 2 0 1 - 2t cos(x) + t Q20. Conclure. PROBLÈME 2 Inégalité et matrices de Hadamard L'objectif de ce problème est d'établir l'inégalité de Hadamard reliant le déterminant d'une matrice et le produit des normes euclidiennes de ses vecteurs colonnes. Nous étudierons ensuite quelques propriétés de la famille des matrices de Hadamard qui réalisent l'égalité dans cette inégalité. Dans tout le problème, n désigne un entier supérieur ou égal à 1. On désigne par Mn (R) l'espace vectoriel des matrices carrées de taille n à coefficients réels et Mn,1 (R) l'espace vectoriel des matrices colonnes à n lignes et à coefficients réels. Pour tout (X, Y) Mn,1 (R)2 , on note X, Y = X Y le produit scalaire canonique de X et Y. Étant donné n nombres réels 1 , . . . , n , la matrice diagonale, dont les coefficients diagonaux sont formés par les réels 1 , . . . , n , est désignée par diag(1 , . . . , n ). On note S+n (R) l'ensemble des matrices symétriques positives à coefficients réels et S++ n (R) l'ensemble des matrices symétriques définies positives à coefficients réels. Partie I - Inégalité arithmético-géométrique n 1n n 1 i . Dans cette partie, nous allons Soit (1 , . . . , n ) (R ) . On pose A = i et G = n i=1 i=1 montrer que G A, avec égalité si et seulement si 1 = 2 = · · · = n . On remarque que dans le cas où 1 , · · · , n sont tous nuls, l'égalité est immédiate. On suppose donc dans la partie I que les 1 , · · · , n sont non tous nuls. + n 5/8 Q21. Montrer que pour tout x R, exp(x) 1 + x, avec égalité si et seulement si x = 0. Q22. Montrer que pour tout i 1; n : ( ) i i exp -1 . A A Q23. En déduire que G A. Q24. Montrer que G = A si et seulement si 1 = 2 = · · · = n . Partie II - Inégalité de Hadamard L'objectif de cette partie est de démontrer que pour toute matrice M = (mi, j ) Mn (R) : n n 12 m2 . | det(M)| i, j j=1 (3) i=1 Cette inégalité est appelée inégalité de Hadamard. Dans les questions Q25 à Q30, on considère S = (si, j ) S++ n (R). Q25. Justifier que S est diagonalisable dans Mn (R) et rappeler la relation qui lie det(S ) et les valeurs propres de S , puis Tr(S ) et les valeurs propres de S . Q26. En déduire que : 1 (det(S )) n 1 Q27. Montrer que (det(S )) n = 1 Tr(S ) . n 1 Tr(S ) si et seulement s'il existe > 0, tel que S = In .
n
Q28. Montrer que pour tout j 1; n, s j, j > 0.
On considère la matrice diagonale D = diag( s1,1 , . . . , sn,n ).
)
si, j
Q29. Montrer que la matrice D S D a pour coefficient général
avec (i, j) 1; n2 .
si,i s j, j
En déduire que D-1 S D-1 est symétrique définie positive et que ses éléments
diagonaux valent 1.
-1
-1
6/8
(
Q30. En utilisant la question Q29, montrer que :
det(S )
n
s j, j ,
j=1
avec égalité si et seulement si S est diagonale.
Q31. Soit M Mn (R) une matrice inversible. Montrer que M M S++
n (R).
Q32. Soit M Mn (R) une matrice qu'on ne suppose pas inversible. On note C1 , ·
· · , Cn les
colonnes de M. Déduire des questions précédentes que l'inégalité (3) est valide
pour
M, avec égalité si et seulement si les vecteurs colonnes C1 , · · · , Cn sont
orthogonaux
deux à deux pour le produit scalaire ·, ·.
Q33. Soit M = (mi, j ) Mn (R) telle que, pour tout (i, j) 1; n2 , |mi, j |
1. Montrer alors que :
n
| det(M)| n 2 ,
avec égalité si et seulement pour tout (i, j) 1; n2 , |mi, j | = 1 et M M =
nIn .
Partie III - Matrices de Hadamard
Dans cette partie, nous étudions l'ensemble Hn des matrices de Hadamard de
taille n défini
par :
{
}
Hn = M Mn (R) / M M = nIn et (i, j) 1; n2 , |mi, j | = 1 .
(
)
1 1
Par exemple, la matrice N =
est un élément de H2 .
1 -1
Notons H = {n N / Hn }. L'ensemble H n'est pas connu actuellement. L'un des
objectifs
de cette partie est de donner une condition nécessaire sur n pour que n H.
On admet que si un ensemble Hn est non vide, alors il contient au moins une
matrice de
Hadamard dont la première colonne et la première ligne sont constituées
uniquement de 1.
Soit n H et soit M Hn .
Q34. Montrer que M est inversible et déterminer M -1 . A-t-on M -1 Hn ?
(
)
M M
Q35. Montrer que la matrice définie par blocs
appartient à H2n . En déduire que
M -M
pour tout p N, 2 p H.
7/8
On suppose désormais que n > 2 et que la première colonne et la première ligne
de M ne
sont constituées que de 1.
1
1
On note C1 , · · · , Cn les colonnes de la matrice M. On a en particulier C1 =
.. Mn,1 (R).
.
1
Q36. En considérant C1 , C2 , montrer que n est pair.
Q37. On note :
x
y
z
t
=
=
=
=
Card{i 1; n, mi,2 = 1 et mi,3 = 1} ;
Card{i 1; n, mi,2 = 1 et mi,3 = -1} ;
Card{i 1; n, mi,2 = -1 et mi,3 = 1} ;
Card{i 1; n, mi,2 = -1 et mi,3 = -1}.
Exprimer C1 , C2 , C1 , C3 et C2 , C3 en fonction de x, y, z et de t.
En déduire un système linéaire de 4 équations d'inconnues x, y, z, t.
Q38. En déduire que n est un multiple de 4.
Nous venons de démontrer que :
- si n est une puissance de 2, alors n appartient à H
- si n > 2 et n n'est pas un multiple de 4, alors n n'appartient pas à H.
Hadamard a conjecturé que n H si et seulement si n est un multiple de 4.
La question est encore ouverte aujourd'hui.
8/8
I M P R I M E R I E N A T I O N A L E 25 1056 D'après documents fournis
FIN
