X/ENS Physique A PC 2025
| Thème de l'épreuve | Miroirs à retournement temporel |
| Principaux outils utilisés | physique des ondes, mécanique du point |
| Mots clefs | réflexion, transmission, Fabry-Pérot, interférométrie, retournement temporel |
Corrigé
:👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
👈 l'accès aux indications de tous les corrigés ne coûte que 1 € ⬅ clique ici
👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
👈 gratuite pour ce corrigé si tu crées un compte
- - - - - - - - - - - - - -
Énoncé complet
(télécharger le PDF)





Rapport du jury
(télécharger le PDF)
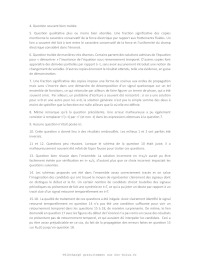
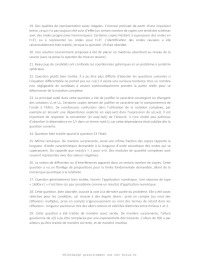

Énoncé obtenu par reconnaissance optique des caractères
ECOLE POLYTECHNIQUE ESPCI CONCOURS D'ADMISSION 2025 MARDI 15 AVRIL 2025 08h00 - 12h00 FILIERE PC - Epreuve n° 3 PHYSIQUE A (XE) Durée : 4 heures L'utilisation des calculatrices n'est pas autorisée pour cette épreuve Miroirs à retournement temporel Miroir à renversement du temps (illustration issue de [1]) Dans ce problème, on se propose d'étudier le concept de "miroirs à retournement temporel", développés sous l'impulsion du physicien français Mathias Fink. Il s'agit de faire remonter le temps et de faire vivre aux ondes leur propre passé. Ainsi, on peut créer un champ d'ondes qui revient se focaliser spatialement et temporellement sur les sources qui l'ont initialement généré. Cette propriété résulte de l'invariance par renversement du temps de la propagation. Nous montrons analytiquement comment ces expériences sont d'autant plus performantes que le milieu de propagation est complexe, c'est-à-dire présentant de multiples ondes secondaires générées lors de réexions. [1] Mathias Fink, et al., "Time-reversed acoustics," Rep. Prog. Phys., vol. 63, p. 1933 (2000). 1 Questions préliminaires de mécanique 1. On s'intéresse à une particule de masse m et de charge q soumise à un champ électrique ~ = E0 u~x . À t = 0, la particule située à l'origine a une vitesse initiale v~0 =v0 u~x . uniforme E Établir l'équation horaire ~r(t) = (x(t), y(t), z(t)) d'évolution de la particule. 2. Que devient cette équation si on inverse le sens du temps t -t ainsi que le signe de la condition initiale ? Si l'équation reste inchangée, on parle d'invariance par renversement du temps du mouvement. Est-ce le cas ? 3. Cette même particule (avec la même condition initiale que précédemment) est cette fois-ci soumise à un frottement uide (caractérisé par la constante K ) à la place du champ électrique. Établir l'équation horaire de la particule dans ces conditions. 4. A-t-on invariance par renversement du temps dans cette conguration ? 5. Expliquer la diérence fondamentale entre la force électrique et la force de frottement uide qui conduit à cette diérence de comportement vis-à-vis du renversement du temps. Mathématiquement, d'où vient cette diérence ? Ondes et renversement du temps On s'intéresse désormais au cas de l'équation d'ondes vériée par le champ d'ondes scalaire u(~r, t) dans un milieu homogène de célérité c0 en l'absence d'excitation initiale : u(~r, t) - 1 2 u(~r, t) = 0 c20 t2 (1) Renversement du temps et causalité Pour simplier le problème, on commence à une dimension avec le champ d'ondes u(x, t). 6. Supposons que u(x, t) est une solution de cette équation. Est-ce que u(x, -t) l'est aussi ? Qu'est-ce que cela signie physiquement ? 7. On place en x = 0 une source qui émet un signal temporel s(t). Cette émission donne naissance à une onde se propageant vers les x positifs et une onde se propageant vers les x négatifs, et pour des raisons de symétrie ces deux ondes doivent avoir la même amplitude. Donner la solution analytique u0 (x, t 0), dite solution causale, à ce problème en séparant les cas x > 0 et x < 0. Expliquer à quoi correspondent les diérents termes de cette solution. 8. On eectue l'opération de renversement du temps (t0 = -t). Comment s'écrit l'onde, dite non-causale, u0 (x, t0 0) ? Interpréter le résultat. Passage d'une interface 9. On considère une interface en x = 0 séparant 2 milieux de célérités respectives c1 pour x 0 et c2 pour x > 0. On suppose une onde incidente d'amplitude 1 sur cette interface depuis x = -. Elle donne naissance à une onde transmise d'amplitude t12 et une onde rééchie d'amplitude r12 comme représenté sur le schéma suivant : 2 10. Faire le schéma de la situation précédente en supposant un renversement du temps (on pensera à bien préciser les diérentes amplitudes des ondes en jeu). Combien d'ondes sont incidentes sur l'interface ? Et combien d'ondes en repartent ? 11. On note r21 et t21 les coecients de réexion et de transmission dans la situation duale de la précédente où l'onde incidente d'amplitude 1 provient de x = +. En réécrivant la situation renversée temporellement, qui a été analysée à la question précédente, comme une superposition de deux situations usuelles de transmission/réexion évaluer t21 et r21 en fonction de r12 et t12 . 12. Ces relations sont-elles vériées dans le cas d'une onde optique se propageant vers une interface entre un milieu d'indice n1 et un milieu d'indice n2 ? Miroir à retournement temporel en milieu homogène Plutôt que d'eectuer un renversement du temps intégral, on propose de fabriquer un "miroir à renversement du temps". Celui-ci consiste à enregistrer le signal reçu dans une première phase puis à réémettre en chronologie inverse ce signal. Considérations temporelles 13. Dans la première phase, notre miroir M situé en x0 > 0 enregistre le signal R(t) reçu lorsque la source S située en x = 0 émet un signal s(t). Donner l'expression de R(t). 14. Ce signal est enregistré pendant un temps T (choisi susamment long an que la totalité du signal issu de la source soit arrivé). Puis, à l'instant t = T , M réémet le signal qu'il a reçu, mais en le lisant avec une chronologie inverse (ce qui est arrivé juste avant t = T est émis quasiimmédiatement alors que ce qui avait été reçu proche de t = 0 est maintenant émis proche de l'instant t = 2T ). Dessiner sur un axe temporel allant de 0 à 2T , le signal s(t) (choisir la forme), puis le signal R(t), et enn le signal RRT (t) que va émettre le miroir à retournement temporel. 15. Donner l'expression de RRT (t) en fonction du signal s évalué à un instant t0 que l'on précisera en fonction de t, T , x0 et c0 . 16. Suite à l'émission de RRT (t) par le point M , des ondes se propagent dans notre milieu unidimensionnel, mais on ne va se concentrer que sur les ondes produites pour x x0 (on oublie les ondes partant dans la direction x ). Écrire le champ d'onde uRT (x, t) créé pour x x0 suite à l'émission de RRT (t) à nouveau en fonction du signal s évalué à un nouvel instant t0 que l'on précisera en fonction de t, T , x et c0 . 17. Que vaut le signal sRT (t) reçu en x = 0 ? Comment ce résultat est-il présenté sur la gure en début d'énoncé ? 18. Dans la situation précédente, nous n'avons pas recréé l'intégralité de la solution souhaitée. En eet, il nous faut également récupérer l'information partie en direction de x = -. Ainsi, on place un deuxième miroir à renversement du temps en x = -x0 qui émet en même temps que le miroir placé en x = x0 . Calculer le nouveau champ global uRT 2 (x, t) résultant pour -x0 x x0 . 19. On imagine que s(t) correspond à une impulsion brève (relativement à tous les autres temps en jeu dans ce problème). Représenter le champ uRT 2 (x, t) à plusieurs instants autour du temps caractéristique t = 2T . À un changement d'origine du temps près, identier les solutions causales et anti-causales présentées précédemment. 20. Que faudrait-il faire au niveau de la source pour ne recréer que la solution anti-causale (à savoir avoir un champ nul pour t 2T ). 3 Considérations spatiales Pour mieux appréhender le problème spatialement suite à ces considérations de causalité, il est utile de se placer dans un problème tridimensionnel. 21. Que devient l'équation d'ondes appliquée à u(~ r, t) pour un problème à symétrie sphérique ?i h 2 1 2 r 1 sin / 1 On rappelle la relation en coordonnées sphériques : r r2 + r2 sin + sin12 2 . 22. Que devient cette équation en régime monochromatique u(r, t) = < u(r, )e-it . 23. Déduire des solutions de cette équation l'expression analytique des ondes acoustiques mono- chromatiques convergente uc (r, ) et divergente ud (r, ). On introduira respectivement Uc et Ud les amplitudes (complexes) de ces deux ondes. 24. On place une source monochromatique en ~ r = ~0 qui génère donc une onde divergente. Cette onde est enregistrée sur une sphère (centrée sur l'origine) qui constitue notre "miroir à retournement temporel". Puis, on suppose que cette sphère émet ce champ retourné temporellement comme précédemment. La sphère génère une onde convergente qui revient vers la source initiale, mais comme précédemment cette onde ne s'arrête pas et poursuit sa route donnant naissance à une onde divergente. Ainsi, après retournement temporel le champ total est la superposition d'une onde convergente et d'une divergente. An de garantir une solution nie en r = 0, montrer qu'il existe une relation simple entre Uc et Ud qu'on exprimera. Par la suite, on note Uc = U0 . 25. Tracer le module du champ total, superposition de ces 2 ondes, en fonction de r . On précisera une longueur caractéristique. 26. Ce calcul met en évidence que la refocalisation par retournement temporel ne permet pas de revenir parfaitement sur la source initiale. De quelle limite fondamentale de la physique ondulatoire s'agit-il ? Dans quelle application la retrouve-t-on ? Contraintes expérimentales 27. Expérimentalement, on ne peut pas non plus enregistrer le champ intégral sur la sphère englobant la source initiale mais on doit enregistrer sur un réseau de capteurs discrets. Pour avoir un échantillonnage susant du champ il faut que chaque capteur corresponde à un élément 2 de surface 4 . Combien faudrait-il de capteurs pour couvrir une sphère de rayon 10 ? Miroir à renversement du temps en milieu réverbérant Pour garder les performances de la sphère mais en utilisant un miroir à retournement temporel composé d'un unique élément, l'idée est de se placer dans un milieu réverbérant plutôt que de rester en espace libre homogène. De cette manière, un récepteur unique placé en M situé dans ce milieu réverbérant ne reçoit pas seulement un trajet direct mais une superposition de signaux correspondant à tous les échos sur les parois de cette cavité réverbérante. Cavité Fabry-Pérot Commençons par le cas uni-dimensionnel mais ajoutons un peu de complexité au milieu. Pour cela, nous nous plaçons dans la situation où l'on a 2 interfaces en x = ±L. Le milieu de célérité c2 occupe l'espace -L < x < L alors que la célérité vaut c1 partout ailleurs. On reprend ainsi les coecients de transmission et réexion t12 , t21 , r12 et r21 introduits précédemment. 28. On considère une source située en x = -x0 qui émet un signal s(t). Évaluer l'expression 4 mathématique du champ R(t) reçu en M situé en x = x0 (avec x0 > L) en considérant les éventuelles multiples réexions aux diérentes interfaces. t2 avec un temps caractéristique plus court que les autres 2 2 temps en jeu. Tracer l'allure de R(t). 29. On suppose s(t) = exp - 30. Comme en espace libre précédemment, le signal R(t) est lu en chronologie inverse puis réémis après un temps T que l'on considèrera susamment long an de s'assurer que l'intégralité du signal a été reçu. Calculer le signal temporel, sRT (t), reçu en x = -x0 consécutif à cette émission en fonction de T , des coecients de réexion et transmission et s(t). En se plaçant dans les hypothèses de la question précédente, dessiner l'allure du signal. Retrouve-t-on le signal initialement émis ? 31. An de comprendre plus en détail ce qu'il s'est passé dans cette expérience impulsionnelle, il peut-être utile de regarder ce qu'il monochromatique. Imaginons que le signal n se passe en régime o émis est de la forme s(t) = < S() exp(-it) . Évaluer la réponse monochromatique R() reçue en M situé en x = x0 à la pulsation . 32. Quelles sont les fréquences de résonance de ce système ? Quelle condition vérie la longueur L à ces fréquences ? 33. À la lumière de cette réponse monochromatique, expliquer pourquoi l'expérience utilisant un miroir à retournement temporel composé d'un unique capteur dans cette conguration ne peut pas recréer le signal initial comme c'était le cas en milieu homogène. Milieu réverbérant Pour pallier ce problème, on imagine maintenant une situation bien plus complexe à 3 dimensions où la source et le miroir à retournement temporel sont situés dans un milieu présentant plus de diversité, ce qui est le cas d'une cavité réverbérante. Dans ces conditions, lorsque la source émet une impulsion brève de durée comme précédemment, on va supposer que le signal R(t) reçu en M se met sous la forme d'une succession d'impulsions : R(t) = Nt X an s(t - t0 - n ) n=0 où les an correspondent à une amplitude aléatoire comprise entre -1 et 1, t0 à un temps caractéristique avant l'arrivée du premier signal, et Nt correspond au nombre d'échos enregistrés (que l'on supposera relativement grand). 34. Par retour inverse des ondes, le signal reçu en ~ r = ~0 lorsque M émet une impulsion s(t) subit la même modication qu'à l'aller. Que vaut le signal sRT (t) reçu à l'origine lorsque M joue le rôle de "miroir à retournement temporel" ? 35. Que vaut ce signal à t = 2T ? On rappelle que les amplitudes an correspondent à des variables aléatoires à moyenne nulle, considérées indépendantes les unes des autres. 36. Que vaut le champ reçu pour tous les instants t = 2T + n ? 37. Commenter. 5
