Centrale Physique 1 PC 2025
| Thème de l'épreuve | Vitesses mécaniques et célérités des ondes |
| Principaux outils utilisés | mécanique du point, physique des ondes, mécanique des fluides |
| Mots clefs | célérité de la lumière, Mercure, Jupiter, Io, Romer, correction relativiste, axe des absides, excentricité, expérience de Fizeau, chant des dunes, ondes acoustiques |
Corrigé
:👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
👈 l'accès aux indications de tous les corrigés ne coûte que 1 € ⬅ clique ici
👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
👈 gratuite pour ce corrigé si tu crées un compte
- - -
Énoncé complet
(télécharger le PDF)








Rapport du jury
(télécharger le PDF)


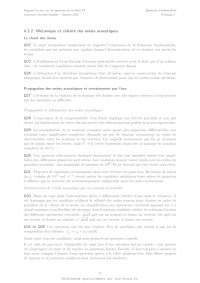

Énoncé obtenu par reconnaissance optique des caractères
PC
4 heures
Calculatrice autorisée
2025
Physique 1
Vitesses mécaniques et célérités des ondes
Bien qu'exprimées dans les mêmes unités, les notions de vitesse et de célérité
sont bien distinctes. Dans tout le sujet,
#"
on appellera vitesse (notée #"
v ou V par exemple) la grandeur cinématique associée au déplacement d'un point
ou d'un
objet matériel, tandis qu'on parlera de célérité (notée c0 , ca , . . .) pour
les grandeurs associées à la propagation des ondes
(lumineuses, acoustiques, vagues, . . .). Dans toute la suite on retiendra que
les célérités d'ondes sont des grandeurs
positives tandis que les vitesses des objets sont des grandeurs vectorielles,
chaque composante étant elle-même une
grandeur algébrique.
Ce sujet est divisé en deux problèmes totalement indépendants, dans lesquelles
les notions de vitesse et célérité
interviennent dans des contextes distincts.
Dans le problème Partie A la célérité des ondes est c0 , celle de la lumière
dans le vide et, dans l'approximation non
relativiste de la mécanique, les vitesses des objets vérifient #"
v c0 .
Dans le problème Partie B c'est la célérité ca des ondes acoustiques (dans des
milieux solides, liquides, gaz) qui est
étudiée. On rappelle ici que, dans l'approximation acoustique, les vitesses des
molécules du fluide vérifient #"
v ca .
On notera i2 = -1 ; la base cartésienne associée au repère (Oxyz) sera notée (
#"
u x , #"
u y , #"
u z ). Pour un point du plan (Oxy)
#"
on utilisera aussi les coordonnées polaires (r, ) associées au repère mobile (
u r , #"
u ). Toutes les valeurs numériques
nécessaires sont regroupées dans un tableau unique en fin d'énoncé, ainsi qu'un
formulaire mathématique.
Certaines questions, peu ou pas guidées, demandent de l'initiative de la part
du candidat. Leur énoncé est repéré par
un numéro de question souligné. Il est alors demandé d'expliciter clairement la
démarche, les choix et de les illustrer, le
cas échéant, par un schéma. Le barème valorise la prise d'initiative et tient
compte du temps nécessaire à la résolution
de ces questions.
Partie A Mécanique et célérité de la lumière
Ce problème Partie A étudie trois situations indépendantes entre elles
explorant les liens entre la célérité c0 de
la lumière (et des ondes électromagnétiques dans le vide) et les vitesses
d'objets matériels :
la partie I présente une méthode astronomique de mesure de la célérité de la
lumière dans le vide c0 , bien avant
bien sûr que celle-ci ne soit définie conventionnellement, par comparaison aux
vitesses relatives des planètes ;
la partie II étudie une manifestation d'une correction relativiste aux lois
de la mécanique céleste : les écarts de
trajectoire de la planète Mercure aux lois de Kepler du mouvement
gravitationnel ;
enfin, la partie III s'intéresse à la propagation des ondes lumineuses dans
un fluide transparent et entraîné ; il
s'agit d'une expérience de physique fondamentale datant de la fin du XIXe
siècle, peu avant la transition entre
mécanique classique et relativiste.
I La mesure de la célérité de la lumière par Rømer
On étudie d'abord un point E qui émet périodiquement un signal lumineux
isotrope aux instants tk = kT , où T est
la période d'émission et k N. Ce signal se propage avec la célérité c0 puis
est reçu au point R qui est en mouvement
rectiligne à la vitesse #"
v et s'éloigne ainsi de E (figure 1). On note tk et tk+1 les instants de
réception des signaux émis
à tk et tk+1 et dk la distance Rk E à l'instant tk .
Q1. Exprimer la distance dk+1 = Rk+1 E en fonction de dk , c0 , T et des
instants tk et tk+1 . En déduire que la réception
des signaux par R est périodique de période T et exprimer T en fonction de T
, v et c0 . Connaissez-vous le nom
usuellement donné à l'effet ainsi mis en évidence ?
1 / 10
dk
·
x
v
·
R à tk+1 : Rk+1
·
E
R à tk : Rk
Figure 1 Réception d'un signal périodique par un récepteur en éloignement
longitudinal
On considère maintenant un point E qui émet périodiquement un signal lumineux
isotrope aux mêmes instants tk = kT ;
le signal est reçu au point R en mouvement à la vitesse variable #"
v . Comme c0 #"
v on pourra admettre qu'entre
la réception des k-ième et k + 1-ième signaux le déplacement de R est quasiment
rectiligne et uniforme (figure 2). Les
#
"
instants de réception sont notés tk et tk+1 et on aura donc Rk Rk+1 #"
v (tk+1 - tk ). On choisira l'axe (Ox) de sorte
# "
#"
que Rk E = -dk u x .
y
R à tk+1 ·
dk+
vitesse #"
v
x
1
R à tk
·
dk
·
E
Figure 2 Réception d'un signal périodique par un récepteur en mouvement
arbitraire
#
"
Q2. Exprimer dk+1 = Rk+1 E en fonction de dk , des composantes vx et vy de #"
v et de l'intervalle de temps entre
réceptions, T = tk+1 - tk .
Q3. En déduire l'expression approchée, au premier ordre en v/c0 :
T =
T
1 - vx /c0
Dans cette relation, la composante vx peut être qualifiée de vitesse
d'éloignement.
L'astronome danois Rømer proposa à la fin du XVIIe siècle la première
détermination de la célérité c0 de la lumière en
mesurant la période des occultations de l'astre Io, qui est de tous les
satellites de Jupiter le plus proche de sa planète ;
il a donc une rotation rapide autour de celle-ci, avec une période de l'ordre
de 43 heures.
Jupiter est une planète assez éloignée du Soleil et par suite sa position
change peu pendant une durée aussi courte ;
la période de rotation de Io autour de Jupiter est aussi bien sûr constante.
Cependant, les moments où l'on observe
les apparitions successives de Io (correspondant à des fins d'éclipes) dans son
mouvement autour de Jupiter changent
lentement au cours du temps, du fait des variations de la distance de la Terre
à Jupiter, c'est-à-dire essentiellement
du fait de la rotation terrestre.
Ainsi, ces occultations se produisent un peu plus tôt ou un peu plus tard que
si la distance de la Terre à Jupiter restait
fixe. Le phénomène est bien sûr lié à la propagation des ondes lumineuses de
Jupiter à la Terre, et c'est ce qui a permis
la mesure de c0 .
Le tableau 1 résume les observations de Rømer, c'est-à-dire la mesure de la
durée moyenne séparant deux apparitions
consécutives de Io durant l'année 1676. Au moyen de mesures ultérieures menées
pendant huit ans, Rømer finit par
conclure que la période de ces apparitions varie annuellement avec une valeur
moyenne m = 42,46 heures et une
amplitude totale de variation = max - min égale à 22 minutes.
Début des mesures
Valeur de (heures)
13 mai
42,45
13 juin
42,54
7 août
42,50
14 août
42,48
23 août
42,63
Tableau 1 Les premières mesures de Rømer
Q4. On admettra que la Terre et Jupiter ont des orbites circulaires et
coplanaires, héliocentriques, parcourues dans
le même sens. Les données en fin d'énoncé en donnent certaines propriétés.
Exprimer puis calculer la période TJ
de révolution de Jupiter autour du Soleil.
2 / 10
On poursuit l'étude dans un référentiel qui accompagne Jupiter dans sa rotation
autour du Soleil de sorte que l'axe
SoleilJupiter est fixe, confondu avec l'axe (Ox). À l'échelle des mesures
réalisées par Rømer, on considérera que le
point E d'émission de lumière lors de l'apparition de Io derrière l'ombre de
Jupiter est confondu avec le point J qui
modélise la position de Jupiter.
Q5. Montrer que dans ce référentiel le mouvement de la Terre est circulaire
uniforme de vitesse #"
v = v 27 km/s.
Quelles sont les valeurs extrêmes et moyenne de la vitesse d'éloignement de la
Terre par rapport à E ?
Q6. En écrivant que la variation temporelle est directement liée au temps
nécessaire à la lumière pour traverser la
T0 v
distance entre Jupiter et la Terre, montrer que
; en déduire l'estimation proposée par Rømer pour
c0
c0 ; commenter.
La recherche d'un référentiel galiléen pour l'étude des mouvements des astres a
mené à en proposer deux. Le référentiel
héliocentrique, noté (RH ), a son origine au centre du Soleil et ses trois axes
pointent vers des directions réputées fixes,
définies par des étoiles lointaines. Le référentiel de Copernic, noté (RK ), a
son origine au barycentre du système solaire
et pointe vers les mêmes directions fixes.
Les lois de la gravitation de Newton, postérieures (1687) à la mesure de Rømer,
ainsi que la mesure précise (bien
postérieure) du rayon de la trajectoire de Io autour de Jupiter (voir les
données en fin d'énoncé) permettent de
comparer les masses des différents constituants du système solaire, donc aussi
les positions des centres des référentiels
de Copernic (RK ) et héliocentrique (RH ). Dans cette comparaison, on ne
tiendra compte dans ce qui suit que de la
seule planète Jupiter, la plus massive du système solaire.
Q7. Estimer le rapport des masses M du Soleil et MJ de Jupiter puis commenter,
numériquement, l'écart entre les
centres de ces deux référentiels (RH ) et (RK ).
II Les perturbations séculaires de l'orbite de Mercure
II.1 La trajectoire de Mercure selon les lois de Kepler
Mercure est la planète la plus proche du Soleil ; de plus, sa trajectoire est
fortement excentrique, caractérisée par des
distances minimale et maximale au Soleil nettement distinctes (cf. données en
fin d'énoncé). Notant (Oxy) le plan de
la trajectoire parcourue dans le sens direct, O le centre du référentiel
galiléen d'étude, le mouvement de Mercure sera
(cf. figure 3) assimilé à celui d'un point matériel M décrit en coordonnées
polaires (r, ).
y
#"
ur
·
r
#"
u
M
O
·
aphélie
x
périhélie
Figure 3 Trajectoire de Mercure selon les lois de Kepler
p
de l'équation de la trajectoire, où p et e sont des constantes positives.
1 + e cos
Exprimer puis calculer les paramètres p et e de la trajectoire de Mercure en
fonction des données rmax et rmin .
Q8. On admet alors l'expression r =
K
Q9. Exprimer l'accélération de M sous la forme #"
a = - 2 #"
u r et exprimer la constante K. Montrer que r2 = Ca ;
r
préciser le nom et le signe de la constante Ca .
Q10. On note #"
v la vitesse de M ; sur un tour, c'est une fonction #"
v () de l'angle . Montrer que le mouvement est
d #"
v
1 d #"
u
caractérisé par
=
où H est une constante positive que l'on précisera.
d
H d
3 / 10
Q11. En déduire qu'on peut, sans perdre de généralité, choisir un vecteur
constant #"
e de norme e et dirigé selon (Oy)
de sorte que H #"
v = #"
u + #"
e puis vérifier que la projection de cette relation sur #"
u permet de retrouver l'équation
C2
de la trajectoire, avec p = a .
K
II.2 Correction relativiste pour la trajectoire de Mercure
La trajectoire de Mercure est en fait perturbée par les autres planètes du
système solaire. Cependant, on sait depuis
le XIXe siècle que, même après correction de ces influences gravitationnelles,
l'axe des absides (la droite qui joint le
périhélie et l'aphélie de la trajectoire de Mercure) tourne très lentement dans
le sens direct et dans le plan de sa
trajectoire de = 42 (secondes d'arc) par siècle. Il n'est possible de rendre
compte de ce phénomène que dans le
cadre de la mécanique relativiste. Nous adopterons ici une expression corrigée
de l'accélération utilisée ci-dessus :
v2
K
#"
ur
a = - 2 1 + 2 #"
r
c0
où est une constante qui reste à évaluer, v = #"
v · #"
u est la composante orthoradiale de la vitesse et c0 est la célérité de
la lumière dans le vide. On notera qu'il s'agit toujours d'un problème à force
centrale, avec en particulier la constante
des aires Ca .
Q12. Proposer, dans le cas de Mercure, une estimation numérique du rapport v
/c0 . En déduire une estimation de
l'effet relativiste sur la rotation de Mercure, cumulé au bout d'un siècle. On
pourra supposer que reste de
l'ordre de grandeur de l'unité.
Pour tenir compte de ce qui précède, on cherche une solution des équations du
mouvement avec correction relativiste
sous la forme :
K #"
#"
v =
[ u + #"
e (t)]
Ca
et on cherche à caractériser les variations lentes du vecteur #"
e (t), appelé vecteur excentricité sous l'action du supplément
2
K v
d'accélération relativiste #"
a rel = - 2 2 #"
u r , qu'on remplacera dans tout ce qui suit par sa valeur moyenne au cours
r c0
d'une période T du mouvement keplerien (non perturbé).
K
u z #"
e et expliciter la constante A en fonction
Q13. Montrer que cette moyenne se met sous la forme #"
a rel = A #"
Ca
des données ; on pourra dans la suite admettre que A = 2,2·10-14 SI.
d #"
e
#"
= #"
e ; ce résultat est-il compatible avec la lente rotation signalée plus
dt
haut de l'axe des absides de 42 d'arc par siècle ? Le cas échéant, proposer une
valeur numérique du coefficient
. Dans le cadre de la théorie de la relativité générale d'Einstein, est un
entier.
Q14. Établir une relation de la forme
III Propagation de la lumière dans un fluide en mouvement
III.1 L'entraînement des ondes lumineuses dans l'eau
En 1851, Fizeau réalise une expérience d'interférence dans un dispositif
présentant deux tubes contenant de l'eau
en mouvement, en sens inverse. La figure 4 en présente le principe : dans deux
tubes la célérité de lumière est
respectivement dans le même sens et en sens inverse de la vitesse v de l'eau,
liquide transparent d'indice n. La source
de lumière utilisée est monochromatique, de longueur d'onde 0 (dans le vide).
v
tube 2
L
tube 1
v
Figure 4 Le principe de l'expérience de Fizeau
On notera respectivement c0 , c1 et c2 les célérités (vitesses de phase) de la
propagation de la lumière dans le vide
et dans les deux tubes, de même longueur L. On notera aussi c = c1 - c2 et cm =
c1 c2 la célérité « moyenne » ;
1
comme |c| cm on peut aussi écrire cm 2 (c1 + c2 ).
4 / 10
Q15. Exprimer la différence de temps de parcours t = t2 - t1 de la longueur L
par la lumière dans les deux tubes. En
déduire la différence de phase = 2 - 1 acquise du fait de la propagation dans
ces deux tubes en fonction
de L, 0 , c0 , cm et c.
Le but de l'expérience était de distinguer entre plusieurs modèles théoriques
de l'époque :
le modèle sans entraînement de la lumière par l'eau, avec c = 0 et cm = c0 /n
;
le modèle d'entraînement total de la lumière par l'eau, avec c = 2v et cm =
c0 /n ;
le modèle d'entraînement
partiel de la lumière, proposé par Fresnel en 1819, avec un raisonnement assez
complexe
aboutissant à c = 2v 1 - 1/n2 et cm = c0 /n.
Si le dispositif est inséré au sein d'un système interférentiel, il sera
possible de distinguer entre les différents modèles
théoriques seulement si le déplacement de N franges d'interférence (par rapport
à une situation où l'eau est immobile)
dépasse une valeur seuil Nmin qui dépend de l'expérience. On supposera que la
différence de marche au point
d'observation ne dépend que de calculé en Q15.
Q16. Quel est le déplacement N dans un modèle sans entraînement ?
Q17. Dans le cadre du modèle d'entraînement partiel, montrer que la longueur
minimale des tubes nécessaire au succès
de l'expérience est :
0 c0
.
L > Lmin = Nmin
2v(n2 - 1)
Faire et commenter l'application numérique si n = 1,33, 0 = 550 nm, v = 7 m/s
et Nmin = 0,75. Une telle
longueur suffira-t-elle pour valider ou invalider le modèle d'entraînement
total ?
III.2 Le modèle classique des vitesses d'entraînement
On peut expliciter partiellement les modèles proposés dans un cadre mécanique.
La célérité des ondes lumineuses
relativement au référentiel R lié à l'eau est #"
c ol/R = (c0 /n) #"
u x tandis que la vitesse d'entraînement de ce référentiel
relativement au référentiel du laboratoire R est #"
v e = ±v #"
u x selon le tube étudié. Les célérités cherchées #"
c 1 et #"
c2
sont alors les vitesses de la lumière relativement à R, telles qu'elles se
déduisent des lois de composition des vitesses.
Q18. Rappeler la loi de composition des vitesses de la mécanique classique. En
déduire c1 et c2 puis c et cm ; quel
modèle retrouve-t-on ainsi ?
Les mesures de Fizeau ont conclu à la validité du modèle d'entraînement partiel
de Fresnel.
III.3 Le modèle relativiste pour les ondes lumineuses dans l'eau
À partir de 1905, un modèle nouveau se substitue au précédent : celui de la
relativité restreinte. Dans ce cadre, et
toutes les vitesses étant des grandeurs algébriques dirigées par (Ox), la loi
de composition des vitesses prend la forme
(admise ici) :
ve + vM/R
vM/R =
ve ·vM/R
1+
c20
si on note vM/R (resp. vM/R ) la vitesse de M relativement au référentiel R
(resp. R ) et ve la vitesse d'entraînement
de R relativement à R.
Q19. Écrire et commenter l'expression de vM/R en fonction de vM/R et ve . Que
devient la loi d'addition relativiste
si vM/R = ±c0 ? Commenter.
Q20. On considère maintenant que vM/R = c0 /n tandis que ve = ±v avec v c0 .
Déterminer les vitesses c1 et c2
correspondantes dans R.
Q21. En déduire les expressions de c et cm . Est-il possible, dans l'expérience
de Fizeau, de distinguer le modèle
relativiste du modèle d'entraînement partiel de Fresnel ?
5 / 10
Partie B Mécanique et célérité des ondes acoustiques
Ce problème Partie B étudie deux situations totalement indépendantes entre
elles illustrant les liens entre la
célérité ca des ondes acoustiques dans divers substrats et les vitesses
d'objets matériels :
la partie I décrit le lien entre la vitesse d'avalanche des grains de sable
des dunes et les ondes sonores émises à
cette occasion : le chant des dunes ;
la partie II s'intéresse à la propagation des ondes acoustiques dans un
fluide globalement entraîné (comme par
exemple l'eau d'un courant marin océanique).
I Le chant des dunes
Le phénomène étudié ici est connu depuis très longtemps : il s'agit de
l'émission d'ondes acoustiques dans l'air qui
surmonte les dunes de sable lors de microavalanches, c'est le chant des dunes.
Des observations scientifiques réalisées
depuis la fin du XIXe siècle fournissent les résultats suivante : la fréquence
du son émis va de 60 Hz (désert) à 1 kHz
(plages) ; le chant produit lors d'écoulements disparaît lorsque le sable est
humide ou mélangé avec des poussières.
Une première interprétation est alors proposée, liant le son entendu à la
résonance des ondes acoustiques au sein des
grains de sable formant des cavités résonantes de la dimension d du diamètre
des grains de sable eux-mêmes. On
cherche à confronter ce modèle à quelques mesures récentes de fréquences
moyennes de chant et de diamètres moyens
des grains de sable (table 2, extrait de la thèse de S. DagoisBohy, 2010).
Dune
Al Wagan (Oman)
Dumont (USA)
Eureka (USA)
Mar de dunas (Chili)
Omega 1 (Maroc)
fréquence f , Hz
80 ± 3
83 ± 7
90 ± 15
97 ± 4
100 ± 5
diamètre d, µm
200 ± 70
174 ± 50
165 ± 50
168 ± 40
155 ± 20
Tableau 2 Caractéristiques du chant de quelques dunes
Q22. Rappeler la relation liant la fréquence fondamentale f1 d'oscillation
d'une corde vibrante fixée aux deux extrémités d'une cavité de longueur d en
fonction de la célérité ca de l'onde. Sachant que la célérité des ondes
acoustiques dans un solide (comme le sable) est nettement supérieure à sa
célérité dans l'air ( 350 m·s-1 à
30 C), que penser de ce premier modèle ?
Une autre interprétation de ce phénomène a été proposée au Laboratoire Matière
et Systèmes Complexes de l'université
ParisCité. Dans ce cadre une partie de l'écoulement des grains de sable de la
dune « a une vitesse homogène, comme
un bloc solide ». On décrira la dune de sable comme un empilement compact de
sphères de diamètre d, alignées en
formant un angle avec l'horizontale (figure 5, à gauche) et dont les grains de
la couche supérieure sont susceptibles
de glisser vers le bas.
z
Gi
·
d
·
#"
g
·
· Gf
O
Glissement d'une sphère
·
x
Mouvement du barycentre caractérisé par (t)
Figure 5 Modèle de glissement d'une bille sur une couche de sable
On étudie (figure 5, à droite) le mouvement de glissement sans aucun frottement
d'un grain de sable sphérique,
homogène de masse m, dont le barycentre passe de la position initiale Gi à la
position finale Gf ; il reste en permanence
au contact des grains, supposés fixes, de la couche inférieure.
6 / 10
Q23. Exprimer en fonction de m, g, d et l'énergie potentielle de pesanteur du
grain mobile. Montrer qu'il existe une
valeur minimale min de qui empêche la position initiale de former un équilibre
stable.
Q24. On ne suppose pas forcément que > min mais, sous l'influence par exemple
du vent, le grain étudié débute
en Gi un mouvement de translation circulaire de centre O avec la vitesse vi .
En l'absence de tout frottement,
déterminer sa vitesse vf lorsque le centre du grain parvient en Gf en fonction
de vi , g, d et . On pourra
remarquer que cos (a + b) - cos(a - b) = -2 sin(a) sin(b).
Q25. Avant de recommencer à tourner autour du grain suivant, l'arrivée en Gf se
traduit par un choc avec dissipation
d'une fraction de l'énergie cinétique ; ainsi la translation circulaire
suivante recommence avec vi2 = (1 - )vf2 .
Expliciter vi2 en fonction de vi2 , , g, d et et en déduire que la vitesse
d'un grain tend vers une limite vlim telle
2
que vlim
= gd où on exprimera la grandeur > 0 en fonction de et .
On suppose enfin que le mouvement des grains pendant la totalité de l'avalanche
se fait à vitesse quasiment constante
v telle que v 2 = gd. Les grains de sable heurtent alors périodiquement la
couche sur laquelle ils glissent et émettent
le son identifié comme le chant de la dune.
Q26. Expliciter la fréquence f de l'émission sonore par l'avalanche des chocs
des grains de sable. Les données de la
table 2 sont elles compatibles avec ce modèle ? Si oui, estimer la constante .
Selon vous, ce modèle reste-il
pertinent dans le cas du chant des plages ?
II Propagation des ondes acoustiques et entraînement par l'eau
On s'intéresse dans cette partie II à la propagation d'ondes acoustiques dans
l'eau, en présence du champ de pesanteur
d'intensité #"
g = -g #"
u z et d'un éventuel mouvement d'ensemble de l'eau (circulation dans une
canalisation, courant
marin. . .) de vitesse uniforme et constante #"
v 0 = v0 #"
u x . Ainsi, la pression et la vitesse dans l'eau seront caractérisées,
en notations complexes, par :
h
h
#" i
#" i
#"
v ( #"
r ,t) = v0 #"
u x + #"
v 1 exp i t - k · #"
r
p( #"
r ,t) = pst (z) + p1 exp i t - k · #"
r
où pst (z) désigne la répartition statique de pression (en l'absence d'onde)
avec, à la surface libre z = 0 de l'eau,
pst (0) = p0 = 1 bar ; on se limitera à |p1 | pst (z) et #"
v 1 v0 ca où ca désignera la célérité de l'onde ainsi
étudiée. On rappelle l'équation dynamique de NavierStokes qui lie les
évolutions de la pression p, de la vitesse #"
v et
de la masse volumique en fonction de la viscosité dynamique de l'eau :
#"
v
# "
# "
v = -grad p + #"
g + #"
v.
v ·grad #"
+ #"
t
Q27. En déduire l'expression de dpst /dz puis une forme simplifiée de
l'équation de NavierStokes.
Dans toute la suite on pourra noter les expressions complexes de la pression p(
#"
r ,t) = pst (z) + p, de la masse volumique
( #"
r , t) = 0 + et de la vitesse #"
v ( #"
r ,t) = v0 #"
u x + #"
v . Dans ces expressions, pst (z), 0 et v0 #"
u x désignent les valeurs
moyennes en l'absence d'onde tandis que p, et #"
v désignent les (petites) fluctuations de ces grandeurs dues à l'onde.
II.1 Propagation et atténuation des ondes acoustiques
Q28. Rappeler la définition de la compressibilité de l'eau en en déduire le
lien entre les fluctuations p de la pression
et de la masse volumique, en se limitant au premier ordre.
|p|
où pref = 1 µPa ; les
pref
sonars les plus puissants atteignent (exceptionnellement) IdB = 240 dB,
dépassant ainsi les chants des baleines qui
atteignent au maximum IdB = 180 dB.
Dans l'eau, l'intensité acoustique (des sonars par exemple) est mesurée par IdB
= 20 log10
On s'intéresse d'abord à la propagation des ondes acoustiques dans un fluide
parfait ( = 0) en l'absence de courant
d'ensemble (v0 = 0).
#"
#"
v = p. En déduire la célérité ca des ondes acoustiques
Q29. Établir les deux équations linéarisées 0 #"
v = k p et k · #"
dans l'eau et faire l'application numérique.
Q30. Dans le cas des ondes émises lors du chant d'une baleine près de la
surface libre de l'eau, estimer et commenter
les amplitudes des ondes de masse volumique || et de vitesse | #"
v |.
7 / 10
On cherche maintenant à connaître l'effet de la prise en compte de la viscosité
de l'eau sur la propagation des ondes
#"
acoustiques. On exprime à cet effet l'équation de dispersion donnant k 2 en
fonction de , ca et d'autres caractéristiques
#"2
#"
du fluide ( k peut être une fonction complexe). En l'absence de viscosité, k 2
= f0 (, ca ).
f0 (, ca )
#"
Q31. Montrer que k 2 =
et exprimer c en fonction de et . Proposer une interprétation simple de la
1+i
c
grandeur c et commenter sa valeur numérique.
Q32. On lit dans la littérature technique que l'atténuation des ondes
acoustiques dans l'eau est faible dans le domaine
audio basse fréquence ; à plus haute fréquence et pour les ultrasons elle
s'exprime par un coefficient d'atténuation qui s'exprime en décibel par
kilomètre. Justifier cette affirmation puis exprimer le coefficient en
fonction notamment de la viscosité de l'eau, avant de proposer un application
numérique pour deux domaines
de fréquences dont vous justifierez le choix. Comparer aux mesures effectuées
dans l'atlantique pour lesquelles
0,12 dB/km aux fréquences audio, et conclure.
II.2 Entraînement de l'onde acoustique par un courant d'ensemble
On revient ici à l'étude des ondes acoustiques dans un fluide parfait ( = 0)
mais on tient compte de la vitesse
d'ensemble de l'eau, uniforme et constante #"
v 0 = v0 #"
u x ; l'onde se propage dans une direction caractérisée par le
#"
#"
#"
vecteur d'onde réel k = k u où k > 0 et u est un vecteur unitaire. La vitesse
des courants océaniques en particulier
vérifie |v1 | v0 ca .
# "
Q33. Proposer un ordre de grandeur pour v0 , en kilomètre par heure. Expliciter
ensuite div ( #"
v ) et #"
v ·grad #"
v avec
#"
#"
#"
#"
v = v 0 + v et = 0 + en vous limitant aux termes du premier ordre en et v .
#"
#"
Q34. Montrer les deux équations 0 #"
v ( - ) = p k et k · #"
v = ( - )p et expliciter la grandeur en fonction de
#"
#"
v0 , k et u · u x = cos .
Q35. En déduire la célérité ca des ondes acoustiques en fonction de v0 , cos
et de la valeur ca obtenue dans l'eau au
repos. Peut-on parler de loi de composition des vitesses ?
8 / 10
Données numériques
Grandeur
Accélération de la pesanteur au sol
Célérité de la lumière dans le vide
Compressibilité isentropique de l'eau
Constante de la gravitation universelle
Distance moyenne JupiterSoleil
Distance moyenne JupiterIo
Distance minimale de Mercure au Soleil
Distance maximale de Mercure au Soleil
Jour (solaire moyen)
Masse du Soleil
Masse volumique moyenne de l'eau
Période de révolution terrestre (année)
Rayon moyen du Soleil
Rayon moyen de Jupiter
Seconde d'arc
Unité astronomique (distance TerreSoleil)
Viscosité dynamique de l'eau
notation
g
c0
G
dJS
dJI
rmin
rmax
24 h
M
0
T0
RS
RJ
1
a0
valeur
9,8
3,00·108
4,10·10-10
6,67·10-11
7,78·1011
4,22·108
4,60·1010
6,98·1010
86 400
1,99·1030
1,00·103
365
6,96·108
6,99·107
4,85·10-6
1,49·1011
1,20·10-3
unité
m·s-2
m·s-1
Pa-1
m3 ·s-2 ·kg-1
m
m
m
m
s
kg
kg·m-3
jour
m
m
rad
m
Pa·s
Suite arithméticogéométrique
Si un+1 = un + où || < 1, la suite réelle {un }nN tend, pour n , vers la limite u = la valeur initiale u0 . , quelle que soit 1- Quelques intégrales trigonométriques Z 2 0 cos d = Z 2 Z 2 sin d = 0 0 cos d = 3 0 Z 2 cos2 d = 0 Z 2 Z 2 sin3 d = 0 0 sin2 d = 0 Analyse vectorielle en coordonnées cartésiennes : #" #" #" #" # " #" B B B A·grad B = Ax + Ay + Az x y z Fin 9 / 10 Ay Az #" Ax div A = + + x y z #" #" # " #" div F A = F div A + grad F · A P055 - 29 avril 2025 - 11:27:30 c b e a F #" F #" F #" # " ux + uy + uz grad F = x y z
