CCINP Maths PC 2025
| Thème de l'épreuve | Endomorphisme sur l'espace des matrices, polynômes de Hermite et tirages de boules dans une urne |
| Principaux outils utilisés | algèbre linéaire, diagonalisation, espaces préhilbertiens, intégrales à paramètre, séries entières, probabilités |
| Mots clefs | matrices, produit scalaire, intégrale à paramètres, interversion série-intégrale, séries |
Corrigé
:👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
👈 l'accès aux indications de tous les corrigés ne coûte que 1 € ⬅ clique ici
👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
👈 gratuite pour ce corrigé si tu crées un compte
- - - - - - - - - -
Énoncé complet
(télécharger le PDF)







Rapport du jury
(télécharger le PDF)
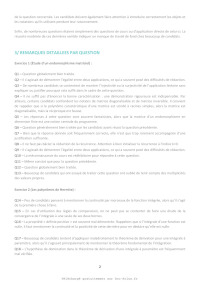
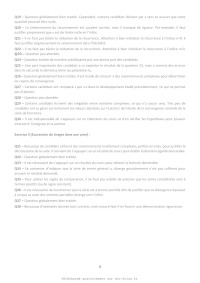
Énoncé obtenu par reconnaissance optique des caractères
SESSION 2025 PC1M ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE PC ____________________ MATHÉMATIQUES Durée : 4 heures ____________________ N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre. RAPPEL DES CONSIGNES · · · Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, bleu clair ou turquoise, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats. Ne pas utiliser de correcteur. Écrire le mot FIN à la fin de votre composition. ______________________________________________________________________________ Les calculatrices sont interdites. Le sujet est composé de trois exercices indépendants. 1/8 EXERCICE 1 Étude d'un endomorphisme matriciel Présentation générale Dans tout l'exercice, on considère un entier n N . Pour toute matrice A Mn (C) , on note A : Mn (C) Mn (C) définie par A : M AM . En particulier, on remarque qu'en notant On la matrice nulle de Mn (C) et In la matrice d'identité de Mn (C), alors On est l'application nulle de Mn (C) et In est l'application identité de Mn (C) . L'objectif de cet exercice est d'étudier quelques propriétés de l'application A . Partie I - Généralités Q1. Q2. Q3. Montrer pour tout A Mn (C) que l'application A est un endomorphisme de Mn (C) . Montrer pour tout (A, B) Mn (C)2 que A B = AB . Soit A Mn (C) . Déduire de la question précédente que A est un isomorphisme si et seulement si la matrice A est inversible. Indication : si A est un isomorphisme, on pourra considérer un antécédent par A de la matrice identité de Mn (C) . Partie II - Étude d'un exemple Dans cette partie uniquement, on suppose que n = 2 . On considère un nombre a C et la matrice : 1 1 A= M2 (C) . 0 a Q4. Q5. Q6. Q7. Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur le nombre a C pour que la matrice A soit diagonalisable. 1 0 0 1 0 0 0 0 Déterminer la matrice de A dans la base C = , , , de M2 (C) . 0 0 0 0 1 0 0 1 En déduire les valeurs propres de A , puis déterminer la dimension de chaque sous-espace propre de A en fonction de a C . Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur a C pour que A soit diagonalisable. Partie III - Réduction de A si A est diagonalisable Dans cette partie, on considère une matrice A Mn (C) . Nous allons étudier les propriétés liant les éléments propres de la matrice A et ceux de l'endomorphisme A . Q8. Q9. Montrer pour tout k N que kA = Ak . En déduire pour tout polynôme P C[X] que P(A ) = P(A) . Q10. Rappeler la caractérisation de la diagonalisabilité d'une matrice ou d'un endomorphisme à l'aide d'un polynôme annulateur. En déduire que la matrice A est diagonalisable si et seulement si l'endomorphisme A est diagonalisable. 2/8 Q11. On note A le polynôme caractéristique de A . Montrer que A (A ) est l'endomorphisme nul. En déduire une inclusion entre l'ensemble des valeurs propres de A et l'ensemble des valeurs propres de A , puis que la matrice A et l'endomorphisme A ont les mêmes valeurs propres. Q12. Soit C une valeur propre de A . Montrer qu'une matrice M Mn (C) est dans le sous-espace propre E (A ) de A pour la valeur propre si et seulement si chaque colonne de la matrice M est dans le sous-espace propre E (A) de la matrice A pour la valeur propre . On déduit directement de la question précédente que pour toute valeur propre C de la matrice A , l'application qui à toute matrice de Mn (C) associe le n-uplet de ses colonnes : m1,1 · · · : ... mn,1 · · · m1,n m1,1 m1,n .. .. , . . . , .. . . . mn,1 mn,n mn,n est un isomorphisme du sous-espace propre de E (A ) sur E (A)n . Q13. Dans le cas où la matrice A est diagonalisable, déduire des résultats de cette partie une expression du déterminant et de la trace de A en fonction du déterminant et de la trace de A . 3/8 EXERCICE 2 Les polynômes de Hermite Présentation générale On définit la suite des polynômes de Hermite dans R[X] par H0 = 1 et la relation de récurrence : Hn+1 = 2XHn - Hn . n N, L'objectif de ce problème est d'établir quelques propriétés de cette famille de polynômes. Partie I - Préliminaires Les deux sous-parties suivantes peuvent être traitées de manière indépendante. I.1 - Un produit scalaire sur l'espace des polynômes Dans cette sous-partie, on introduit un produit scalaire sur R[X]. 2 Q14. Soit n N. Montrer que la fonction t tn e-t est intégrable sur [0, +[ , puis en déduire que cette fonction est intégrable sur R . 2 Q15. En déduire pour tout polynôme R R[X] que la fonction t R(t)e-t est intégrable sur R . On déduit de la question précédente que l'on peut définir l'application : R[X]2 R par : + 2 P(t)Q(t)e-t dt . (P, Q) R[X]2 , (P, Q) = - Q16. Montrer que est un produit scalaire sur R[X] . I.2 - Calcul de l'intégrale de Gauss Dans cette sous-partie, on détermine la valeur de l'intégrale dans la sous-partie précédente. + - 2 e-t dt dont on a prouvé la convergence On considère les fonctions u : R R et v : R R définies pour tout x R par : u(x) = x 0 e -t2 dt et v(x) = 1 0 2 2 e-(1+t )x dt . 1 + t2 Q17. Justifier que u est de classe C1 sur R et donner une expression de sa dérivée. Q18. Justifier que v est de classe C1 sur R et donner une expression de sa dérivée. Q19. Montrer que la fonction x u(x)2 + v(x) est constante sur R, puis que sa valeur est Q20. En déduire que la valeur de l'intégrale + - 2 e-t dt est 4/8 . . 4 Partie II - Quelques propriétés des polynômes de Hermite Dans cette partie, on établit quelques propriétés sur la famille des polynômes de Hermite. On rappelle que la suite (Hn )nN est définie dans la présentation générale de l'exercice. 2 On considère la fonction f : x e-x . Q21. Pour tout n N , montrer que Hn est de degré n et que son coefficient dominant est 2n . Q22. Montrer pour tout n N et tout x R qu'on a f (n) (x) = (-1)n Hn (x) f (x) . On rappelle que le produit scalaire sur R[X] est défini dans la sous-partie I.1. Q23. Soit (p, q) N2 avec p q . Montrer pour tout entier k 0, q que : + q-k (q-k) H (k) (t) dt . (H p , Hq ) = (-1) p (t) f - Q24. Soit d N. Montrer que la famille (H0 , . . . , Hd ) est une base orthogonale de Rd [X]. Q25. Pour tout entier p N , calculer la norme du polynôme H p . Partie III - Série génératrice exponentielle des polynômes de Hermite Dans cette partie, on considère un nombre x R . III.1 - Expression de la série génératrice L'objectif de cette première sous-partie est de démontrer que la série entière complexe z admet un rayon de convergence infini et on calcule sa somme. Hn (x) n0 n! zn de la variable Q26. Donner les développements en série entière des fonctions z exp(2xz) et z exp -z2 sur C en précisant leur rayon de convergence respectif. Q27. Montrer qu'il existe une suite de nombres complexes (cn )nN , qu'on ne cherchera pas à détermi n cn z ait un rayon de convergence infini et que : ner explicitement, telle que la série entière n0 z C, 2 exp -(x - z) = + cn zn . n=0 2 En considérant la fonction f : t e-t introduite dans la partie II, on déduit du résultat de la question ci-dessus que l'on a l'égalité : + t R, f (x - t) = cn t n . n=0 Q28. En utilisant la relation ci-dessus et la question Q22, en déduire que la série entière admet un rayon de convergence infini et que : z C, + Hn (x) n z . exp 2xz - z2 = n! n=0 5/8 Hn (x) n0 n! zn III.2 - Expression intégrale des polynômes de Hermite Dans cette seconde sous-partie, on exploite les résultats de la sous-partie précédente afin d'établir une expression intégrale pour les polynômes de Hermite. On considère un entier p N et la fonction G x : z exp 2xz - z2 . On définit également pour tout n N Hn (x) i(n-p) la fonction gn : . e n! gn converge normalement sur l'intervalle [0, 2] . Q29. Montrer que la série n0 Q30. Montrer que : H p (x) = p! 2 2 0 6/8 G x ei e-ip d . EXERCICE 3 Succession de tirages dans une urne Présentation générale On fixe une suite (un )nN d'entiers naturels non nuls. On suppose que l'on dispose d'un stock illimité de boules blanches et on considère une urne contenant initialement une boule blanche et une boule rouge indiscernables au toucher. On procède à des tirages successifs dans cette urne en respectant à chaque fois le protocole suivant pour tout k N : 1. si la boule tirée est de couleur blanche lors du k-ème tirage, on la replace dans l'urne et on ajoute uk boules blanches supplémentaires 2. si la boule tirée est de couleur rouge lors du k-ème tirage, on la replace dans l'urne. Pour tout n N , on désigne par Bn l'évènement « la boule tirée lors du n-ième tirage est blanche » et on note : Bn . E= nN L'objectif principal de cet exercice est de déterminer une condition nécessaire et suffisante sur (un )nN pour que la probabilité de l'évènement E soit nulle. On considère également la suite (Sn )nN définie par : S0 = 1 et n N , Sn = 1 + n uk . k=1 On rappelle que si A et C sont deux évènements avec P(C) > 0, on note P(A | C) ou PC (A) la probabilité conditionnelle de A sachant C. Partie I - Probabilité de l'évènement E n Dans cette partie, on considère la suite (pn )nN définie par pn = P Bk pour tout n N . k=1 Q31. Montrer que la suite (pn )nN est décroissante. En déduire que cette suite est convergente, puis justifier que P(E) = lim pn . n+ Q32. Soit k N . Si l'évènement k Bi est réalisé, décrire la composition de l'urne en fonction de S k k juste avant d'effectuer le (k + 1)-ième tirage. En déduire la probabilité P Bk+1 Bi . i=1 i=1 Q33. Montrer pour tout n N que : pn = n-1 Sk . S +1 k=0 k 7/8 Partie II - Caractérisation de la propriété P(E) = 0 Q34. Montrer que la suite (S n )nN diverge vers + . Sk 1 Q35. Montrer que les séries ln sont de même nature. et Sk + 1 Sk 1 est divergente. Q36. Montrer que P(E) = 0 si et seulement si la série Sk Q37. Dans cette question, on suppose que un = 1 pour tout n N . Déterminer P(E) . Q38. Proposer une suite (un )nN telle que P(E) 0 en justifiant votre réponse. FIN 8/8
