CCINP Maths PC 2019
| Thème de l'épreuve | Polynômes de Laguerre et méthode de quadrature de Gauss. Étude d'une équation différentielle d'ordre 2. Étude d'une marche aléatoire. |
| Principaux outils utilisés | intégration sur un intervalle quelconque, endomorphismes symétriques, séries entières, variables discrètes |
| Mots clefs | polynômes de Laguerre, temps d'attente, quadrature de Gauss, marche aléatoire, pion |
Corrigé
:👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
👈 l'accès aux indications de tous les corrigés ne coûte que 1 € ⬅ clique ici
👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
- - - - - - - - - - - - - - - -
👈 gratuite pour ce corrigé si tu crées un compte
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Énoncé complet
(télécharger le PDF)






Rapport du jury
(télécharger le PDF)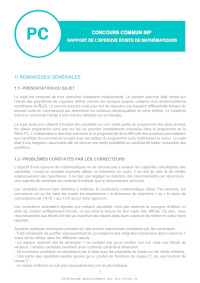


Énoncé obtenu par reconnaissance optique des caractères
SESSION 2019 PCMA002
GP
CONCOURS
COMMUN
INP
ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE PC
MATHÉMATIQUES
Lundi 29 avril: 14h-18h
N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la
précision et à la concision de
la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être
une erreur dénoncé, il le
signalera sur Sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les
raisons des initiatives
qu'il a été amené à prendre.
Les calculatrices sont autorisées
Le sujet est composé de trois exercices indépendants.
1/7
EXERCICE 1
Polynôme de Laguerre et méthode de quadrature de Gauss
Dans tout l'exercice, on considère un entier n EUR N°.
Partie I - Produit scalaire sur R, [X]
I.1 - Généralités
Pour tout couple (P,O) ER, [X}, on note :
(P | Q) = [ PHQ(r)e 'dt.
QI. Justifier que l'intégrale définissant (P | Q) est convergente.
Q2. Montrer que l'application (:- | +) : R,[X] XR,[X] -- R est un produit
scalaire.
1.2 - Calcul d'un produit scalaire
Q3. Soitke [1,7]. À l'aide d'une intégration par parties, établir que :
+00 +00
[ Fe 'dt=k [ le dt.
0 0
Q4. Conclure que (X|1)=Kk! pour tout entier k EUR [0, n]|.
Partie II - Construction d'une base orthogonale
On considère l'application « définie sur R,[XT] par :
VPER,IXL a(P)=XP'+(1-X)P"'.
IL.1 - Propriétés de l'application «
Q5. Montrer que « est un endomorphisme de R,[X|.
Q6. Écrire la matrice de & dans la base (1,X,...,X7).
Q7. En déduire que a est diagonalisable et que Sp(a) = {---k]k EUR [0, nr}.
2/7
IL.2 - Vecteurs propres de l'application «
On fixe un entier k EUR [[0, n]|.
Q8. Quelle est la dimension de ker(a + kldp, 1x1) ?
Q9. En déduire qu'il existe un unique polynôme P} EUR R,[X], de coefficient
dominant égal à 1,
vérifiant a(P}) = -- kP.+.
Q10. Justifier que P, est de degré k.
Q11. Déterminer P, et P,. Vérifier que P; = X° -- 4X + 2.
IL3 - Orthogonalité de la famille (P0, . .. , P,)
On fixe un couple (P,O) ER, [X}.
Q12. Montrer que (a(P) | QO) = -- [ | tP'(1Q'(t)e 'dt.
0
Q13. En déduire que (a(P) | O) = (P | a(O)).
Q14. Montrer que (Po,..., P,) est une base orthogonale de R,[X]. On pourra
utiliser Q9 et Q13.
Partie IIT - Méthode de quadrature de Gauss
On admet que le polynôme P, admet n racines réelles distinctes que l'on note
x1,...,x,.
On souhaite montrer qu'il existe (A1,...,1,) EUR R" tel que :
VP R;,,- X |, P(t dt = À; P i). *
ER,_1[X] [ (de 2 (x). (&)
Q15. Montrer qu'un n-uplet (4:,...,1,) EUR R" vérifie (+) si et seulement si
1 1 -.. I \fA 0!
X] X2 + Xn À 1!
at xl ee. x]U, (n-- 1)!
Q16. En déduire qu'il existe un unique n-uplet (41,...,1,) EUR R" vérifiant (+).
Q17. Déterminer un polynôme P EUR R;,[X] tel que
P(ie 'dt 4 >» A;P(x;).
[ (De dr > AP(x)
i=]
3/7
EXERCICE 2
Étude d'une équation différentielle
On considère l'équation différentielle suivante :
x (1 -- x)y"-- x(1 + x)y +y =2x*. (E)
Partie I - Solution particulière de l'équation homogène
Dans cette première partie, on souhaite déterminer les solutions développables
en série entière de
l'équation différentielle homogène associée à (E) :
x2(1 -- x)y" -- x(1 + x) + y = 0. (H)
On fixe une suite de nombres réels (a,),en telle que la série entière > a, X°
ait un rayon de conver-
gence r > 0. On définit la fonction f :]--r,r[-- KR par :
+00
Vxel-r,r[, f(x) = > AnX".
n=0
Q18. Justifier que la fonction f est de classe #° et que les fonctions f" et
f"' sont développables
en série entière. Exprimer avec la suite (a,),en les développements en série
entière respectifs
des fonctions f" et f" en précisant leur rayon de convergence.
Q19. Montrer qu'il existe une suite (b,),-2 de nombres réels non nuls telle que
pour tout x EUR]-r, r{,
ON à :
(LPC -- x + DPI + FO = 40 + D bi(an -- an DX"
n=2
Q20. Montrer que f est solution de (41) sur l'intervalle ]--7, r{ si et
seulement si ap = Oeta,:1 = a,
pour tout n EUR N°.
Q21. En déduire que si f est solution de (4) sur | -- 7, r{, alors r > 1 et 1l
existe 1 EUR K tel que :
AX
Vxel-LIL fo =
Q22. Réciproquement, montrer que si À EUR KR, alors la fonction
ÀX
(1 -- x)
g:]-1,I[---R, xr
est une solution de (7) sur ] -- 1, 1[ développable en série entière.
4/7
Partie II - Solutions de (E) sur 10, 1[ ou ]1,+cof
On désigne par J l'un des intervalles ]0, If ou ]1, +. Soit y : Z -- R une
fonction de classe G?. On
définit la fonction z : Z -- KR par la relation :
Q23.
Q24.
Q25.
Q26.
Q27.
Vxel, Zz(x) = F -- 1)60
Justifier que z est de classe EUR" sur l'intervalle Z, puis exprimer z' et z/'
avec y, y' et y".
Montrer que y est solution de (E) sur J si et seulement si z est solution sur 7
de l'équation
différentielle :
XZ +7 = 2x. (E,)
Montrer que si z est solution de (Æ;) sur Z, alors 1l existe 1 EUR KR tel que :
À
Vxel, Zz(xX)=-+x.
x
En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (Æ) sur J.
Partie III - Solutions de (£) sur ]0, +co
Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E) sur ]0,
+co.
5/7
EXERCICE 3
Étude d'une marche aléatoire
On considère trois points distincts du plan nommés À, B et C. Nous allons
étudier le déplacement
aléatoire d'un pion se déplaçant sur ces trois points.
À l'étape n = 0, on suppose que le pion se trouve sur le point À. Ensuite, le
mouvement aléatoire du
pion respecte les deux règles suivantes :
1. le mouvement du pion de l'étape n à l'étape n + 1 ne dépend que de la
position du pion à
l'étape n, plus précisément 1l ne dépend pas des positions occupées aux autres
étapes précé-
dentes ;
2. pour passer de l'étape n à l'étape n + 1, on suppose que le pion a une
chance sur deux de rester
sur place, sinon 1l se déplace de manière équiprobable vers l'un des deux
autres points.
Pour tout n EUR N, on note À, l'évènement "le pion se trouve en À à l'étape n",
B, l'évènement "le pion
se trouve en B à l'étape n" et C, l'évènement "le pion se trouve en C à l'étape
n". On note également :
Pn
Vn EUR N, Pn -- P(A,), Qn -- P(B;), Vn -- P(C) et Vh -- | Qn |;
Vn
et on considère la matrice :
2 1 1
mM=-|1 2 1le.#(R).
1 1 2
NE
Dans l'exercice, on pourra utiliser sans le démontrer le résultat suivant :
442 42] 42]
VnEN, M'= 4-1 442 4-1]
Sn y 421 442
On rappelle que si E et F sont deux évènements avec P(F) > 0, on définit la
probabilité conditionnelle
de E sachant F (notée P(E | F) ou PF(E)) par :
PENF)
PCETF) = Pr(E) = PF)
Partie I - Calcul des probabilités
Q28. Calculer les nombres p,, g, et r, pourn =0etn=l.
Q29. Démontrer que pour tout n EUR N, on a la relation V,,, = MV,;.
Q30. En déduire que V, = M"Vo, puis une expression de p,, q, et r, pour tout n
EUR N.
Q31. Déterminer les limites respectives des suites (Ph 1en, (Qn)nen et (he.
Interpréter le résultat.
6/7
Partie II - Nombre moyen de passages en À
Pour n EUR N°", on note a, le nombre moyen de passages du pion en À entre
l'étape 1 et l'étape n et on
définit la variable aléatoire :
_ f 1 si À, est réalisé,
X -- . pt ' y
É Uo si À,est réalisé.
Q32. Interpréter la variable aléatoire X, + : -- + X, et le nombre E(X; + ::- +
X,).
Q33. Calculer l'espérance de la variable aléatoire X, pour n EUR N°.
Q34. En déduire une expression de a,.
Partie III - Temps d'attente avant le premier passage en B
On définit la variable aléatoire T} de la façon suivante :
1. si le pion ne passe jamais en B, on pose Tz = 0;
2. sinon, 73 est le numéro de l'étape à laquelle le pion passe pour la première
fois en B.
Nous allons déterminer la loi de 7% et son espérance.
Q35. Calculer P(Tz = 1) et P(Tz = 2).
Q36. Soit n EUR N. Exprimer B, en fonction de À, et C,.
è -- 1_-- -- _ -- 1
Q37. Etablir que P(B; N B; N B;) = 37 B2 N B;), puis en déduire que P(B; | B; N
B;) = r
Dans la suite, on admet la relation :
= 1
Vn EUR N', P[a. D = --.
: +
Q38. Pour k EUR N°, calculer P(Tzg = k). Que vaut P(Tz = 0)?
Q39. Justifier que la variable aléatoire T} admet une espérance. Quelle est
l'espérance de T3 ?
FIN
7/7
