X/ENS Physique MP 2025
| Thème de l'épreuve | La lévitation électrique |
| Principaux outils utilisés | électrostatique, mécanique du point, mécanique des solides, oscillateur harmonique, théorie cinétique des gaz, transferts thermiques |
| Mots clefs | piège de Paul, lévitation, potentiel quadrupolaire, équation de Laplace, théorème d'équipartition, libre parcours moyen, stabilité |
Corrigé
:👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
👈 l'accès aux indications de tous les corrigés ne coûte que 1 € ⬅ clique ici
👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
- - - - - - - - - - - - -
👈 gratuite pour ce corrigé si tu crées un compte
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Énoncé complet
(télécharger le PDF)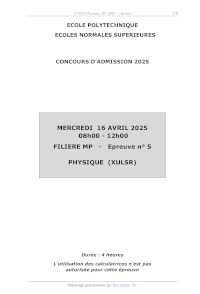








Rapport du jury
(télécharger le PDF)



Énoncé obtenu par reconnaissance optique des caractères
ECOLE POLYTECHNIQUE
ECOLES NORMALES SUPERIEURES
CONCOURS D'ADMISSION 2025
MERCREDI 16 AVRIL 2025
08h00 - 12h00
FILIERE MP
-
Epreuve n° 5
PHYSIQUE (XULSR)
Durée : 4 heures
L'utilisation des calculatrices n'est pas
autorisée pour cette épreuve
Le sujet comprend 8 pages, numerotees de 1 a 8. L'usage des calculatrices n'est
pas autorise. Les
resultats numeriques peuvent etre donnes avec un seul chiffre significatif.
La levitation electrique
Certains objets peuvent etre maintenus en levitation a l'aide de forces
electriques, optiques,
magnetiques ou acoustiques. Stabiliser la levitation de particules de taille
micrometrique represente
aujourd'hui un enjeu crucial en physique fondamentale, ainsi que pour le
developpement de capteurs
de forces ultra-precis.
Dans cette etude, nous cherchons a identifier les regimes dans lesquels la
levitation electrique est
stable, c'est-a-dire ou la particule reste a la meme position moyenne au cours
du temps. Dans ce but,
il est essentiel que l'oscillateur harmonique, qui decrit le mouvement de la
particule, soit suffisamment rigide pour resister aux perturbations, qu'elles
soient intrinseques (comme les asymetries des
pieges) ou environnementales (par exemple, les collisions avec des particules
de gaz ou le chauffage
provoque par le laser d'imagerie). Les particules etudiees possedent des
electrons fixes a leur surface
par des liaisons chimiques. Nous supposons, pour l'ensemble de cette etude, que
ces charges restent
immobiles a la surface des particules.
La derniere partie (concernant l'analogie mecanique) peut etre abordee de
maniere independante
du reste de l'etude.
Donnees, notations et formulaire
La particule a pieger est une particule en diamant, de masse volumique m = 3,5
× 103 kg · m-3 ,
parfaitement spherique, de centre C, de diametre d = 100 nm et de masse m = 2 ×
10-18 kg. Cette
particule est chargee negativement sur sa surface. Dans les parties 1 et 2,
elle est supposee ne
porter qu'une seule charge electronique, q = -e.
Pour les applications numeriques, on adoptera les valeurs suivantes :
· La constante de Boltzmann : kB = 1,4 × 10-23 J · K-1
· La charge elementaire : e = 1,6 × 10-19 C
· La vitesse de la lumiere dans le vide : c = 3,0 × 108 m · s-1
· L'acceleration de la pesanteur : g = 9,8 m · s-2
· La masse du proton : mp = 1,7 × 10-27 kg
· La masse de l'electron : me = 9,1 × 10-31 kg
Les derivees temporelles premiere et seconde d'une grandeur X(t) dependant du
temps seront
notees respectivement X et X.
On rappelle l'expression du moment d'inertie I d'une particule spherique
homogene, de diametre
d et de masse m, par rapport a un axe passant par son centre :
2
2
d
I= m
.
5
2
Enfin, on rappelle la formule du double produit vectoriel :
~u (~v w)
~ = (~u · w)
~ ~v - (~u · ~v ) w
~
1
1
Le piege electrique
Figure 1: Schema d'un piege electrique en anneau. Un generateur delivrant une
tension V est
connecte entre la masse et le fil a gauche du piege. Le schema de droite est
une coupe du piege
dans le plan Ozx. L'axe vertical Oz est un axe ascendant.
1. On considere un piege electrique en forme d'anneau tel que celui montre a la
Fig 1, place
dans le vide. On se donne un repere Oxyz tel que O est au centre du piege et Oz
est l'axe de
symetrie de revolution de l'anneau. On note ~ux , ~uy et ~uz les vecteurs
unitaires de ce repere.
On note par ailleurs l0 le rayon de l'anneau, en ignorant son epaisseur,
exageree sur la figure.
A une position ~r de coordonnees (x, y, z) proche du centre du piege, ou x, y
et z sont donc
tous tres petits devant l0 , le potentiel electrique Vel (~r), dans le vide,
prend la forme
Vel (~r) =
V 2
(z + x2 + y 2 ),
l02
(1)
ou V est la tension appliquee entre le piege et la masse (supposee a une
distance de celui-ci
grande devant l0 ), et > 0 est un facteur sans dimension qui depend de la
geometrie du
piege. On suppose jusqu'a la question 9 incluse que le fil (a gauche du piege)
ou se connecte
le generateur perturbe peu le potentiel au centre du piege et qu'il y a
invariance parfaite du
potentiel par rotation autour de Oz.
Determiner les coefficients et .
2. On place maintenant une particule supposee ponctuelle, de charge q = -e, au
centre du piege.
Pourquoi ne peut-elle pas y leviter de maniere stable ?
3. Pour resoudre ce probleme, on impose une tension variable au cours du temps,
de sorte que
la particule est maintenant soumise au potentiel dependant du temps
Vel (~r, t) =
V (t) 2
(z + x2 + y 2 ),
l02
2
ou V (t) = V0 cos(t). Ecrire l'equation du mouvement pour les trois composantes
du vecteur
position ~r de la particule dans le repere Oxyz, soit ri = (rx , ry , rz ) =
(x, y, z), sous la forme
ri + qi cos(t)
2
ri = 0,
2
(2)
en faisant apparaitre 3 parametres (qx , qy , qz ) que l'on ecrira qi = ni (/)2
, ou ni Z est
une constante numerique et 2 = eV0 /(ml02 ). On indiquera les valeurs de nx ,
ny et nz .
4. On suppose que . On admet que la variable ri (t) peut alors s'exprimer
comme une
somme de deux variables, ri (t) = Ri (t) + i (t), ou Ri (t) varie sur une
echelle de temps
beaucoup plus grande que -1 et i (t) est un signal periodique de pulsation tel
que i (t)
et ses derivees sont de moyenne nulle sur une periode d'oscillation du
potentiel. Montrer, en
justifiant soigneusement chaque etape du raisonnement, que
hRi i + qi
2
hi (t) cos(t)i = 0,
2
(3)
ou h·i represente une moyenne sur une periode d'oscillation, definie par
hXi =
2
Z 2/
X(t)dt
(4)
0
pour une grandeur X(t) quelconque dependant du temps.
5. Dans cette question, on neglige toutes les harmoniques de pulsation
superieure ou egale a 2.
a - Quelle est la forme la plus generale de i (t) respectant les conditions
specifiees ?
b - Exprimer ¨i (t) en fonction de , qi et Ri (t), puis en deduire l'expression
de i (t) en fonction des memes grandeurs. On justifiera soigneusement le
raisonnement.
c - Dans le regime , que peut-on dire de i par rapport a Ri ?
6. Montrer que la variable lente Ri (t) a une dynamique qui se reduit a celle
associee a un
potentiel harmonique effectif
1
Ueff (Ri ) = mi2 Ri2
2
qui ne depend pas du temps et dont on donnera la frequence propre i . Comparer
i a .
7. Puisque le potentiel electrique donne a la question 3 est de moyenne
temporelle nulle, on
aurait pu s'attendre a ce qu'il n'y ait pas de force de rappel. Expliquer, avec
des dessins
montrant la dependance temporelle et spatiale de la composante Fz (~r, t) de la
force electrique
selon la direction z, dans le regime qz 1, pourquoi la particule subit bien,
en moyenne sur
une periode 2/, une force de rappel. On distinguera deux cas avec deux
positions initiales
z0 > 0 et z0 < 0. Pour fixer les idees, on prendra V0 < 0, sachant que le meme raisonnement s'appliquerait pour V0 > 0.
8. Pourquoi faut-il que qi ne soit pas trop petit pour satisfaire aux criteres
d'une levitation stable
definie dans l'enonce ?
3
9. On suppose que |qz | [0,1 - 0,3] permet d'obtenir un bon confinement dans
la direction z,
dans un piege ou l0 = 100 µm, = 0,1, et = (2)1 kHz 1 . La particule a
toujours un electron
a sa surface. Pour quelle gamme de tension electrique V0 obtient-on un bon
confinement dans
cette direction ?
10. On souhaite prendre en compte le fil qui permet de connecter le piege au
generateur de tension
(voir Fig. 1) dans le modele. L'influence de ce fil peut etre modelisee par
l'ajout au potentiel
d'un terme supplementaire, anharmonique, de la forme
V (t) bx 2
2
2
Va (~r, t) =
(5)
x + by y + bz z x
3
l13
ou l1 est une longueur dont on ne precise pas la signification ici. En quoi ce
potentiel respectet-il la symetrie du piege incluant le fil ?
11. La presence du fil, et donc du terme anharmonique, modifie egalement
l'expression de la
partie harmonique du potentiel de l'Eq.(1), c'est-a-dire que les valeurs des
coefficients ne sont
plus necessairement celles trouvees alors. On ecrit donc cette partie
harmonique sous la forme
plus generale :
V (t)
Vel =
(az z 2 + ax x2 + ay y 2 )
l02
Quelles sont les deux equations que doivent verifier les coefficients (ax , ay
, az ) et (bx , by , bz ) ?
2
Quelques perturbations externes
12. Le mouvement de la particule peut etre traite comme celui d'un oscillateur
harmonique a
l'equilibre avec le gaz environnant a une temperature T = 300 K. Quel est
l'ecart-type de
l'amplitude du mouvement dans la direction x dans le cas ou qx = 0,2 et = (2)1
kHz?
13. Est-il alors possible de confiner cette particule dans un piege avec l0
100 µm?
14. On n'a considere jusqu'a present qu'une particule portant une unique charge
elementaire.
On admettra que notre approche est valable pour une particule portant une
charge q plus
importante en valeur absolue, et que la pulsation z est proportionnelle a cette
charge. On
prend alors une particule avec une charge suffisante pour que z = (2)1 kHz.
Determiner la
position z0 d'equilibre du centre d'inertie de cette particule dans la
direction z, en presence
de la gravite terrestre, dont la direction est indiquee sur la Fig. 1.
15. On considere que la particule levite dans une chambre a vide ou regne une
pression residuelle
P = 1 hPa. On peut distinguer deux regimes d'ecoulement selon la valeur d'un
nombre sans
dimension, dit nombre de Knudsen, Kn = l /d, ou d est le diametre de la
particule et l le
libre parcours moyen. Lorsque Kn < 1, le regime d'ecoulement est dit continu multiphasique alors que lorsque Kn > 1, l'ecoulement est dit libre.
1
Cette notation indique que le membre de droite, hors parentheses, donne la
frequence du signal, et la totalite du
membre de droite donne la pulsation en radian par seconde. Donc ici : =
(2)1kHz = 2 × 103 rad · s-1 .
4
On suppose le gaz parfait monoatomique et on donne le libre parcours moyen
l =
1
2a2 n
(6)
ou n est la densite d'atomes du gaz et a 10-10 m est une longueur qui
caracterise les
collisions entre atomes du gaz.
Dans lequel des deux regimes decrits ci-dessus la particule se trouve-t-elle a
cette pression ?
16. Calculer la vitesse quadratique moyenne vqm des atomes du gaz, en supposant
qu'il n'y a que
du diazote dans une enceinte a 300 K.
17. On considere que la particule en levitation est en diamant, de capacite
calorifique massique cm = 500 J · K-1 · kg-1 . Un laser de puissance P0 = 1 mW
est utilise pour mesurer la
position de la particule. Cette puissance, focalisee sur la particule en
levitation, est modulee
dans le temps a la pulsation m , de sorte que P` (t) = P0 [1 + cos(m t)]. On
considere que 10%
de la puissance de ce faisceau est absorbee et transmise a la particule sous
forme de chaleur,
de sorte que la puissance lumineuse absorbee par la particule est Pabs (t) = P`
(t)/10.
On cherche a estimer la temperature T (t) de la particule en fonction du temps.
Les echanges thermiques entre la particule et l'environnement sont d'une part
l'apport d'energie
par le laser et d'autre part une fuite thermique vers le gaz thermostate.
Quelle est la quantite d'energie perdue par unite de temps, notee , en fonction
du coefficient
de transfert thermique de surface h, des temperatures T0 du gaz et T de la
surface du diamant,
et de la surface S de la particule ?
18. On suppose que la temperature de la particule est homogene. Ecrire
l'equation differentielle
regissant son evolution temporelle T (t). On posera Pabs,0 = P0 /10 et K = hS.
19. Resoudre cette equation differentielle en considerant qu'au temps t = 0, la
temperature de la
particule est T0 . Exprimer la solution comme la somme de trois contributions.
20. Donner l'allure de T (t) sur un graphe.
21. Quel est le temps caracteristique de passage du regime transitoire au
regime permanent ?
On fera l'application numerique en prenant h = 100 W · K-1 · m-2 et on rappelle
ici que
cm = 500 J · K-1 · kg-1 et que la particule est une sphere de diametre d = 100
nm et de masse
m = 2 × 10-18 kg.
22. Apres un temps suffisamment long devant , montrer que la mesure de
l'amplitude de la
variation de T (t) a differentes pulsations m de la modulation du laser permet
d'acceder a la
valeur de la capacite thermique de la particule, connaissant sa surface S et le
coefficient h.
5
3
La rotation de la particule
On tient maintenant compte du fait que la particule n'est pas ponctuelle et
qu'elle peut etre
sujette a des rotations.
On commence par supposer que ces rotations sont limitees au plan Oxy
perpendiculaire a
l'axe Oz de symetrie de revolution du piege, en reperant l'orientation de la
particule dans ce
plan par un angle algebrique . On suppose, jusqu'a la question 25 incluse, que
la particule
est suffisamment bien confinee selon Ox, Oy et Oz pour que son centre d'inertie
C soit
constamment confondu avec l'origine O. On note I le moment d'inertie de la
particule par
rapport a l'axe Oz, qui est donc dans cette configuration un axe de symetrie de
la particule.
23. Les collisions avec le gaz discutees aux questions 15 et 16 donnent lieu a
un couple visqueux
de la forme -I . Dans le regime libre introduit a la question 15, on peut
montrer que
=
40P d2
3mvqm
ou m est la masse de la particule, P la pression dans la chambre a vide et vqm
la vitesse
quadratique moyenne des atomes du gaz. Que vaut pour les valeurs numeriques
deja
evoquees de ces grandeurs physiques ?
24. On suppose que l'angle oscille autour d'une position d'equilibre et que
son evolution temporelle en l'absence de ce couple visqueux peut etre decrite
comme celle d'un oscillateur
harmonique de pulsation propre = (2)10 kHz. A partir du resultat precedent,
calculer le
facteur de qualite Q de cet oscillateur tenant compte du couple visqueux.
~ l = Cl ~uz .
25. On met la particule en rotation au moyen d'un laser exercant un couple C
A quelle vitesse angulaire maximale max = max peut-on faire tourner la
particule avec ce
couple ? On negligera ici le couple de rappel, on utilisera le resultat de la
question 23 et on
fera l'application numerique pour un couple de module Cl = 10-19 N · m et en
supposant la
particule homogene et spherique. On prendra comme valeurs numeriques de m et d
celles
deja mentionnees.
26. L'objet des questions suivantes de cette partie (i.e. des questions 26 a
31) est d'etudier les
regimes dans lesquels la particule est stabilisee angulairement grace au piege
electrique.
Pour ce faire, on considere desormais que la particule porte deux charges -e
fixees a sa
surface en deux points P1 et P2 diametralement opposes. Desormais, le centre
d'inertie C de
la particule n'est plus necessairement confondu avec O, et on le repere par ses
coordonnees
x, y, z dans le repere Oxyz, comme on reperait la particule ponctuelle dans la
premiere partie.
On pose
--
--
CP 1 = -CP 2 = (x) ~ux + (y) ~uy + (z) ~uz .
Enfin on suppose que la particule n'est soumise a aucune autre force que les
forces electriques
du piege, et on ignorera les effets d'anharmonicite induits par la presence du
fil.
Montrer que le mouvement du centre de masse de la particule est regi par les
memes equations
que celles de la question 3, a condition de multiplier par deux la charge de la
particule.
6
27. La presence de deux charges electriques a la surface suggere qu'un couple
de forces electriques
peut exister, influencant la rotation de la particule. Cette rotation n'est a
priori plus contrainte au seul plan Oxy.
a - Calculer le moment ~O,i de la force electrique exercee par le piege sur la
charge -e situee
en Pi , pour i {1, 2}, par rapport au centre O du piege.
b- En deduire le moment total des forces electriques par rapport a O, note ~O .
28. Le moment total ~O apparait comme la somme de deux termes. Lequel est
responsable de la
rotation instantanee de la particule autour d'un axe passant par C ? On le
notera ~C . Que
decrit l'autre terme ?
29. Nous allons maintenant etudier la rotation de la particule, en se donnant
un repere OXY Z
defini ainsi :
· Les axes de ce nouveau repere sont fixes a la particule
---
· L'axe OZ pointe a chaque instant dans la direction du vecteur ~v = P2 P1 /d.
Les composantes d'un vecteur quelconque dans le repere OXY Z peuvent etre
obtenues a
partir de celles de ce meme vecteur dans Oxyz a l'aide de deux angles 1 et 2 ,
variant au
cours du temps, et a l'aide de matrices de rotations (que l'on n'explicitera
pas ici).
Nous allons supposer que le vecteur unitaire ~v pointe toujours au voisinage de
~uz . On admettra
qu'on peut alors ecrire
~v = ~uz + 1 (t)~ux - 2 (t)~uy .
avec |1 | 1 et |2 | 1.
De plus, on admettra que I 1 = ~C · ~uy et I 2 = ~C · ~ux , ou l'on rappelle
que I est le moment
d'inertie de la particule par rapport a un axe quelconque passant par son
centre. Ecrire les
equations differentielles verifiees par 1 (t) et 2 (t). On negligera les
frottements avec l'air.
30. Comparer les deux equations differentielles obtenues pour 1 et 2 avec
celles obtenues pour
les variables x, y et z a la question 3. On fera apparaitre trois constantes
{q1 , q2 } et r
jouant le meme role que {qx , qy , qz } et dans les equations obtenues la
question 3.
31. On suppose dans cette question que et r .
a - En deduire que les angles 1 et 2 subissent un couple de rappel autour de la
valeur nulle
sous l'action du piege electrique.
b - Calculer, pour une meme particule avec deux charges -e diametralement
opposees, le
rapport entre la frequence effective du mouvement de son centre de masse dans
la direction
z (calculee a la question 6, mais pour une particule avec une seule charge) et
la frequence
effective associee a son confinement angulaire.
7
4
Une analogie mecanique
On se propose d'etudier une analogie mecanique du confinement electrique du
centre de masse.
Une balle (traitee comme un point materiel dans toute cette partie) de masse m,
non chargee,
peut se deplacer sur une surface courbee, de rayon de courbure R > 0 dans la
direction x et
-R < 0 dans la direction y, la direction z correspondant a la verticale. On peut considerer que la balle, placee sur cette surface dans le champ de pesanteur, est soumise au potentiel U (x, y) = mg 2 1 (x - y 2 ) = m 2 (x2 - y 2 ) 2R 2 32. On fait tourner la surface autour de l'axe Oz, a la vitesse angulaire constante , par rapport au referentiel galileen R0 du laboratoire, l'origine O etant supposee fixe. Rappeler les forces d'inertie qui apparaissent lors de la description du mouvement d'une particule de vitesse ~v dans le referentiel tournant R attache a la surface en rotation. On notera ~r la position de la balle dans ce referentiel. 33. Ecrire les equations du mouvement pour les coordonnees x et y dans le referentiel tournant R. On supposera que le vecteur position de la balle est quasi-orthogonal au vecteur rotation a chaque instant, c'est-a-dire que la courbure est faible. 34. Chercher des solutions de la forme x(t) = x0 exp(rt) et y(t) = y0 exp(rt) et en discuter la stabilite. Tracer un diagramme de stabilite dans le plan (, ). 8
