Mines Physique 2 MP 2025
| Thème de l'épreuve | Mesure et caractérisation du champ de pesanteur |
| Principaux outils utilisés | mécanique du point, mécanique quantique |
| Mots clefs | champ de pesanteur, référentiel non galiléen, force de marée, gravimètre, fonction d'onde |
Corrigé
:👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
👈 l'accès aux indications de tous les corrigés ne coûte que 1 € ⬅ clique ici
👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
- - - - - - - - - -
👈 gratuite pour ce corrigé si tu crées un compte
- - - - - - - - - - -
Énoncé complet
(télécharger le PDF)






Rapport du jury
(télécharger le PDF)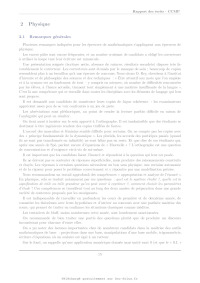



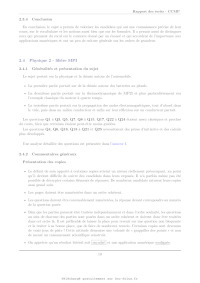

Énoncé obtenu par reconnaissance optique des caractères
A2025 -- PHYSIQUE II MP
Cmp
Concours commun
Mines-Ponts
ÉCOLE NATIONALE DES PONTS et CHAUSSÉES,
ISAE-SUPAERO, ENSTA PARIS,
TÉLÉCOM PARIS, MINES PARIS,
MINES SAINT-ÉTIENNE, MINES NANCY,
IMT ATLANTIQUE, ENSAE PARIS,
CHIMIE PARISTECH - PSL.
Concours Mines-Télécom,
Concours Centrale-Supélec (Cycle International).
CONCOURS 2025
DEUXIÈME ÉPREUVE DE PHYSIQUE
Durée de l'épreuve : 3 heures
L'usage de la calculatrice ou de tout dispositif électronique est interdit.
Les candidats sont priés de mentionner de façon apparente
sur la première page de la copie :
PHYSIQUE IT - MP
L'énoncé de cette épreuve comporte 6 pages de texte.
Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur
d'énoncé, il le
signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des
initiatives qu'il est
amené à prendre.
Les sujets sont la propriété du GIP CCMP. Ils sont publiés sous les termes de
la licence
Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de
Modification 3.0 France.
Tout autre usage est soumis à une autorisation préalable du Concours commun
Mines Ponts.
Physique II, année 2025 -- filière MP
Mesure et caractérisation du champ de pesanteur
Notations et données numériques utiles dans l'épreuve :
-- constante de Boltzmann : kg = 1,3 x 107% J.K-!
-- constante de Planck : À = 6,6 x 107% J.s
-- célérité de la lumière : c = 3.0 x 10° m-s-!
-- unité de masse atomique : u = 1,7 x 107? kg
-- constante de gravitation universelle : G = 6,7 x 1074 m°.82.kg 1
-- masse de la Terre : mr = 6,0 x 10° kg
-- masse de la Lune : m; = 7,3 x 102 kg
-- masse du Soleil : ms = 2,0 x 10% kg
-- rayon de la Terre : Rr = 6,4 x 105 m
-- distance Terre-Soleil : ds = 1,5 x 104 m
-- distance Terre-Lune : dy = 3,8 x 10° m
-- masse atomique du rubidium : m = 85 u
-- intervalle entre deux impulsions laser : 7 = 5,0 x 10725
-- longueur d'onde associée au transfert de quantité de mouvement : A9 = 7,8 x
10-7m
De nombreux domaines technologiques nécessitent de connaitre de manière précise
la valeur
du champ de pesanteur ÿ (tel que le poids P d'un corps de masse m s'écrive P =
mÿ). Ce
sujet s'intéresse dans sa première partie à un modèle permettant d'expliquer la
dépendance
temporelle du champ de pesanteur mesurée par un appareil de précision étudié
dans sa seconde
partie. Dans tout le problème on notera g = ||g|| l'intensité de la pesanteur.
I Mesure de la variation temporelle de g
Un dispositif quantique de précision étudié dans la seconde partie permet
d'accéder à de très
faibles variations du champ de pesanteur. Dans cette première partie, on
s'intéresse tout d'abord
au Champ de gravitation en un point M de masse m fixé à la surface de la Terre
(et donc
immobile par rapport à celle-ci. On note g = gü le champ de pesanteur en M où ü
est le
vecteur unitaire de la verticale locale orientée vers le bas. On observe
expérimentalement que g
dépend faiblement du temps. On introduit alors g, la moyenne temporelle de g
sur une période
d'étude et dg = g -- g. La courbe de la figure 1 représente les variations de
0g en fonction du
temps mesurées grâce au dispositif étudié dans la seconde partie. La valeur
moyenne de g à
l'endroit considéré et sur la période considérée est 3 -- 9 808 907 500nm:s"?,
l'axe des abscisses
est gradué en jour julien moyen !. La durée d'observation est d'environ 25
jours.
Le but de cette partie est de comprendre l'origine de cette variation
temporelle et d'en donner
une expression approchée. Pour cela, on s'intéresse aux forces
gravitationnelles exercées sur le
point M de masse m. On considère ici que chaque astre (Terre, Soleil, Lune,
etc.) exerçant une
influence gravitationnelle est à symétrie sphérique. Pour un astre (A), on
notera À, RA et ma
respectivement son centre, son rayon et sa masse (en particulier, la Terre (T)
sera décrite par
une sphère de centre T, de rayon Rr et de masse mr). On note également di = |T
A] la distance
entre les centres À et T de l'astre (A) et de la Terre.
1. Le jour julien est un système de datation consistant à compter le nombre de
jours et fraction de jour
écoulés depuis une date conventionnelle fixée au ler janvier de l'an 4713 av.
J.-C.
Page 1/6
Physique II, année 2025 -- fuière MP
57120 57125 57130 57135 57140 57145
1000 |
g -- g 500 +
La) QU
Le]
TE E--- 57180 757135 ET 57145
Jour Julien Moyen (JJM)
FIGURE 1 -- Variation temporelle de l'intensité de la pesanteur
D -- 1. Évaluer graphiquement les trois temps caractéristiques 71 < T> < T3 qui apparaissent sur la courbe de la figure 1. Que peut-on conjecturer sur les origines respectives des variations de g sur chacune de ces échelles de temps ? 1 -- 2. Rappeler la définition d'un référentiel galiléen, du référentiel de Copernic %, et du réfé- rentiel géocentrique Z,. 1 -- 3. On considère que le référentiel Z, est galiléen. Montrer que Z, ne l'est pas. La force gravitationnelle Fm exercée par un astre (A) sur un corps ponctuel de masse m placé en M et le champ gravitationnel G{(M) créé par l'astre (A) en M vérifient la relation Fam = mGa(M). D -- 4. Énoncer le théorème de Gauss gravitationnel, reliant notamment le champ de gravitation G et la constante de gravitation universelle G. En déduire l'expression du champ Gi (M) crée par un astre (A) pour AM > R3, en
fonction
--
de G, m et AM.
On introduit une base (6,,6,,e.) fixe dans Z, telle que le plan 7% = (T,6,,e,)
coïncide avec le
plan équatorial terrestre. On considère que la Terre est en rotation uniforme
autour de l'axe
(Te) par rapport au référentiel Z, et on note & = we, son vecteur rotation. On
considère un
point M de masse m situé à la surface de la Terre et un astre quelconque (A).
Le vecteur unitaire
radial de la base sphérique locale en M est EUR, -- TM /Rr. On note finalement
V1 -- (TM TÀ)
l'angle vu depuis de le centre de la Terre entre le point M et le centre de
l'astre (A). Ces
notations sont explicitées sur la figure 2 dans laquelle les échelles,
notamment de distance, ne
sont pas respectées.
Dans le référentiel géocentrique Z,, les trajectoires du point M appartenant à
la surface de
la Terre, ainsi que celles des centres L et S de la Lune et du Soleil peuvent
être considérées
comme circulaires uniformes, de périodes respectives Ty, Tr, et Ts.
D -- 5. Donner la valeur approximative, en jours terrestres, de chacune de ces
périodes.
Déterminer la valeur numérique de w en radian par seconde.
On suppose que l'influence gravitationnelle d'un astre (A) est non négligeable.
Pour un point
M de masse m posé à la surface de la Terre, immobile par rapport à la Terre et
soumis à des
forces de contact de résultante À, l'intensité de la pesanteur est définie par
R + mÿ =0
Page 2/6
Physique II, année 2025 -- fuière MP
FIGURE 2 -- Caractérisation géométrique du problème
D -- 6. En étudiant le mouvement de M dans le référentiel Z,, montrer que l'on
peut exprimer
g sous la forme ÿ -- Gr(M ) + %o + 1 où % s'exprime en fonction de & et de TM
alors
que # est simplement la différence entre Gi(M) et Gi(T).
D -- 7. Comment intervient le terme dans la variation du champ de pesanteur
locale ?
En considérant uniquement l'effet d'un astre (A), on note 09 l'expression
théorique de la quan-
tité Ôg discutée dans le préambule de cette partie I.
D -- 8. Déterminer l'expression de 09 en fonction de &, et de l'un des trois
termes Gr(M ), Jo ou
.
En pratique, l'astre perturbateur (A) considéré est toujours très loin de la
Terre. Aïnsi, da > Rx
et l'on peut chercher à donner une expression approchée de 7, en se limitant
uniquement aux
termes d'ordre 1 en Rx/da.
D -- 9. Montrer que, dans cette approximation, 7, s'exprime sous la forme
A
-- --
où l'on précisera l'expression de 4 en fonction de TM, T'A, dy, Rx et VA.
En déduire l'expression de 09, en fonction de G, ma, da, Rr et Wa.
--
1 -- 10. Déterminer l'expression de [641] dans le cas particulier où TM et TA
sont colinéaires et
de même sens.
Calculer alors, dans ce cas, les valeurs de [0g.]| et ôgs|, variations de g
dues respectivement
à la Lune et au Soleil ainsi que de leur rapport & -- [0g|/|0gs|. Commenter les
valeurs
obtenues.
On se place dans un modèle dans lequel on admet que pour tous les astres (A)
autres que le
Soleil et la Lune on a log & |ôgs|.
D -- 11. En prenant en compte les résultats des questions précédentes, écrire
l'expression la plus
simple possible de |[0g| correspondant au modèle étudié en fonction notamment
du temps t.
Après avoir tracé l'allure de la fonction t + 0g|(t) sur un mois, comparer ce
résultat aux
données expérimentales de la figure 1.
Page 3/6
Physique II, année 2025 -- fuière MP
IT Gravimètre à atomes froids
Dans un gravimêtre à atomes froids, on utilise des atomes de rubidium, de masse
m, refroidis
à une température 7, de l'ordre du microkelvin. À cette température, chaque
atome peut être
décrit par un paquet d'onde dont le centre évolue comme une particule
classique, suivant un
mouvement de chute libre sous l'action de la seule pesanteur. Les atomes se
comportent alors
comme des ondes de matière dont la propagation peut conduire à des phénomènes
d'interfé-
rences. Ces interférences peuvent être exploitées pour mesurer l'accélération
de la pesanteur
avec précision.
Dans cette partie, on considère le référentiel terrestre (Oxyz) comme galiléen
et on néglige toute
action autre que celle de la pesanteur sur les atomes de rubidium. On
s'intéresse uniquement au
mouvement s'effectuant le long d'un axe vertical OZ orienté vers le bas par le
vecteur unitaire
e,. On note p = mv - EUR, la projection selon EUR, de la quantité de mouvement
d'une particule de
masse m et de vitesse U. Enfin, on considère g uniforme et indépendant du temps.
Lors de la chute d'un paquet d'onde, celui-ci interagit avec un rayonnement
électromagnétique
(impulsion laser) qui influe sur son mouvement de la manière suivante :
-- À # -- 0, une impulsion permet de dédoubler chaque paquet d'onde en deux
parties
(désignées par les indices 1 et 2 par la suite) en communiquant à un des deux
paquets,
par exemple le paquet 2, une quantité de mouvement supplémentaire p., dans le
sens +e:.
On note p. et p2 les projections selon OZ des quantités de mouvement associées
à chaque
paquet. L'évolution de chaque paquet entre t = 0 et t = 7 constitue l'étape (a).
-- At=T,une autre impulsion laser augmente p, et diminue p2 de manière
instantanée de
la quantité p.. L'évolution de chaque paquet entre { = 7 et { -- 27 constitue
l'étape (b).
-- À # = 27, une nouvelle impulsion diminue p: de la quantité P,, puis une
mesure permet
de tester l'état du paquet d'onde total.
Les impulsions utilisées pour modifier les quantités de mouvement des paquets
aux instants
t=0,t=7Tett = 27 sont équivalentes à celles que produirait un laser
monochromatique
de longueur d'onde À6. On note p, la norme de la quantité de mouvement d'un
photon de
ce rayonnement. On introduit également p$ -- (p°), moyenne quadratique de la
quantité de
mouvement due à l'agitation thermique des atomes de rubidium à 75.
1 -- 12. Déterminer les expressions de p, et po en fonction notamment de À, et
75, ainsi que leurs
valeurs numériques. Commenter.
On étudie ici le mouvement des centres des paquets d'ondes, et on admet qu'ils
évoluent chacun
de la même manière qu'une particule de masse m, étudiée en mécanique classique.
À # = 0",
après interaction avec le faisceau laser, on prend comme conditions initiales
p1(0*) = po et
pa(0®) = po + Pa.
1 -- 13. Dans cette vision classique, exprimer, en fonction de po, p,, m, g et
7, les distances dia
et d>4 parcourues par chacune des particules dans la phase (a).
1 -- 14. Exprimer, toujours en fonction de po, p,, m, g et T, les distances di,
et d25 parcourues
par chacune des particules dans la phase (b).
En déduire que les centres des paquets d'ondes occupent la même position
l'instant { = 2r.
On notera 2 cette position.
1 -- 15. Déterminer l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur V(z) en
prenant V(0) = 0.
En déduire la relation entre p(z), m, g ,z et l'énergie mécanique E d'une
particule soumise
uniquement à l'action de la pesanteur.
Page 4/6
Physique II, année 2025 -- fuière MP
On s'intéresse désormais au traitement quantique de la chute des paquets
d'ondes dans le champ
de pesanteur. On rappelle que l'évolution de la fonction d'onde d (Mt) associée
à une particule
de masse m et d'énergie potentielle V s'écrit :
dy
re
AU + Vi = ihe
L'énergie potentielle V dépendant uniquement de z, on peut chercher les
solutions sous la forme
pt) = d(2X (6).
D -- 16. Montrer que les fonctions @ et Ç vérifient deux équations
différentielles indépendantes.
nr
k
En déduire que Y peut finalement s'écrire sous la forme #(2,t) = @(z)e 'r", et
justifier
que E est une constante réelle.
On peut chercher les solutions sous la forme @(z) -- do exp PE] , avec ®
constant et o(z)
une fonction que l'on peut exprimer sous la forme d'un développement en
puissances de /i du
type
où chaque o;(z) est une fonction réelle.
Dans les cas où le potentiel varie peu sur les échelles spatiales considérées,
condition que l'on
supposera vérifiée par la suite, on admet qu'on peut alors limiter les calculs
à l'ordre 1 en /i.
Dans la suite, on se place dans le cas où Æ > V(z) pour toutes les valeurs de z
considérées.
D -- 17. Montrer que © est solution de l'équation différentielle
h e
0" + 0 = 2m[E -- V(2)] © h2k?(2).
L
En se limitant à l'ordre 1 en h/i et en écrivant qu'un nombre complexe est nul
si et seule-
ment si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles, établir le
système d'équations
différentielles vérifiées par oo(z2) et o1(2), puis montrer que la fonction
d'onde s'écrit alors
sous la forme :
ba(z) = TE exp Ii Î | ka
où ®, est une constante que l'on ne cherchera pas à déterminer. Préciser
laquelle (+) de
ces solutions est physiquement acceptable.
Dans le cas particulier d'un potentiel uniforme V = VW, déterminer l'expression
de v(z;t)
et commenter cette dernière expression.
On peut montrer que la prise en compte des termes d'ordre 2 dans l'expression
de o& conduit
un expression du type :
bi (2) = TE 1+ DES +1 ns Li | Ktdel
avec dans notre cas 7 & 1.
D -- 18. Déterminer l'expression de la longueur d'onde de de Broglie 43
associée à une particule
de quantité de mouvement p.
Exprimer, en fonction de QUE, la condition légitimant l'approximation d'ordre 1
pour o.
Page 5/6
Physique II, année 2025 -- fuière MP
Pour comprendre l'origine du déphasage entre les deux parties 1 et 2 du paquet
d'onde associé
à la particule, on s'intéresse à la phase de la fonction d'onde, et on note
e)= f Htdu,
avec j EUR {1,2}. On définit la différence de phase & au point M de cote z = 20
par
g = pa(Mo) -- p1(Mo)
On se place dans l'approximation «4 suivante :« pour le calcul de , les valeurs
de k: et k2 sont
considérées constantes durant chacune des étapes (a) et (b), et égales à leur
valeur au début de
chaque étape ». Cette approximation revient à négliger l'énergie potentielle
V(z) devant E. On
note alors @° = 4° + 9 l'expression approchée de y obtenue à l'aide de cette
approximation,
où Y° et wY sont les déphasages respectifs dus aux étapes (a) et (b).
D -- 19. Déterminer, dans l'approximation .#,, les expressions k14, k15, ka et
ka des grandeurs k:
et k2 en fonction de po et p, pour chacune des étapes (a) et (b).
Déterminer les expressions de 9° et ©? déphasage entre les paquets lors de ces
deux étapes.
En déduire que 4° s'exprime alors sous la forme 4° = ug où l'on précisera
l'expression de
4 en fonction de T et Ào, on déterminera également sa valeur numérique.
Une méthode de mesure par fluorescence (non détaillée) permet de recueillir à
l'instant t = 27
un signal s proportionnel à la densité de probabilité de présence de la
particule au point M4.
1 -- 20. Montrer que s -- sof(y), où 50 est la valeur maximale du signal s et w
+ f(w) une
fonction que l'on précisera.
D -- 21. On désire pouvoir mesurer l'intensité de la pesanteur g avec une
incertitude relative
ôg/g = 10°. Déterminer la précision minimale avec laquelle on doit être capable
de
déterminer le déphasage pour obtenir la précision voulue sur la mesure de g.
Une variation du signal s est détectable uniquement si elle dépasse un seuil
noté As. À
partir de l'étude du graphe de la fonction ÿ + f(y) déterminer les valeurs de 4
autour
desquelles la mesure de g est la plus précise.
Dans le calcul du déphasage précédent, on à négligé les variations de k. et k2
liées à la chute
du paquet d'onde dans le champ de pesanteur. On cherche ici à estimer
l'influence de cette
approximation, pour l'étape (a) uniquement. On note Y, le déphasage entre les
centres des
paquets d'ondes 1 et 2 à la fin de l'étape (a) .
J-- 22. Montrer que &a = F (po + pydoa) -- F (po;dia) où EF: (y) + K [(a? +
vy)#? -- x#], on
précisera les expressions de et K en fonction notamment de m, g et h.
D -- 23. Évaluer le rapport m?gd1a/pè.
Conclure quant à la légitimité de l'approximation #.
FIN DE L'ÉPREUVE
Page 6/6
