Mines Physique 1 MP-MPI 2025
| Thème de l'épreuve | Impulsion mécanique et mesures optiques |
| Principaux outils utilisés | mécanique du point, relativité restreinte, optique ondulatoire, interféromètre de Michelson, mécanique quantique |
| Mots clefs | équation de Schrödinger, équation de Klein-Gordon, cohérence spectrale |
Corrigé
:👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
👈 l'accès aux indications de tous les corrigés ne coûte que 1 € ⬅ clique ici
👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
- - - - - - - - - - - - - - - -
👈 gratuite pour ce corrigé si tu crées un compte
- - - - - - -
Énoncé complet
(télécharger le PDF)







Rapport du jury
(télécharger le PDF)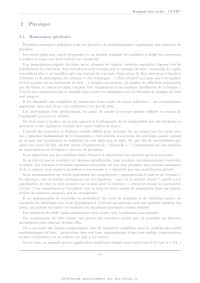




Énoncé obtenu par reconnaissance optique des caractères
A2025 PHYSIQUE I MP
ÉCOLE NATIONALE DES PONTS et CHAUSSÉES,
ISAE-SUPAERO, ENSTA PARIS,
TÉLÉCOM PARIS, MINES PARIS,
MINES SAINT-ÉTIENNE, MINES NANCY,
IMT ATLANTIQUE, ENSAE PARIS,
CHIMIE PARISTECH - PSL.
Concours Mines-Télécom,
Concours Centrale-Supélec (Cycle International).
CONCOURS 2025
PREMIÈRE ÉPREUVE DE PHYSIQUE
Durée de l'épreuve : 3 heures
L'usage de la calculatrice ou de tout dispositif électronique est interdit.
Les candidats sont priés de mentionner de façon apparente
sur la première page de la copie :
PHYSIQUE I - MP
L'énoncé de cette épreuve comporte 7 pages de texte.
Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur
d'énoncé, il le
signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des
initiatives qu'il est
amené à prendre.
.
Les sujets sont la propriété du GIP CCMP. Ils sont publiés sous les termes de
la licence
Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de
Modification 3.0 France.
Tout autre usage est soumis à une autorisation préalable du Concours commun
Mines Ponts.
Physique I, année 2025 -- filière MP
Impulsion mécanique et mesures optiques
Le sujet comporte quatre parties I, II, III et IV qui, bien que liées les unes
aux autres,
peuvent être abordées de manière totalement indépendante sous réserve
d'admettre éventuellement les résultats affirmés par l'énoncé. Dans les
questions posées, exprimer signifie donner
une expression littérale et calculer signifie donner une valeur numérique ;
toutes les applications numériques seront réalisées avec seulement deux
chiffres significatifs. Les vecteurs seront
surmontés d'une flèche, p~ ou ~v . Les grandeurs complexes seront soulignées,
ou z, sauf i, tel
que i2 = 1.
Dans le langage général, le sens usuel du mot impulsion désigne l'élan initial
qu'on peut donner à
une particule élémentaire ou à un projectile macroscopique qui poursuit ensuite
son mouvement.
Le même mot a un sens plus spécifique en physique ; l'impulsion, d'abord
définie en mécanique
classique comme la quantité de mouvement dans de très nombreux cas, se retrouve
en mécanique
quantique comme en mécanique relativiste avec un sens étendu.
Nous admettrons dans tout ce qui suit que l'impulsion p~ d'une particule
ponctuelle libre (non
engagée dans une liaison), de masse m et d'énergie E est, dans le cadre général
de la théorie
d'Einstein (), donnée par la relation dite du triangle relativiste :
E 2 = p2 c2 + m2 c4
(1)
où p = k~p k et c = 3,0108 m · s 1 est la célérité de la lumière dans le vide ;
par ailleurs, cette
même impulsion p~ est, dans la description ondulatoire des particules, associée
à la longueur
d'onde de l'onde associée à la particule par la relation de De Broglie () :
h
p
où h = 6,610 34 J · Hz 1 est la constante de Planck ().
=
I
(2)
Impulsion de particules élémentaires
o 1. Quel est, à votre avis, la nature du « triangle relativiste » évoqué par
la relation (1) ?
Représenter celui-ci.
Quelle est l'unité usuelle, dans le système international, de l'impulsion p ?
du produit pc ?
L'énergie des systèmes macroscopiques s'exprime usuellement en joule (J) ou en
kilowatt-heure
(1 kW · h = 3,6 MJ). Dans toute la suite de la partie I, l'énergie des
particules élémentaires sera
donnée en MeV (méga-électron volt) où 1 MeV = 106 eV et 1 eV = 1,610 19 J. Les
masses des
particules seront données en MeV/c2 et leurs impulsions en MeV/c. Par exemple
la masse de
l'électron vaut me = 0,51 MeV/c2 et celle du proton vaut mp = 940 MeV/c2 (ou,
si on préfère,
me c2 = 0,51 MeV et mp c2 = 940 MeV).
o 2. On appelle énergie de repos d'une particule la valeur E0 de l'énergie de
celle-ci lorsque
son impulsion est nulle. Exprimer E0 pour un proton et calculer sa valeur
numérique.
Pour une particule en mouvement, le supplément d'énergie Ec = E
cinétique.
E0 porte le nom d'énergie
o 3. On s'intéresse d'abord aux particules vérifiant la relation (1) dans le
cas de la limite
classique, lorsque Ec E0 . En vous limitant au premier ordre non nul, donner
dans ce
cas une expression de Ec en fonction de l'impulsion p et de la masse m de la
particule.
Quelle est alors la relation entre l'impulsion p~ et la vitesse ~v d'une
particule ?
Quelle vitesse maximale peut-on donner à un proton pour rester dans la limite
classique
telle que Ec /E0 < 1% ? Même question pour un électron. Page 1/7 Physique I, année 2025 -- filière MP Si on ne se limite pas aux faibles vitesses, on peut montrer, et on l'admettra, la relation générale entre la masse m, la vitesse ~v de norme v = k~v k, l'impulsion p~ de la particule et la célérité c de la lumière : m~v p~ = p (3) 1 v 2 /c2 o 4. En déduire l'expression générale de l'énergie totale E = f (E0 , v, c) d'une particule de masse m. o 5. Un photon est une particule associée à une onde électromagnétique dans le vide et dont la vitesse est donc égale à c. Que peut-on en déduire, pour sa masse, de la relation E = f (E0 , v, c) établie à la question précédente ? Déduire de (2) l'expression de l'énergie E d'un photon en fonction de la longueur d'onde puis de la fréquence de l'onde. Faire l'application numérique dans les cas des ondes lumineuses des domaines bleu ( 400 nm) puis rouge ( 600 nm). On pourra exploiter le fait que hc ' 1,2 eVµm et on exprimera E en eV. II Le spectre d'émission des atomes d'hydrogène atome au repos après Ei avant On s'intéresse ici à l'émission d'un photon, d'énergie E et d'impulsion p = E/c, par un atome initialement au repos, de masse m. Au cours de cette émission, l'atome passe de l'énergie initiale Ei à l'énergie finale Ef = Ei E < Ei et il recule avec, dans le cadre d'une description classique, l'impulsion m~v et l'énergie cinétique 12 mv 2 (figure 1) de sorte que l'impulsion totale du système complet reste nulle après l'émission, comme elle l'était avant émission. La direction de l'impulsion p~ du photon est donc opposée à la vitesse ~v de l'atome qui recule. Ef · ~v atome qui recule E p~ photon Figure 1 Émission d'un photon par un atome au repos o 6. On admet que l'énergie totale du système après émission est identique à celle de l'atome p 2 au repos avant l'émission. En déduire la relation E = mc 1 + 2 1 et exprimer en fonction de E, m et c. o 7. Dans le cas de l'atome d'hydrogène, E est de l'ordre de quelques électronsvolts. En déduire qu'on peut négliger l'énergie de recul de l'atome et conclure quant à la relation entre E = Ei Ef et l'énergie E du photon émis. La résolution de l'équation de Schrödinger () dans le cas de l'atome d'hydrogène montre que les valeurs de l'énergie En de l'atome sont quantifiées en fonction du nombre quantique principal n 2 N et de la grandeur H = 27,2 eV selon la relation : En = H/(2n2 ). Cette expression est confirmée par l'étude des ondes lumineuses, de longueur d'onde , émises par un ensemble d'atomes d'hydrogène qui rayonnent par désexcitation depuis un état initial quantifié par ni vers l'état final quantifié par nf < ni . o 8. Lorsque l'état final est nf = 1, montrer qu'il existe une max telle que 6 max et donner une estimation de max . Quel est le domaine spectral correspondant à ces raies d'émission ? Lorsque l'état final est nf > 2, montrer qu'il existe une min que l'on
estimera, telle que
> min . Quel est le domaine spectral correspondant à ces raies d'émission ?
Les raies d'émission de l'hydrogène dans le domaine visible (les raies de
Balmer) ont été
étudiées à partir de par Ångstrøm ; à quelles valeurs de nf
correspondent-elles ?
Page 2/7
Physique I, année 2025 -- filière MP
C'est la connaissance précise de ce spectre qui a permis l'étude de la
quantification de l'énergie des atomes donc l'introduction de la mécanique
quantique au début de XXe siècle. Cette
connaissance a été par la suite améliorée au moyen de la spectrométrie
interférentielle.
III
Mesures interférométriques de longueurs d'onde
En , Michelson est le premier américain à recevoir le prix Nobel de physique
pour
ses instruments optiques de précision et les mesures spectroscopiques et
métrologiques réalisées
au moyen de ceux-ci. En particulier, il publiera en des mesures relatives aux
spectres
d'émission de plusieurs sources, obtenues par spectroscopie interférentielle,
et notamment pour
les raies H (rouge) et H (bleue) d'émission par les atomes d'hydrogène.
III.A
L'interféromètre de Michelson
Le schéma du montage utilisé par Michelson est proposé figure 2. Le dispositif
monochromateur, formé d'un prisme de verre dispersif et d'une fente étroite,
éclaire l'appareil en sélectionnant une raie quasi-monochromatique de longueur
d'onde 0 , appartenant au domaine visible.
L'observation est réalisée au moyen d'un oculaire afocal, réglé à l'infini : il
donne d'un objet
situé à grande distance une image également à grande distance, mais agrandie.
chariotage
vis de
z
miroir mobile
~ez
L2
N
~ex
~ey
V1
monochromateur
x
O
V2
L1
miroir fixe
fente
prisme
source
oculaire
Figure 2 Dispositif de mesure en spectroscopie interférentielle
o 9. L'interféromètre comporte deux lames de verre L1 et L2 , parallèles, de
même épaisseur e
et de même indice optique n, inclinées d'un angle /4 relativement à l'axe (O,
~ex ) normal
au miroir fixe. La lame L1 est munie d'une couche semi-réfléchissante sur une
seule de ses
faces ; laquelle ? Justifier, en vous appuyant sur un schéma.
Page 3/7
Physique I, année 2025 -- filière MP
o 10. Après réglage des vis V1 et V2 les miroirs fixe et mobile sont rendus
rigoureusement
perpendiculaires ; l'axe optique (O, ~ez ) de l'oculaire est alors confondu
avec la normale au
miroir mobile et l'opérateur observe, au moyen de cet oculaire réglé à
l'infini, des franges
d'interférence. Quelle est la forme de ces franges ?
Peut-on encore les observer si l'oculaire est déréglé ?
o 11. Tout en observant les franges, l'observateur peut actionner la vis
micrométrique et déplacer le miroir mobile dans le plan (O, ~ex , ~ey ), le
long de l'axe (O, ~ez ). Relier le nombre N
de franges sombres qui défilent au centre du champ et le décalage z du miroir
mobile.
o 12. Exprimer, au moyen d'un schéma approprié, la différence de marche
observée à l'infini
dans une direction donnée, en fonction de l'écart séparant les deux miroirs.
Le déplacement maximal de la vis micrométrique à partir du contact optique est
noté
zmax . Déterminer, après ce déplacement, l'angle qui sépare le centre de la
figure de
la première frange de même nature.
o 13. Dans le cas d'une des raies de l'hydrogène atomique, on observe le
défilement de N = 3 156
franges pour un décalage z = 1 035 ± 2 µm. S'agit-il de la raie H ou H ?
Avec quelle précision relative mesure-t-on sa longueur d'onde 0 ?
Que vaut alors ? Commenter.
III.B
Cohérence spectrale d'une source
Une source de lumière éclaire avec la même intensité I0 les deux voies d'un
interféromètre ;
l'observation est réalisée en un point où la différence de marche est .
o 14. Dans le cas où la source est rigoureusement monochromatique, de
longueur d'onde 0 ,
exprimer l'intensité I( ) en fonction de I0 , 0 et . Définir et calculer le
facteur de contraste
C des franges.
Certaines sources lumineuses sont en fait bichromatiques : elles émettent deux
radiations de
longueurs d'onde très proches 1 et 2 et on pose alors 0 = 12 ( 1 + 2 ) et
=| 2
1 | en
admettant toujours
0.
o 15. Pour certaines sources bichromatiques les deux radiations émises sont
de même intensité ;
c'est le cas des lampes à vapeur de sodium, étudiées notamment par Michelson
dans
les conditions décrites en III.A. Expliciter l'intensité I observée en fonction
de I0 , de la
différence de marche , de 0 et de
.
Exprimer le facteur de contraste C des franges et montrer comment il permet la
mesure
de 0 / .
o 16. D'autres sources, comme celles émettant la raie H de l'hydrogène,
peuvent être écrites
comme bichromatiques mais les intensités I1 et I2 < I1 émises aux longueurs d'onde 1 et le facteur de contraste des franges est-il 2 sont différentes. Pour quelle(s) valeur(s) de minimal ? Quelle est cette valeur minimale ? Dans le cas de la raie double H , l'écart est de l'ordre de 1,410 11 m. Est-il possible de le mettre en évidence avec le montage proposé ci-dessus ? III.C Les tubes à hydrogène Pour l'étude du spectre d'émission de l'atome d'hydrogène, une première technique 1 , initiée dans les années , a consisté à utiliser un tube AB contenant de l'hydrogène moléculaire (dihydrogène, formule H2 ) sous faible pression (150 mbar) soumis à des décharges électriques de 1. D. Chalonge et Ny Tsi Zé, J. Phys. Radium, Page 4/7 Physique I, année 2025 -- filière MP haute tension entre deux électrodes E1 et E2 ; l'observation se fait au travers d'une fenêtre de quartz F (cf. figure 3). Le spectre d'émission obtenu présente la superposition d'un fond quasicontinu et de raies bien identifiées, comme le montre la figure 4 tirée de l'article présentant la technique originelle. Figure 3 Illustration du dispositif : reproduction de la figure 1 de l'article originel o 17. Quel est le rôle du circuit à circulation d'eau qui entoure le tube central ? Sur le spectre proposé en figure 4, quelle est l'unité de la graduation donnée en abscisse ? Quelle est, à votre avis, l'origine du fond continu (essentiellement dans le proche ultraviolet) marqué en trait pointillé gris ? Figure 4 Spectre d'émission du tube à hydrogène en échelle logarithmique On préfère actuellement utiliser des lampes à décharge d'une constitution différente : il s'agit de tubes à décharge remplis de vapeur d'eau permettant l'obtention d'un spectre atomique sans bande continue. En présence des décharges à haute tension, ce type de lampe est le siège des réactions H2 O = HO + H. o 18. Quelle propriété du spectre d'émission de la molécule hydroxyle HO est ici mise à profit ? Ces lampes contiennent une certaine proportion d'eau lourde, molécules HDO dans laquelle un des deux atomes d'hydrogène 11 H est remplacé par un atome de deutérium 21 D, dont le noyau est formé d'un proton et d'un neutron. Si on tient compte de la masse mN du noyau atomique, on peut montrer que la longueur d'onde d'émission d'une des raies spectrales de l'hydrogène atomique vérifie la relation : me + mN = 1 mN où me est la masse de l'électron et 1 la longueur d'onde idéale si mN ! 1. Page 5/7 Physique I, année 2025 -- filière MP o 19. Les raies d'émission du deutérium sont-elles, par rapport à celle de l'hydrogène ordinaire, décalées vers le bleu ou vers le rouge ? De quelle résolution spectrale (en nanomètre) faut-il disposer pour séparer les raies de l'hydrogène et celles du deutérium ? À partir d'une lecture de la courbe de la figure 4, faire l'application numérique dans le cas de la raie H . IV L'équation de KleinGordon Lors du développement de la mécanique quantique (ou mécanique ondulatoire), l'onde de matière (~r,t) a d'abord été considérée comme solution de l'équation de Schrödinger (4) : ~2 @ h + V (~r) (~r,t) = i~ où ~ = et i2 = 1 (4) 2m @t 2 pour une particule de masse m repérée par sa positon ~r et soumise à l'interaction décrite par la fonction potentiel scalaire V (~r). En , Klein et Gordon en ont proposé une version modifiée qu'on écrira : 2 @ 2 2 ~c + i~ V (~r) (~r,t) = m2 c4 (~r,t) (5) @t Dans la suite on s'intéressera exclusivement aux solutions de l'une ou l'autre équation, de la forme : i (~r,t) = 0 exp (Et p(E)x) ~ où 0 est une certaine constante complexe, x est l'une des coordonnées cartésiennes de ~r, E > 0
est l'énergie de la particule et p(E) > 0 son impulsion.
o 20. L'état associé à cette fonction d'onde est-il stationnaire ?
Dans quel sens le mouvement de la particule décrite par cette onde a-t-il lieu ?
Exprimer les vitesses de phase v' et de groupe vg en fonction de E, de p(E) et
de sa
dérivée.
o 21. Exprimer p(E) et vg (E) dans le cas d'une particule vérifiant
l'équation de Schrödinger
dans un domaine où V est constant. En déduire le caractère relativiste ou non
du modèle
associé à l'équation de Schrödinger.
o 22. Répondre aux mêmes questions dans le cas d'une particule vérifiant
l'équation de Klein
Gordon (5).
On s'intéresse enfin à la résolution du problème physique suivant : la
particule étudiée est
libre (V = 0) pour x < 0 et x > a et pourvue d'une énergie E, tandis que, dans
l'intervalle
x 2 [0,a], elle est soumise à une interaction caractérisée par V = V0 > E
(figure 5) et même
V0 E > mc2 . Les solutions de l'équation (de Schrödinger ou de KleinGordon)
seront
donc écrites, pour x < 0 et x > a, sous les formes respectives :
i
i
(x < 0,t) = 0 exp (Et px) + R 0 exp (Et + px) ~ ~ i (x > a,t) = T 0 exp
(Et px)
~
où T et R sont deux constantes complexes.
Page 6/7
Physique I, année 2025 -- filière MP
V (x)
V0
" = V0
E
=
0
e i
Et px
~
+R
0
e i
Et+px
~
=T
a
0
0
e i
E > mc2
Et px
~
x
Figure 5 Barrière de potentiel
On se place d'abord dans le cas de l'équation de Schrödinger.
o 23. Quelle est la nature de l'onde dans le domaine x 2 [0,a] ?
Quelles relations permettent de calculer R et T ? On ne demande pas de les
exprimer ici !
Quel phénomène physique peut-on mettre ainsi en évidence ?
Quelle est l'interprétation physique de |T |2 ?
On se place maintenant dans le cas de l'équation de KleinGordon.
o 24. Quelle est la nature de l'onde dans le domaine x 2 [0,a] ? On notera
qu'en introduisant
(" mc2 )(" + mc2 )
" = E V0 , on a q 2 =
> 0.
c2
Les mêmes relations que dans l'étude de la barrière de potentiel dans le cadre
de l'équation de
Schrödinger conduisent, pour l'onde de KleinGordon, à la relation (que l'on
admettra) :
1
1 p q
qa
2
|T | =
+
et ' =
2 avec =
2 q p
~
|cos ' i sin '|
o 25. Déterminer la valeur maximale de |T |2 . Commenter.
FIN DE L'ÉPREUVE
Page 7/7
