CCINP Physique et Chimie MP 2025
| Thème de l'épreuve | Le synchrotron SOLEIL. La batterie au plomb. |
| Principaux outils utilisés | électromagnétisme, optique, cristallographie, solutions aqueuses, oxydoréduction, courbes courant-potentiel |
| Mots clefs | synchrotron, Michelson, quadrupôle, facteur de Lorentz, accumulateur au plomb, acide sulfurique |
Corrigé
:👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
👈 l'accès aux indications de tous les corrigés ne coûte que 1 € ⬅ clique ici
👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
👈 gratuite pour ce corrigé si tu crées un compte
-
Énoncé complet
(télécharger le PDF)











Rapport du jury
(télécharger le PDF)

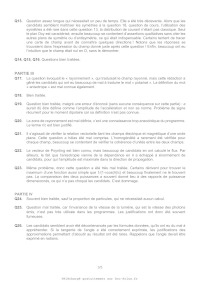
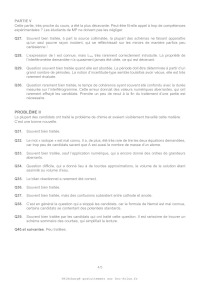

Énoncé obtenu par reconnaissance optique des caractères
SESSION 2025 MP2PC ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE MP ____________________ PHYSIQUE - CHIMIE Durée : 4 heures ____________________ N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre. RAPPEL DES CONSIGNES · · · Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, bleu clair ou turquoise, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats. Ne pas utiliser de correcteur. Écrire le mot FIN à la fin de votre composition. ______________________________________________________________________________ Les calculatrices sont interdites. Le sujet est composé de deux problèmes indépendants. 1/12 Problème I - le synchrotron SOLEIL Un synchrotron est un instrument électromagnétique de grande taille destiné à l'accélération de particules chargées. Le rayonnement synchrotron est un rayonnement électromagnétique émis par une particule chargée possédant une accélération. Ce rayonnement est utilisé pour des analyses physiques. Dans le synchrotron SOLEIL, situé à Saclay, des électrons, de masse notée me et de charge - e , accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière, sont déviés par des champs magnétiques. Le problème étudie quelques ordres de grandeurs liés au synchrotron SOLEIL. Il est constitué de 5 parties qui peuvent être résolues de manière indépendante les unes des autres. Après la partie I qui traite de généralités, la partie II étudie la déviation des électrons, la partie III le rayonnement émis, la partie IV la directivité du rayonnement et la partie V le principe de la spectrométrie. Le schéma général du synchrotron SOLEIL est rapporté figure 1. Figure 1 - Schéma général du synchrotron SOLEIL (d'après Reflets de la Physique n° 34-35) Données 8 1 Vitesse de la lumière dans le vide c = 3,0·10 m·s 31 2 2 Masse de l'électron me = 9,1·10 kg = 5,1·10 keV/c 19 Charge élémentaire e = 1,6·10 C 19 Valeur de l'électron-volt 1 eV = 1,6·10 J 34 Constante de Planck h = 6,6·10 J·s 23 1 Constante d'Avogadro NA = 6,0·10 mol 1 1 Constante molaire des gaz parfaits R = 8,3 J·K ·mol Bien que ces données soient fournies avec deux chiffres significatifs, les résultats numériques calculés seront fournis, sauf indication contraire, avec UN SEUL chiffre significatif. 2/12 Partie I - Généralités Des électrons non-relativistes, émis sans vitesse initiale, sont accélérés linéairement par un champ électrostatique uniforme et unidirectionnel E = E ex . Q1. Rappeler la relation qui lie le champ électrostatique au potentiel électrostatique V. En déduire l'énergie potentielle électrostatique de l'électron en fonction de e et de V. Q2. Calculer la différence de potentiel nécessaire pour obtenir une énergie cinétique finale Ec = 1,0 keV. Justifier. Q3. Dans la zone nommée Linac du synchrotron SOLEIL (figure 1), les électrons sont accélérés jusqu'à une énergie cinétique Ec = 100 MeV. Vérifier que leur vitesse v ne peut plus alors être calculée à l'aide de la forme de l'énergie cinétique utilisée en mécanique classique. Q4. Les électrons étant relativistes, leur énergie cinétique s'écrit : E= c - ( - 1) mec 2 1 v2 2 où = 1 - 2 est le facteur de Lorentz de l'électron. Calculer ce facteur. c Les électrons sont ensuite accélérés jusqu'à Ec = 2,7 GeV grâce à un autre accélérateur nommé booster, puis libérés dans l'anneau de stockage. Leur vitesse est alors assimilable à celle de la lumière. Q5. L'intensité du courant circulant dans l'anneau de stockage, assimilé à un cercle de rayon R = 57 m, vaut à un instant donné i = 0,43 A. Exprimer, puis calculer le nombre d'électrons N constituant le faisceau. Q6. Le vide dans l'anneau de stockage n'est pas parfait ; il subsiste principalement du dihydrogène, 13 sous une pression P = 6·10 bar. En utilisant un modèle connu, calculer la densité particulaire n du gaz résiduel à T = 298 K. Les chocs entre les N électrons d'un faisceau et les molécules de gaz résiduel fait varier le nombre d'électrons du faisceau. Pour une longueur dx de parcours, cette variation s'écrit : dN =- n N dx . Q7. Justifier dimensionnellement le nom de « section efficace » donné au coefficient . Q8. En raison de ces chocs, le faisceau a une durée de vie , définie comme la durée pour laquelle le nombre N d'électrons a diminué de 37 %. Exprimer en fonction de , n et de c. 2,0 10-23 cm2 dans le synchrotron. Calculer la durée de vie du faisceau. On Q9. On considère = donne ln(0,63) = 0,46. Expliquer comment l'intensité du faisceau peut rester constante. 3/12 Partie II - Éléments magnétiques L'anneau de stockage n'est pas rigoureusement circulaire : il est constitué de portions linéaires et d'éléments magnétiques qui sont des dipôles, des quadrupôles et des sextupôles. Q10. Expliquer comment on peut mesurer un champ magnétique au laboratoire. Les dipôles sont des aimants servant à courber la trajectoire des électrons. On considère une base cartésienne O, ex , ey , ez . Un dipôle crée un champ magnétique vertical supposé uniforme et ( ) stationnaire B = B0 ey , avec B0 > 0 . Q11. On considère un électron non relativiste pénétrant avec une vitesse v = v 0 ez , avec v 0 > 0, dans une zone où règne le champ magnétique B = B0 ey . En admettant que la trajectoire est circulaire de rayon RB, montrer que : B0 = p eRB (1) où p est la norme de la quantité de mouvement de l'électron. Exprimer la pulsation de rotation B de l'électron sur sa trajectoire. Q12. La relation (1) reste valable dans le cadre de la relativité restreinte, avec une norme de la E quantité de mouvement voisine de p c . Calculer la valeur du champ magnétique c permettant d'obtenir un rayon RB = 5,4 m pour la trajectoire. On rappelle que dans l'anneau de stockage Ec = 2,7 GeV. Les inhomogénéités de vitesse du paquet d'électrons entraînent une divergence du faisceau d'électrons, qui doit donc être focalisé. On utilise pour cela des quadrupôles, composés de quatre bobines disposées en carré (figure 2). y I I 45° A O B I Figure 2a) Quadrupôle, d'après Reflets de la physique n° 34 45° x z I Figure 2b) Schématisation des distributions de courants (en pointillés les axes des bobines ; les flèches donnent le sens des courants) 4/12 Q13. Expliquer pourquoi le champ en un point du plan xOy de la figure 2b est contenu dans ce plan. Donner la direction et le sens du champ au voisinage de l'origine : · sur l'axe Ox ; · sur l'axe Oy. Donner la valeur du champ à l'origine des coordonnées. On justifiera les réponses. Le champ magnétique créé par les quatre bobines peut s'écrire au voisinage de l'origine : B = ( Ky + K ) ex + ( Kx + K ) ey avec K et K constantes. Q14. Rappeler les deux équations locales vérifiées par le champ magnétique en régime stationnaire et montrer que le champ proposé vérifie ces équations. Donner la valeur de K . Q15. On suppose K > 0 . On considère un faisceau d'électrons de vitesse v = v 0 ez avec v 0 > 0, possédant une faible extension y autour de l'origine. Sur un schéma, dessiner le champ magnétique et la force exercée sur un électron aux points A ( 0, y 2,0 ) et B ( 0, -y 2,0 ) (figure 2b). En déduire que le faisceau est refocalisé au voisinage de l'origine grâce au quadrupôle. Q16. Montrer qu'un faisceau d'électrons possédant une extension x autour de l'origine sera cette fois défocalisé. Expliquer comment on peut disposer deux quadrupôles successifs pour pallier cet inconvénient. Le dispositif magnétique est complété par un sextupôle non étudié servant à corriger la trajectoire du faisceau électronique. Partie III - Rayonnement Des charges accélérées rayonnent une onde électromagnétique. Dans le cas du synchrotron SOLEIL, ce rayonnement est appelé « rayonnement synchrotron ». Q17. Le rayonnement synchrotron est anisotrope et polarisé. Définir ces 2 mots. Avant de s'intéresser au rayonnement émis par un électron accéléré, on va retrouver les principales caractéristiques du rayonnement d'accélération dans un cas simple : le rayonnement dipolaire électrique. On considère une charge fixe + e placée à l'origine O des coordonnées et un électron de charge - e en un point P, dont le mouvement avec le temps t s'écrit : OP ( t ) = l cos ( t ) ez avec et des constantes positives. On observe le champ à une distance r = OM grande devant . On adopte donc les coordonnées sphériques r, et associées aux vecteurs unitaires er , e , e (figure 3). 5/12 Figure 3 - Coordonnées sphériques Q18. Justifier que les composantes E , Br et B sont nulles. Justifier ensuite que les composantes non nulles des champs émis ne dépendent pas de . Q19. Exprimer l'accélération a de l'électron. Définir le moment dipolaire p0 associé à la distribution de charges et donner son amplitude p0 en fonction de e, et de a = a . Les champs électrique et magnétique dans la zone de rayonnement s'écrivent : r µ p 2 sin E=- 0 0 cos t - e 4 r c r µ p 2 sin B=- 0 0 cos t - e . 4 rc c Q20. Définir la zone de rayonnement et justifier le terme r/c apparaissant dans l'argument du cosinus. Q21. Montrer que l'onde a localement une structure d'onde plane. Qualifier la polarisation de l'onde. Vérifier l'homogénéité des champs. Q22. Définir et exprimer le vecteur de Poynting associé à l'onde émise. Déterminer dans quelle direction la puissance surfacique émise est maximale et exprimer la norme de la valeur moyenne du vecteur de Poynting dans cette direction. Dans le cas d'un électron relativiste rayonnant dans le synchrotron sur une trajectoire circulaire, la valeur moyenne du vecteur de Poynting dans la direction d'observation OM = r er est : relat e 2a 2 1 32 2 0c 3 r 2 v 1 - c cos e 4 r où est l'angle entre le vecteur vitesse v de l'électron et le vecteur er , v le module de la vitesse de l'électron et a le module de l'accélération de l'électron. 6/12 Q23. Donner la direction dans laquelle la puissance surfacique moyenne émise est maximale. Comparer alors qualitativement la valeur maximale de la norme de la moyenne du vecteur de Poynting dans le cas du rayonnement synchrotron et dans le cas du rayonnement dipolaire électrique. Commenter. Partie IV - Directivité du rayonnement synchrotron Les résultats précédents ont montré que le rayonnement est très intense dans une direction privilégiée, ce qui est dû à la très forte anisotropie du vecteur de Poynting. On s'intéresse dans cette partie à un modèle particulaire visant à expliquer la directivité du rayonnement synchrotron. On considère un électron se déplaçant à vitesse v = v ex par rapport à un référentiel . Dans le référentiel lié à l'électron, celui-ci émet des particules de manière isotrope dans le plan xOy (figure 4). La moitié des particules est donc émise dans le demi-espace x > 0 . y O électron x Figure 4 - Particules émises par un électron dans le référentiel Q24. On suppose que la règle de composition des vitesses est la règle de composition galiléenne. Exprimer et représenter la vitesse v p (par rapport à ) de la particule émise dans à la vitesse v p avec l'angle = / 2 (figure 4). En déduire l'angle ' formé par v p avec l'axe Ox en fonction de v et de v p = v p . Donner la proportion des particules émises dans le cône de demi-angle ' par rapport à . Q25. Le calcul précédent permet de comprendre qualitativement l'anisotropie du rayonnement lorsque les particules émises sont des photons, mais ne peut être exact. Expliquer pourquoi. Les formules de transformation des vitesses dans la relativité restreinte s'écrivent : v p = v p + v v p ; v p = vv v v p 1+ 2p 1+ 2 c c où v p (resp. v p ) est la composante de vitesse parallèle (resp. perpendiculaire) à v et = 1 1- v2 le facteur de Lorentz de l'électron. c2 7/12 Q26. En déduire que pour un électron ultrarelativiste du synchrotron, le demi-angle ' à l'intérieur 1 duquel est émis la moitié du rayonnement est tel que ' . Calculer ' pour = 5,0 104 . Conclure. Partie V - Principe de la spectrométrie d'absorption Le rayonnement synchrotron est utilisé pour sonder la matière, en particulier grâce à la technique de spectroscopie d'absorption qui permet de caractériser un milieu gazeux (nature, composition, température, densité) en mesurant les longueurs d'onde absorbées par le milieu. Cette technique d'analyse utilise un interféromètre de Michelson réglé en lame d'air, éclairé par une source collimatée permettant un éclairage en incidence normale par rapport à la lame d'air. L'intensité du rayonnement émergeant de l'interféromètre est mesurée par une photodiode placée au foyer image F d'une lentille convergente dont l'axe optique est parallèle aux rayons émergents de l'interféromètre. Le signal s fourni par la photodiode est proportionnel à l'intensité I en F , soit s = KI avec K une constante. Q27. Faire un schéma du dispositif, faisant apparaître les principaux éléments constitutifs de l'interféromètre, la source collimatée, le dispositif en sortie, ainsi que les rayons lumineux traversant l'interféromètre. L'interféromètre est éclairé par une source monochromatique de longueur d'onde m . Q28. Rappeler l'expression de l'intensité en F en fonction de l'épaisseur d de la lame d'air équivalente, de la longueur d'onde m et de l'intensité maximale Imax en F . L'indice de réfraction de l'air est confondu avec celui du vide. Préciser quelle propriété de l'interféromètre permet d'obtenir un contraste maximal. 7,0 10 Q29. L'épaisseur d augmente avec le temps à vitesse constante v 0 = -7 m s-1 à partir du contact optique, soit d = v 0t . Le signal s(t), appelé interférogramme, est donné figure 5. En déduire la longueur d'onde m et estimer son incertitude-type. Figure 5 - Interférogramme dans le cas d'une source monochromatique 8/12 On sélectionne en fait une bande spectrale dans le rayonnement synchrotron. La source est, de ce fait, quasi-monochromatique. On modélise son spectre par un profil gaussien de longueur d'onde moyenne m et de largeur spectrale à mi-hauteur (figure 6a). L'interférogramme obtenu sur une durée d'une minute a l'allure donnée figure 6b. m longueur d'onde Figure 6a - Profil spectral de la source Figure 6b - Interférogramme Q30. Déduire de l'interférogramme de la figure 6b une estimation de la longueur de cohérence de la source, puis de la largeur spectrale de la source. On rappelle la relation entre le temps de cohérence c et la largeur en fréquence v de la source : v c 1. Dans le cas général, une opération mathématique informatisée permet de déterminer le spectre à partir de l'interférogramme. 9/12 Problème 2 - la batterie au plomb On appelle "batterie" un ensemble d'accumulateurs électriques. Le problème étudie quelques ordres de grandeurs liées aux batteries au plomb contenues dans les voitures. Données M (Pb ) 207,2 g mol-1 = Masse molaire moyenne du plomb Masse volumique de l'acide sulfurique pur liquide (H2SO4) = 1,8·103 kgm3 Masse volumique de l'eau pure liquide (H2O) = 1,0· 103 kgm3 Masse molaire de l'acide sulfurique M(H2SO4) = 98 gmol1 Masse molaire de l'eau M(H2O) = 18 gmol1 Constante de Faraday = F eN = 96 500 C mol-1 A Constante d'Avogadro NA = 6,0·1023 mol1 Potentiels standard à 25 °C E1°( PbSO4(s)/Pb(s)) = 0,35 V ; E2°( PbO2(s) / PbSO4(s)) = 1,69 V RT On assimile la quantité ln10 à 0,06 V à T = 298 K avec R la constante molaire du gaz parfait. F La notation [ X ] représente la concentration molaire volumique de l'espèce X. Rappel : bien que ces données soient fournies avec plusieurs chiffres significatifs, les résultats numériques seront donnés avec UN SEUL chiffre significatif. Historiquement, les batteries contenues dans les voitures sont au plomb (figure 7). Figure 7- Une batterie au plomb commerciale Q31. Préciser la composition d'un atome de plomb 207 82 Pb . Q32. Les quatre isotopes stables du plomb 204Pb, 206Pb, 207Pb et 208Pb, sont présents dans la nature dans des proportions respectives de x %, y %, 22 % et 52 %. Définir le mot isotope. Donner les équations permettant de calculer les pourcentages x et y. On ne cherchera pas à déterminer x et y. Q33. Le plomb cristallise dans le système cubique à faces centrées (CFC), avec un paramètre de 2 maille a = 5,0·10 pm. Faire un schéma de la maille conventionnelle et calculer la masse volumique moyenne du plomb. 10/12 Le schéma d'un élément d'une batterie de voiture au plomb est le suivant : (-) Pb(s), SO42 (aq) PbSO4(s) H2SO4(aq) PbSO4(s) PbO2(s), SO42 (aq) , H+(aq) Pb(s) (+) Electrode négative électrode positive électrolyte Un élément de batterie est constitué d'une électrode de plomb Pb et d'une électrode de dioxyde de plomb PbO2 plongeants dans une solution aqueuse concentrée d'acide sulfurique H2SO4 avec présence d'un précipité de sulfate de plomb PbSO4. À l'électrode positive, le plomb Pb sert uniquement de support conducteur. Q34. La solution aqueuse d'acide sulfurique utilisée est en général à 33 % en masse en H2SO4. En 1 déduire que sa concentration molaire volumique est C = 4 mol·L . Q35. En considérant le diacide H2SO4 comme fort pour ses deux acidités et en assimilant l'activité 1 d'un soluté à la valeur numérique de sa concentration (exprimée en mol·L ), estimer le pH de la solution d'acide sulfurique à 33 %. Commenter. On donne log10 2 = 0,3. 8 Q36. Le produit de solubilité du sulfate de plomb est Ks = 1,6·10 . Calculer la concentration en quantité de matière d'ions Pb2+ pour laquelle le solide apparaît dans la solution sulfurique à 33 %. Donner la forme prépondérante sous laquelle se trouve le plomb au degré d'oxydation II au-delà de cette valeur de concentration. Q37. Écrire les demi-réactions anodique (1) et cathodique (2) relatives au plomb. En déduire l'équation-bilan de réaction de décharge, puis l'équation-bilan de réaction de recharge. Q38. Calculer la fém e d'un élément de batterie, en considérant [H+]2[SO42] / (C0)3 = 100 avec 1 C0 = 1 mol·L . Calculer le nombre d'éléments à associer pour réaliser une batterie 12 V et indiquer le mode d'association. On donne en figure 8 les courbes intensité-potentiel relatives à la batterie au plomb. I (A) (1) (2) I0 (3) 0,0 (4) (5) 2,0 1,0 (6) -I0 Figure 8 - Courbes intensité-potentiel d'une batterie au plomb 11/12 E(V) Q39. Identifier les courbes (1) à (6), sachant que les courbes en pointillés sont relatives aux couples de l'eau. Q40. Évaluer avec deux chiffres significatifs la tension réellement disponible à la décharge de la batterie pour l'intensité I0 indiquée sur la figure 8. Q41. Calculer la tension du générateur permettant la recharge avec une intensité I0. Identifier le risque que l'on prend en augmentant cette tension, la batterie étant scellée. Outre sa tension, l'une des principales caractéristiques d'une batterie est sa capacité : c'est-à-dire la charge Q pouvant être extraite de la batterie. Q42. On considère une batterie de capacité Q = 40 A·h. Calculer la masse de plomb oxydée si l'on décharge la batterie à 50 %. Q43. L'un des principaux défauts de cette batterie est sa faible énergie massique w. Calculer l'énergie massique de la batterie représentée figure 7, dont la masse est m = 9,8 kg. On 1 donnera le résultat en W·h·kg . La fin de vie des batteries au plomb est généralement due à la dégradation de la grille de plomb à la borne positive, qui peut s'oxyder en PbO2. Q44. Écrire la demi-équation électronique correspondante. Cette dégradation aura-t-elle lieu à la charge ou à la décharge de la batterie ? I M P R I M E R I E N A T I O N A L E 25 1043 D'après documents fournis FIN 12/12
