CCINP Informatique optionnelle MP 2025
| Thème de l'épreuve | Répartition de la gestion d'un réseau minimisant la bande passante |
| Principaux outils utilisés | graphes, arbres, théorie des jeux, SQL, OCaml, Python |
| Mots clefs | arbre couvrant, algorithme de Boruvka, bande passante, graphe pondéré |
Corrigé
:👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
👈 l'accès aux indications de tous les corrigés ne coûte que 1 € ⬅ clique ici
👈 gratuite pour tous les corrigés si tu crées un compte
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
👈 gratuite pour ce corrigé si tu crées un compte
- - - -
Énoncé complet
(télécharger le PDF)















Rapport du jury
(télécharger le PDF)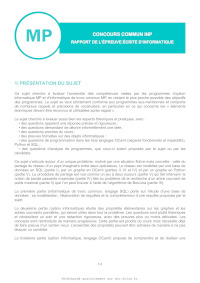
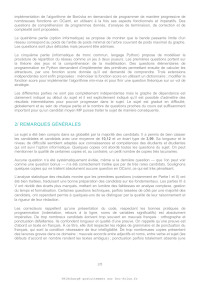
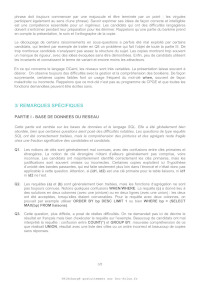

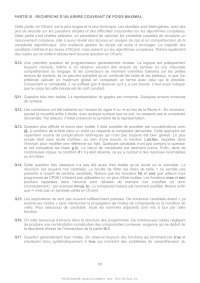
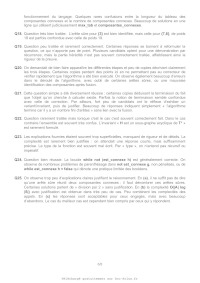
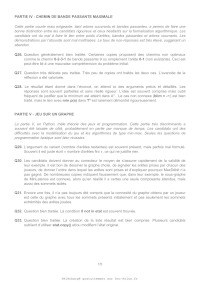
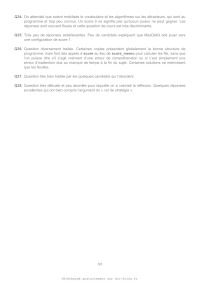
Énoncé obtenu par reconnaissance optique des caractères
SESSION 2025
MP7IN
ÉPREUVE MUTUALISÉE AVEC E3A-POLYTECH
ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - FILIÈRE MP
____________________
INFORMATIQUE
Durée : 4 heures
____________________
N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la
précision et à la concision de la rédaction.
Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur
d'énoncé, il le signalera sur sa copie
et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives
qu'il a été amené à prendre.
RAPPEL DES CONSIGNES
·
·
·
Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction
de votre composition ; d'autres
couleurs, excepté le vert, bleu clair ou turquoise, peuvent être utilisées,
mais exclusivement pour les schémas
et la mise en évidence des résultats.
Ne pas utiliser de correcteur.
Écrire le mot FIN à la fin de votre composition.
______________________________________________________________________________
Les calculatrices sont interdites.
Le sujet est constitué d'un unique problème et comporte cinq parties qui ne
sont pas
complètement indépendantes.
1/16
Répartition de la gestion d'un réseau minimisant la bande passante
Le Listenbourg (figure 1) est une république fictive de la péninsule ibérique,
comportant environ
66 millions d'habitants, née sur les réseaux sociaux en octobre 2022. Au
Listenbourg deux fournisseurs d'accès, MaxDébit et MinLatence, cherchent à se
partager la gestion d'un tout nouveau réseau :
l'Ultranet.
Figure 1 - La république imaginaire du Listenbourg
Le graphe simplifié du réseau Ultranet de ce pays est représenté à la figure 2.
Le nom des villes
correspondant aux identifiants des sommets est enregistré dans la base de
données (figure 3). Une
arête relie deux villes lorsqu'un câblage physique direct est établi entre
elles et la bande passante
permise par ce câblage est indiquée comme poids. Il y a au plus une arête entre
deux villes. La
structure du réseau Ultranet a été intégralement terminée lors du grand plan «
Réseau pour Tous »
mené par le premier ministre Petro Sank-Ærixh et il s'agit désormais d'en
confier l'exploitation aux
deux fournisseurs d'accès concurrents.
Dans ce sujet, on s'intéresse à une procédure de partage de la gestion du
réseau entre les deux opérateurs. On suppose qu'une liaison entre deux villes
ne peut être exploitée que par l'un ou par l'autre
des deux fournisseurs d'accès qui en aura alors l'usage exclusif. Le
gouvernement du Listenbourg
ne souhaite pas s'embarrasser avec une procédure complexe d'appel d'offre et
impose la procédure
simple suivante pour répartir l'exploitation exclusive des liaisons physiques
du réseau :
· tant qu'il reste des liaisons à attribuer, chaque opérateur, à tour de rôle
et en commençant par
MaxDébit, choisit parmi les liaisons restantes une liaison qu'il souhaite
exploiter exclusivement.
Une fois la procédure de répartition terminée, c'est-à-dire une fois que toutes
les liaisons ont été
attribuées, chaque fournisseur d'accès dispose de son propre sous-réseau
exclusif, dont la gestion
lui revient entièrement. L'objectif d'un fournisseur d'accès est d'obtenir un
sous-réseau permettant de
proposer la meilleure bande passante possible entre deux villes quelconques du
pays.
2/16
7
19
18
6
8
0
16
24
21
11
2
9
22
3
7
4
4
17
13
1
6
8
23
5
5
12
Figure 2 - Réseau simplifié du Listenbourg
La première partie du sujet s'intéresse à l'étude d'une base de données du
réseau mise à disposition des fournisseurs d'accès (informatique de tronc
commun, langage SQL). La deuxième partie
introduit et étudie quelques propriétés de l'arbre couvrant de poids maximal
(option informatique). La
troisième partie s'intéresse à la recherche de l'arbre couvrant de poids
maximal en utilisant l'algorithme de Borvka (option informatique, langage
OCaml). La quatrième partie se propose de montrer
que la bande passante limite d'un réseau correspond au poids de l'arête de
poids minimal de l'arbre
couvrant de poids maximal du graphe (option informatique). La cinquième partie
propose de modéliser la procédure de répartition de la gestion du réseau comme
un jeu à deux joueurs (informatique
de tronc commun, langage Python).
Les cinq parties sont essentiellement indépendantes dans leur traitement mais
des notions utiles
à la résolution d'une partie peuvent être introduites dans les parties
précédentes. La partie I est
indépendante des quatre autres. La partie II introduit des notions utiles à la
résolution des parties III
et IV. La partie IV introduit des concepts utilisés dans la partie V.
Dans tout le sujet, il est toujours admis d'utiliser un résultat ou un
programme correspondant à une
question précédente, même si cette question n'a pas été résolue.
3/16
Partie I - Base de données du réseau
Le ministère des affaires environnementales, des ressources, de l'agriculture
et des forêts du Listenbourg met à disposition des deux fournisseurs d'accès
une base de données relationnelle. Celle-ci
comporte deux tables dont le schéma est le suivant :
· villes(id : entier, nom : texte, pop : flottant)
· liaisons(id1 : entier, id2 : entier, bp : flottant)
Un enregistrement de la table villes comporte l'identifiant unique d'une ville
(id), le nom de cette ville
(nom) et sa population en millions d'habitants (pop). A priori, plusieurs
villes du Listenbourg peuvent
porter le même nom. Un enregistrement de la table liaisons correspond à une
liaison physique directe entre deux villes données par leur identifiant (id1,
id2) ainsi que la bande passante en T b.s-1
correspondant à ce câblage (bp). On garantit que dans la représentation d'une
liaison, l'identifiant de
la première ville est toujours strictement inférieur à celui de la deuxième
ville. Rappelons qu'il ne peut
exister qu'au plus une liaison entre deux villes.
Un exemple simplifié du contenu de cette base de données, correspondant au
graphe simplifié du
réseau du Listenbourg de la figure 2, est donné figure 3.
id
0
1
2
3
4
5
6
7
8
villes
nom
Lurenberg
Veroja
Aschlöss
Stratord
Gossard
La Galinera
Sainte Marie
Atlanitkischer
Gasparländ
id1
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
4
5
7
pop
12.0
10.0
8.0
5.2
5.1
5.0
5.0
4.7
3.5
liaisons
id2
bp
2 24.0
6 21.0
7 18.0
8
6.0
2
4.0
3 17.0
4 13.0
5 12.0
3
9.0
4
7.0
6 22.0
8 16.0
8
11.0
5 23.0
6
8.0
6
5.0
8 19.0
Figure 3 - Contenu de la base de données correspondant au réseau simplifié de
la figure 2
4/16
Q1.
Q2.
Au vu de la situation modélisée, proposer des clés primaires pour les tables
villes et liaisons,
en justifiant succinctement. Identifier les clés étrangères présentes dans ce
schéma relationnel.
Pour chacune des questions suivantes on demande d'écrire une requête SQL
portant sur le
schéma relationnel proposé qui fonctionnerait quel que soit le contenu de la
base de données
et pas uniquement sur l'exemple de contenu proposé à la figure 3.
(a) Écrire une requête SQL qui donne les noms des villes comportant strictement
plus de
cinq millons d'habitants ;
(b) Écrire une requête SQL qui donne la bande passante moyenne des liaisons
incidentes
à la ville d'identifiant 2 ;
(c) Écrire une requête SQL qui donne les noms des deux villes reliées par la
liaison de
bande passante maximale. On suppose que toutes les liaisons ont une bande
passante
différente.
Q3.
Déterminer le résultat de la requête SQL suivante sur l'exemple de contenu de
la base de
données représentée à la figure 3.
SELECT nom, COUNT(*) AS d
FROM villes
JOIN (SELECT id1 AS x, id2 FROM liaisons UNION SELECT id2 AS x, id1 FROM
liaisons)
ON id = x
GROUP BY id
HAVING d >= 4
ORDER BY id ASC
Partie II - Arbre couvrant de poids maximal
II.1 - Acyclicité, connexité et arbres
Un graphe (non orienté) est un couple G = (S , A) formé d'un ensemble S fini
non vide de sommets et
d'un ensemble A d'arêtes constitué de parties de S de cardinal 2. On note |S |
le nombre de sommets
de G et |A| le nombre d'arêtes de G. Les voisins d'un sommet x S sont notés
V(x) et leur nombre
d(x) = |V(x)| est le degré de x.
Un chemin dans un graphe est une suite c = x0 x1 . . . xn de sommets avec i 0,
n - 1, {xi , xi+1 } A.
La longueur |c| d'un tel chemin est n N. Un chemin est élémentaire si tous les
sommets empruntés
par ce chemin sont deux à deux distincts. Un chemin est simple si toutes les
arêtes empruntées par
ce chemin sont deux à deux distinctes.
Un cycle est un chemin simple x0 x1 . . . xn avec n 3 et x0 = xn . Un graphe
est acyclique s'il ne
comporte pas de cycle.
Un graphe est connexe si deux sommets quelconques sont toujours reliés par un
chemin. Une composante connexe est un ensemble C S de sommets dont tous les
couples de sommets sont reliés
par au moins un chemin.
Un arbre est un graphe connexe acyclique.
Si a = {x, y} est une partie de S de cardinal 2, on note G + a le graphe (S , A
{a}), c'est-à-dire le graphe
G auquel on a ajouté l'arête a et G - a le graphe (S , A \ {a}), c'est-à-dire
le graphe G auquel on a retiré
l'arête a.
5/16
Q4.
Montrer que si G = (S , A) est un graphe connexe et que si a = {x, y} A est
une arête de G
appartenant à un cycle de G, alors le graphe G - a est encore connexe.
On admet la proposition suivante :
Proposition 1 : relation entre |S | et |A| pour les graphes connexes ou
acycliques
Soit G = (S , A) un graphe :
(a) si G est connexe alors |A| |S | - 1 ;
(b) si G est acyclique alors |A| |S | - 1.
Q5.
Montrer que si G = (S , A) est connexe et que |A| = |S | - 1 alors G est un
arbre.
II.2 - Sous-graphe et arbre couvrant
Dans tout ce sujet un sous-graphe d'un graphe G est un graphe G = (S , A ) avec
A A. Notons qu'un
sous-graphe de G comporte exactement les mêmes sommets que G. On identifie un
sous-graphe
G = (S , A ) avec le sous-ensemble d'arêtes A A. Un arbre couvrant de G est un
sous-graphe de G
qui est un arbre.
Q6.
Montrer qu'un graphe G = (S , A) est connexe si et seulement s'il admet un
arbre couvrant.
Q7.
Soit T = (S , A ) un arbre couvrant de G avec A A et a A \ A .
(a) Justifier que T + a n'est pas acyclique.
(b) Soit a A une arête d'un cycle de T + a. Montrer que T + a - a est un arbre
couvrant
de G.
II.3 - Graphes pondérés et arbre couvrant de poids maximal
Un graphe pondéré est un triplet (S , A, p) où (S , A) est un graphe et p : A
R une fonction de
pondération des arêtes. Si {x, y} A est une arête, p({x, y}) est appelé le
poids de cette arête. Le
poids d'un graphe pondéré est la somme des poids de ses arêtes :
p(a).
p(G) =
aA
On étend la notion de sous-graphe aux graphes pondérés de la manière suivante :
un sous-graphe
d'un graphe pondéré G = (S , A, p) est un graphe pondéré G = (S , A , pA ) où A
A et où pA est la
restriction de p à A . On se permettra de ne pas systématiquement indiquer la
fonction de pondération.
Le plan « Réseau pour Tous » du gouvernement a permis d'interconnecter toutes
les villes du Listenbourg. On considèrera donc en général un graphe pondéré G =
(S , A, p) non orienté connexe, avec
la fonction de pondération correspondant à la bande passante associée à chaque
liaison. Chaque
province ayant opté pour son propre câblage, deux villes ne sont jamais reliées
par le même type
de câblage et la bande passante de deux liaisons est toujours différente. Ceci
se traduit donc par
une fonction de pondération p injective : dans toute la suite du sujet, les
poids des arêtes de G sont
toujours deux à deux distincts.
On se propose de démontrer la proposition 2 suivante :
Proposition 2 : existence et unicité de l'arbre couvrant de poids maximal
Soit G = (S , A, p) un graphe connexe muni d'une fonction de pondération
injective. Alors, il
existe un unique arbre couvrant de poids maximal de G. On note T = (S , A )
cet arbre couvrant.
Q8.
Montrer l'existence d'un arbre couvrant de poids maximal de G.
6/16
Q9.
Pour montrer l'unicité, on se propose de procéder par l'absurde. Supposons
l'existence de
deux arbres couvrants de poids maximal T 1 = (S , A1 ) et T 2 = (S , A2 )
différents. Considérons
une arête de poids maximal parmi les arêtes qui appartiennent à un seul des
deux arbres,
c'est-à-dire une arête de poids maximal dans (A1 \ A2 ) (A2 \ A1 ), qui est
bien non vide puisque
A1 A2 . Sans perte de généralité, on peut noter a2 une telle arête et supposer
que a2 A2 \ A1 .
(a) Montrer qu'il existe une arête a1 A1 \ A2 sur un cycle de T 1 + a2 .
(b) Conclure en considérant le sous-graphe T 1 + a2 - a1 .
Partie III - Recherche d'un arbre couvrant de poids maximal
III.1 - Rappels et fonctions élémentaires en OCaml
On rappelle que, dans le langage OCaml :
· on peut représenter des tableaux par le type 'a array ;
· si e est une expression de type 'a , l'expression Array.make n e permet de
créer un tableau
de type 'a array de n N cases dont toutes les cases contiennent la valeur de
l'expression
e;
Array.make : int -> 'a -> 'a array
· si a est un tableau de type 'a array de taille n N, l'expression
Array.length a permet
d'obtenir la valeur n ;
Array.length : 'a array -> int
· si 0 i < n, l'expression a.(i) s'évalue en la valeur contenue à la case i du tableau a et si e est une expression de type 'a , l'expression a.(i) <- e permet de remplacer la valeur contenue à la case i du tableau a par la valeur de l'expression e ; · la fonction List.iter a le comportement suivant : si f est une fonction de type 'a -> unit ,
alors l'expression List.iter f [a1; a2; ...; an] est équivalente à f a1; f a2;
...; f an ;
List.iter : ('a -> unit) -> 'a list -> unit
· une boucle for i = a to b do ... done permet de faire évoluer une variable i
entre les
valeurs entières a et b incluses ;
· il existe deux fonctions max et min de type 'a -> 'a -> 'a .
Q10. Écrire une fonction max_tab : int array -> int telle que, pour un tableau
d'entiers a de
taille n 1, max_tab a renvoie la valeur du plus grand entier contenu dans a .
On attend une
complexité linéaire en n, ce que l'on justifiera en une phrase.
7/16
III.2 - Représentation des graphes en OCaml
On représente un graphe pondéré G = (S , A, p), avec S = 0, n - 1 et n N par
un tableau de listes
d'adjacence pondérées.
type graphe = (int * float) list array
Si g représente un graphe et si 0 i < n est un sommet, alors g.(i) contient la liste des couples , c'est-à-dire la liste des couples de la forme ( j, w) avec w = p({i, j}) et j voisin de i. j, p({i, j}) jV(i) Remarquons que puisque les graphes sont non orientés, si i est dans la liste d'adjacence de j, alors j est dans la liste d'adjacence de i avec le même poids. Par exemple, si g est le graphe de la figure 2, on a g.(0) qui vaut par exemple : [(2, 24.0); (6, 21.0); (7, 18.0); (8, 6.0)] Le nombre de sommets du graphe correspond donc à la taille du tableau de listes d'adjacences : let nb_sommets g = Array.length g Q11. Donner une valeur possible pour g.(7) . On représente une arête par un triplet (w, i, j) où w = p({i, j}) et où i < j. Remarquons que chaque arête est ainsi représentée exactement une fois et qu'une arête commence par son poids. Q12. Écrire en OCaml une fonction ajoute_arete : graphe -> (float * int * int)
-> unit
telle que ajoute_arete g (w, i, j) permet d'ajouter au graphe g l'arête (w, i,
j) . On
suppose que cette arête n'était pas déjà présente et la complexité doit être en
temps constant.
Q13. Écrire en OCaml une fonction toutes_les_aretes : graphe -> (float * int *
int) list
qui permet d'obtenir la liste des arêtes d'un graphe avec la convention
ci-dessus. On attend
une complexité linéaire en |S | + |A|, ce que l'on justifiera rapidement.
Si a1 et a2 sont deux arêtes de type float * int * int , l'expression a1 < a2 compare les arêtes pour l'ordre lexicographique des triplets donc pour la valeur du poids de l'arête en premier. Comme dans ce sujet on suppose toujours que tous les poids sont deux à deux distincts, on peut directement utiliser l'ordre OCaml < sur les arêtes pour comparer les poids des arêtes. Ainsi par exemple, min a1 a2 s'évalue en l'arête de poids minimal entre a1 et a2 . Q14. Écrire une fonction min_arete : (float * int * int) list -> (float * int *
int) de
manière récursive en OCaml qui renvoie l'arête de poids minimal d'une liste
d'arêtes supposée
non vide. Quelle est sa complexité ?
8/16
III.3 - Recherche des composantes connexes
Pour un graphe G = (S , A, p) avec S = 0, n - 1, on cherche à construire un
tableau c de taille n
représentant les composantes connexes du graphe. Les composantes connexes sont
indexées entre
0 et p - 1 où p est le nombre de composantes connexes du graphe. Pour 0 i < n la case c.(i) comporte l'indice k de la composante connexe du sommet i (ou la valeur -1 si cette composante n'a pas encore été déterminée). On considère la fonction explorer : graphe -> int array -> int -> int -> unit
suivante pour
un graphe g , un tableau c de taille n, un identifiant de composante connexe 0
k < p et un sommet de départ s, vérifiant la convention suivante : « un sommet 0 i < n a été visité si et seulement si c.(i) >= 0 ».
1
2
3
4
5
let rec explorer g c k s =
if c.(s) < 0 then begin c.(s) <- k; List.iter (fun (v, _) -> explorer g c k v) g.(s)
end
Q15. Décrire précisément ce que réalise un appel à explorer g c k s .
Q16. Écrire en OCaml une fonction composantes_connexes : graphe -> int array
telle que,
pour un graphe g , composantes_connexes g s'évalue en le tableau c des indices
des composantes connexes. Cette fonction doit avoir une complexité en O(|S | +
|A|) que l'on ne demande
pas de justifier.
Q17. En déduire une fonction est_connexe : graphe -> bool telle que est_connexe
g s'évalue
à true si le graphe g est connexe et à false sinon.
III.4 - Algorithme de Borvka
Dans toute cette sous-partie, on considère un graphe G = (S , A, p) connexe
avec une fonction de
pondération p injective. On note T = (S , A ) l'unique arbre couvrant de poids
maximal de G.
Considérons H = (S , B) un sous-graphe acyclique de G, avec donc B A. On
considère C S une
composante connexe de H. Une arête sûre pour C est une arête de A ayant
exactement une extrémité
dans C dont le poids est maximal parmi les arêtes qui ont exactement une
extrémité dans C.
Par exemple, pour le sous-graphe H de la figure 4 et pour la composante connexe
{1, 4, 5, 6} l'arête de
poids 22 est sûre (maximale parmi les arêtes de poids 4, 7, 17, 21 et 22 qui
sont celles ayant exactement
une extrémité dans cette composante). Sauf si H est connexe, chaque composante
connexe de
H comporte exactement une arête sûre. Une même arête peut être sûre pour deux
composantes
connexes C et C . Dans l'exemple de la figure 4, l'arête de poids 22 est
également l'arête sûre pour
la composante connexe {0, 2}.
Q18. Déterminer l'arête sûre pour la composante {3} ainsi que celle pour la
composante {7, 8}.
Q19. On suppose dans cette question que H = (S , B) est un sous-graphe
acyclique de l'arbre couvrant T = (S , A ) de poids maximal de G, et donc que
B A . Montrer que A contient toutes
les arêtes sûres des composantes connexes de H.
9/16
7
19
18
6
8
0
16
24
11
21
2
9
3
22
7
4
17
1
6
8
4
13
23
5
5
12
Figure 4 - Un sous-graphe H du graphe de la figure 2, comportant quatre
composantes connexes.
Les arêtes qui n'appartiennent pas au sous-graphe sont représentées en
pointillés
L'idée de l'algorithme de Borvka, dont le pseudocode est donné par l'algorithme
1, est de construire
progressivement un sous-graphe acyclique H = (S , B) de l'arbre couvrant de
poids maximal T = (S , A ).
Au départ B = . À chaque étape, on ajoute au sous-graphe acyclique H en cours
de construction
toutes les arêtes sûres pour les composantes connexes de H.
Algorithme 1 : algorithme de Borvka
Entrée : Graphe G = (S , A, p) pondéré injectivement et connexe
Sortie : H = (S , B) l'arbre couvrant de poids maximal de G
1 H = (S , ) ;
2 tant que H n'est pas connexe faire
3
ajouter à H toutes les arêtes sûres pour les composantes connexes de H ;
4 fin
Q20. Donner le déroulé de l'algorithme 1 sur le graphe G de la figure 2.
Indiquer à chaque étape
et pour chaque composante connexe son arête sûre et indiquer l'ensemble des
arêtes sûres
ajoutées à chaque étape.
Q21. Montrer que l'algorithme de Borvka termine.
Q22. Montrer que l'algorithme de Borvka renvoie l'arbre couvrant de poids
maximal T = (S , A ) de
G.
10/16
On considère la fonction suivante qui prend en entrée un graphe g représentant
le graphe G = (S , A, p)
connexe pondéré et un graphe h représentant un sous-graphe acyclique H = (S ,
B) de G supposé
non encore connexe.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
let aretes_sures g h =
let c = composantes_connexes h in
let p = max_tab c + 1 in
let aretes = toutes_les_aretes g in
let sures = Array.make p (min_arete aretes) in
let traite a =
let (_, i, j) = a in
if c.(i) <> c.(j) then begin
sures.(c.(i)) <- max a sures.(c.(i)); sures.(c.(j)) <- max a sures.(c.(j)); end in List.iter traite aretes; sures Q23. Déterminer le type de cette fonction. Expliquer ce que réalise cette fonction et préciser la structure et le contenu de la valeur renvoyée. Déterminer sa complexité en fonction de |A| en justifiant. On remarquera que d'après la proposition 1, puisque le graphe G est connexe, on a |S | - 1 |A| et donc qu'un O(|S |) est un O(|A|). On suppose disposer d'une fonction : ajoute_aretes_sures : graphe -> (float * int * int) array -> unit
telle que si h représente un sous-graphe acyclique de G et que sures est la
valeur renvoyée par
aretes_sures g h alors ajoute_aretes_sures h sures ajoute à h toutes les arêtes
contenues
dans sures . On garantit que cette fonction est en complexité O(|A|) et qu'elle
n'ajoute qu'une seule
fois une même arête à h même si cette arête est sûre pour deux composantes
connexes différentes.
Q24. Écrire en OCaml une fonction borukva : graphe -> graphe telle que borukva
g sur un
graphe g s'évalue en un sous-graphe h de G correspondant à son arbre couvrant
de poids
maximal.
Q25. On s'intéresse maintenant à la complexité temporelle de cet algorithme.
(a) Montrer qu'à chaque passage dans la boucle tant que à la ligne 2 de
l'algorithme 1, le
nombre de composantes connexes de H est divisé au moins par 2.
(b) En déduire la complexité temporelle dans le pire cas de l'algorithme de
Borvka.
(c) Quelle est la complexité temporelle de cet algorithme dans le meilleur cas ?
Partie IV - Chemin de bande passante maximale
Dans cette partie, on considère un graphe pondéré G = (S , A, p), non
nécessairement connexe, mais
dont la fonction de pondération est injective.
11/16
On définit la bande passante d'un chemin c = x0 x1 . . . xn comme la quantité :
b(c) = min p({xi , xi+1 })
0in-1
c'est-à-dire le poids minimal d'une arête de ce chemin. En effet, la bande
passante d'un chemin est
limitée par la plus petite bande passante des arêtes de ce chemin. La bande
passante d'un chemin
de longueur nulle est +.
Pour deux sommets x, y S , un chemin de bande passante maximale entre x et y
est un chemin c
qui relie x à y dont la bande passante est maximale parmi tous les chemins
entre x et y. Un chemin
de bande passante maximale est ainsi un chemin permettant de maximiser la bande
passante entre
deux villes, ce que cherchent à réaliser les opérateurs MaxDébit et MinLatence.
On note :
bmax (x, y) = max b(c) | c chemin de x à y
la bande passante d'un chemin de bande passante maximale de x à y. On a bmax
(x, y) = - si x et
y ne sont pas reliés par au moins un chemin. Notons que cette quantité est bien
définie, l'ensemble
des arêtes étant fini, il y a un nombre fini de valeurs possibles pour la bande
passante d'un chemin
de x à y.
Q26. Déterminer un chemin de bande passante maximale entre Lurenberg
(d'identifiant 0) et Veroja
(d'identifiant 1) sur le graphe de la figure 2. Quelle est sa bande passante ?
On admet que dans un arbre il existe un unique chemin élémentaire entre tout
couple de sommets.
Q27. Soient x, y S , montrer que l'unique chemin de x à y dans l'arbre
couvrant de poids maximal
T est un chemin de bande passante maximale entre x et y.
Un fournisseur d'accès cherche à pouvoir offrir un chemin avec la bande
passante la plus grande
possible entre tous les couples de villes possibles. Plus précisément, il
s'intéresse à la quantité :
blim (G) = min bmax (x, y) | x, y S
appelée la bande passante limite d'un graphe G.
Q28. Justifier que
-
blim (G) =
min p(a) | a A
si G n'est pas connexe
avec T = (S , A ) l'arbre couvrant de poids maximal de G sinon.
Partie V - Jeu sur un graphe
Dans cette partie, on suppose que G = (S , A, p) est un graphe pondéré connexe
muni d'une fonction
de pondération injective.
V.1 - Procédure de partage vue comme un jeu
On peut voir la procédure de partage du réseau décrite dans l'introduction du
sujet comme un jeu à
deux joueurs. Les deux joueurs sont MaxDébit (joueur max associé à la valeur 1)
et MinLatence (joueur
min associé à la valeur -1).
Une configuration est la donnée de deux sous-graphes G1 et G-1 de G, d'arêtes
disjointes, correspondant aux choix des arêtes effectués jusque-là par les deux
joueurs, ainsi que la donnée du joueur
qui doit jouer (il s'agit du joueur qui contrôle cette configuration). Un coup
possible consiste à choisir
une nouvelle arête du graphe non encore attribuée.
Une configuration est finale lorsque toutes les arêtes ont été attribuées et
donc lorsque les arêtes
de G1 et G-1 partitionnent celles de G. La configuration initiale est contrôlée
par MaxDébit et est
composée de deux sous-graphes sans arêtes.
12/16
Pour tester la viabilité de cette procédure, le gouvernement commence par
effectuer un essai sur le
réseau de l'île de Korße rattachée au Listenbourg, représenté à la figure 5.
6
0
5
7
8
3
1
5
7
2
2
6
0
1
8
2
3
2
(a)
3
3
(b)
Figure 5 - (a) Le graphe correspondant au réseau de l'île de Korße. (b) Exemple
de configuration finale
(contrôlée par MaxDébit) atteinte à l'issue d'une partie. Les arêtes choisies
par le joueur MaxDébit sont
représentées par un trait discontinu et celle par le joueur MinLatence par une
ligne en pointillés
Un exemple possible de partie de ce jeu, dont l'issue est représentée à la
figure 5, est la suivante :
· l'arête {1, 3} est choisie par MaxDébit ;
· l'arête {0, 1} est choisie par MinLatence ;
· l'arête {1, 2} est choisie par MaxDébit ;
· l'arête {2, 3} est choisie par MinLatence ;
· l'arête {0, 2} est choisie par MaxDébit ;
· l'arête {0, 3} est choisie par MinLatence.
Ici les deux opérateurs obtiennent la gestion d'un sous-réseau qui est
exactement un arbre couvrant,
mais ce n'est pas le cas en général, le sous-graphe correspondant au
sous-réseau obtenu par un
joueur pouvant même ne pas être connexe.
La partie IV montre que l'objectif d'un fournisseur d'accès est de choisir un
sous-graphe G de manière
à maximiser la quantité blim (G ), c'est-à-dire de maximiser la bande passante
limite du sous-graphe.
D'après la partie IV, pour cela, il s'agit tout d'abord d'obtenir un
sous-graphe G connexe (sans quoi
blim (G ) = -) puis, le cas échéant, de considérer l'arête de poids minimal de
l'arbre couvrant de
poids maximal de G , blim (G ) étant alors le poids de cette arête. Un
fournisseur d'accès estime qu'il
est gagnant si la bande passante limite de son sous-graphe blim (G ) est
strictement supérieure à celle
de son concurrent. Une configuration finale est donc gagnante pour MaxDébit si
blim (G1 ) > blim (G-1 )
et gagnante pour MinLatence si blim (G1 ) < blim (G-1 ). Remarquons que si seul l'un des deux joueurs réussit à obtenir un sous-graphe connexe, celui-ci est nécessairement gagnant. Il peut également y avoir match nul si aucun des deux joueurs n'obtient un graphe connexe à l'issue de la procédure d'attribution. En reprenant l'exemple proposé à la figure 5, MaxDébit obtient un sous-graphe dont la plus petite arête de son arbre couvrant est de poids 2 et MinLatence obtient un sous-graphe dont la plus petite arête de son arbre couvrant est de poids 3. Le joueur MinLatence remporte donc la partie. Q29. Justifier que ce jeu termine toujours, c'est-à-dire que toute partie est nécessairement finie. Q30. Justifier que la seule possibilité de match nul est celle où aucun des deux joueurs n'obtient un graphe connexe à l'issue de la partie. Q31. Montrer, sur un exemple, que la stratégie consistant à toujours choisir l'arête de poids maximal parmi les arêtes restantes n'est pas une stratégie gagnante pour le joueur MaxDébit. 13/16 V.2 - Implémentation en Python On rappelle qu'en Python une boucle for i in range(a, b) permet de faire évoluer une variable i entre les valeurs a incluse et b exclue. On modélise en Python le graphe pondéré G = (S , A, p) par un objet g de type Graphe dont l'implémentation n'est pas précisée ici. Si g est un objet de type Graphe , g.nb_sommets est un entier correspondant à n = |S | et g.aretes est une liste de longueur m = |A| contenant les triplets (w, i, j) avec 0 i < j < n et w = p({i, j}) correspondant aux arêtes pondérées. On note (ak )k0,m-1 les arêtes dans l'ordre de cette énumération. Par exemple, si g représente le graphe de l'île de Korße représenté à la figure 5, on aura par exemple : >>> g.nb_sommets
4
>>> g.aretes
[(6.0, 0, 1), (2.0, 0, 2), (7.0, 0, 3), (5.0, 1, 2), (8.0, 1, 3), (3.0, 2, 3)]
On représente une configuration par un couple (t, etat) . La première
composante t est un entier
valant 1 si c'est au joueur MaxDébit de jouer et -1 si c'est au joueur
MinLatence de jouer. La deuxième
composante etat est une liste de longueur m avec, pour k 0, m - 1, etat[k] ==
1 si l'arête ak a
déjà été choisie par le joueur MaxDébit, etat[k] == -1 si l'arête ak a déjà été
choisie par le joueur
MinLatence et etat[k] == 0 si l'arête ak n'a pas encore été choisie.
Par exemple, la configuration finale de la figure 5 est représentée par le
couple :
(1, [-1, 1, -1, 1, 1, -1])
En effet, l'état est contrôlé par le joueur MaxDébit, les arêtes d'indices 1, 3
et 4 ont été choisies par le
joueur MaxDébit et les arêtes d'indices 0, 2, 5 par le joueur MinLatence.
La fonction suivante permet de renvoyer la configuration initiale correspondant
à un graphe g :
def configuration_initiale(g):
etat = [0] * len(g.aretes)
return (1, etat)
La fonction suivante permet de savoir quel joueur contrôle une configuration.
Elle renvoie 1 si c'est à
MaxDébit de jouer et -1 si c'est à MinLatence de jouer.
def tour(c):
t, etat = c
return t
Q32. Écrire en Python une fonction finale(c) qui prend une configuration c et
qui renvoie True
si et seulement si la configuration est finale, c'est-à-dire si la partie est
terminée.
On rappelle que si etat est une liste Python, l'instruction suiv = etat.copy()
permet de créer une
copie de la liste etat dans la variable suiv .
Q33. Écrire en Python une fonction configurations_suivantes(c) qui, étant donné
une configuration c supposée non finale, renvoie la liste de toutes les
configurations accessibles en un
coup à partir de cette configuration, c'est-à-dire les configurations obtenues
lorsque le joueur
qui contrôle cette configuration choisit une nouvelle arête. La configuration c
ne doit pas être
modifiée : il est nécessaire d'en faire des copies.
14/16
V.3 - Calcul des attracteurs
On suppose disposer d'une fonction gagnant(g, c) qui, étant donné un graphe g
et une configuration finale c , renvoie 1, 0 ou -1 suivant que la configuration
finale est gagnante pour MaxDébit, un
match nul ou gagnante pour MinLatence. Pour cela, cette fonction va calculer
les sous-graphes G1 et
G-1 obtenus par les deux joueurs, vérifier si ceux-ci sont connexes, le cas
échéant en calculer les
arbres couvrants de poids maximal, puis le poids de l'arête de poids minimal de
ces arbres couvrants,
en déduire blim (G1 ) et blim (G-1 ), les comparer et enfin renvoyer le gagnant
(ou 0 pour match nul).
La fonction suivante permet d'attribuer un score dans {-1, 0, 1} à une
configuration non nécessairement finale.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
def score(g, c):
if est_finale(c):
return gagnant(g, c)
t, etat = c
score_fils = [score(g, suiv) for suiv in configurations_suivantes(c)]
if t == 1:
return max(score_fils)
else:
return min(score_fils)
Q34. Indiquer à quoi correspondent les configurations (non nécessairement
finales) de score -1, de
score 0 et de score 1.
Q35. Considérons une configuration non finale de score 1. Expliquer comment
construire une stratégie gagnante pour MaxDébit à partir de cette
configuration. On ne demande pas d'implémenter
cette fonction en Python ni de montrer que cette stratégie est effectivement
gagnante, mais
uniquement d'expliquer comment l'obtenir.
Les trois sous-parties suivantes sont complètement indépendantes.
V.4 - Memoïsation
L'implémentation précédente de la fonction score va conduire à recalculer un
grand nombre de fois
le score pour une même configuration. On se propose d'adopter une technique de
mémoïsation. On
se donne un dictionnaire cache qui sera, pour simplifier, une variable globale.
Ce dictionnaire permet
de mémoriser le score des configurations pour lesquelles celui-ci a déjà été
calculé. Comme les listes
ne peuvent pas être utilisées comme clés pour les dictionnaires, on utilisera
la fonction fige ci-après
pour convertir une configuration avec des listes en configuration avec des
n-uplets avant de l'utiliser
comme clé du dictionnaire cache .
def fige(c):
t, etat = c
return (t, tuple(etat))
Par exemple, en considérant la configuration obtenue après les trois premiers
coups lors de la partie
donnée en exemple dans la sous-partie V.1, on obtient :
>>> c_ex = (-1, [-1, 0, 0, 1, 1, 0])
>>> fige(c_ex)
(-1, (-1, 0, 0, 1, 1, 0))
15/16
Q36. Compléter le squelette de la fonction score_memo ci-dessous pour que
celle-ci se comporte
exactement comme la fonction score de la sous-partie V.3, mais en utilisant le
dictionnaire
cache pour ne pas recalculer plusieurs fois le score d'une même configuration.
cache = {}
def score_memo(g, c):
# On peut utiliser dans cette fonction la variable globale `cache`
...
V.5 - Algorithme MinMax avec heuristique et exploration jusqu'à une profondeur p
Même en utilisant une fonction mémoïsée, le coût du calcul du score de toutes
les configurations
avec l'approche précédente peut vite se révéler prohibitif. On se propose dans
cette sous-partie d'utiliser l'algorithme MinMax avec une heuristique en
limitant l'exploration jusqu'à une profondeur p N.
On suppose disposer d'une heuristique, c'est-à-dire une évaluation
approximative de la qualité d'une
configuration non finale sous la forme d'un score dans [-1, 1], avec un score
positif si la configuration
semble favorable pour MaxDébit et un score négatif si la configuration semble
favorable pour MinLatence. On suppose donc disposer d'une fonction heuristique
telle que heuristique(g, c) pour un
graphe g et une configuration non finale c renvoie un score dans [-1, 1].
Q37. Écrire en Python une fonction score_minmax(g, c, p) sur le modèle de la
fonction
score de la sous-partie V.3 (sans la mémoïsation de la sous-partie V.4) telle
que
score_minmax(g, c, p) calcule un score pour une configuration c , mais en
limitant l'exploration à une profondeur p N, et en utilisant l'heuristique
comme substitut lorsque l'on
atteint la limite de profondeur.
V.6 - Vol de stratégie
Q38. Montrer que, quel que soit le graphe connexe à pondération injective, il
n'existe pas de stratégie gagnante pour MinLatence. On pourra remarquer
qu'avoir un coup arbitraire en plus ne
peut qu'être bénéfique et procéder par l'absurde en supposant que le deuxième
joueur dispose
d'une stratégie gagnante pour construire une stratégie gagnante pour le premier
joueur.
FIN
16/16
I M P R I M E R I E N A T I O N A L E 25 1046 D'après documents fournis
Ainsi, il existe pour MaxDébit une stratégie lui assurant de ne pas perdre :
elle lui assure soit de
gagner soit de forcer un match nul. Le gouvernement du Listenbourg semble avoir
privilégié un des
deux opérateurs.
